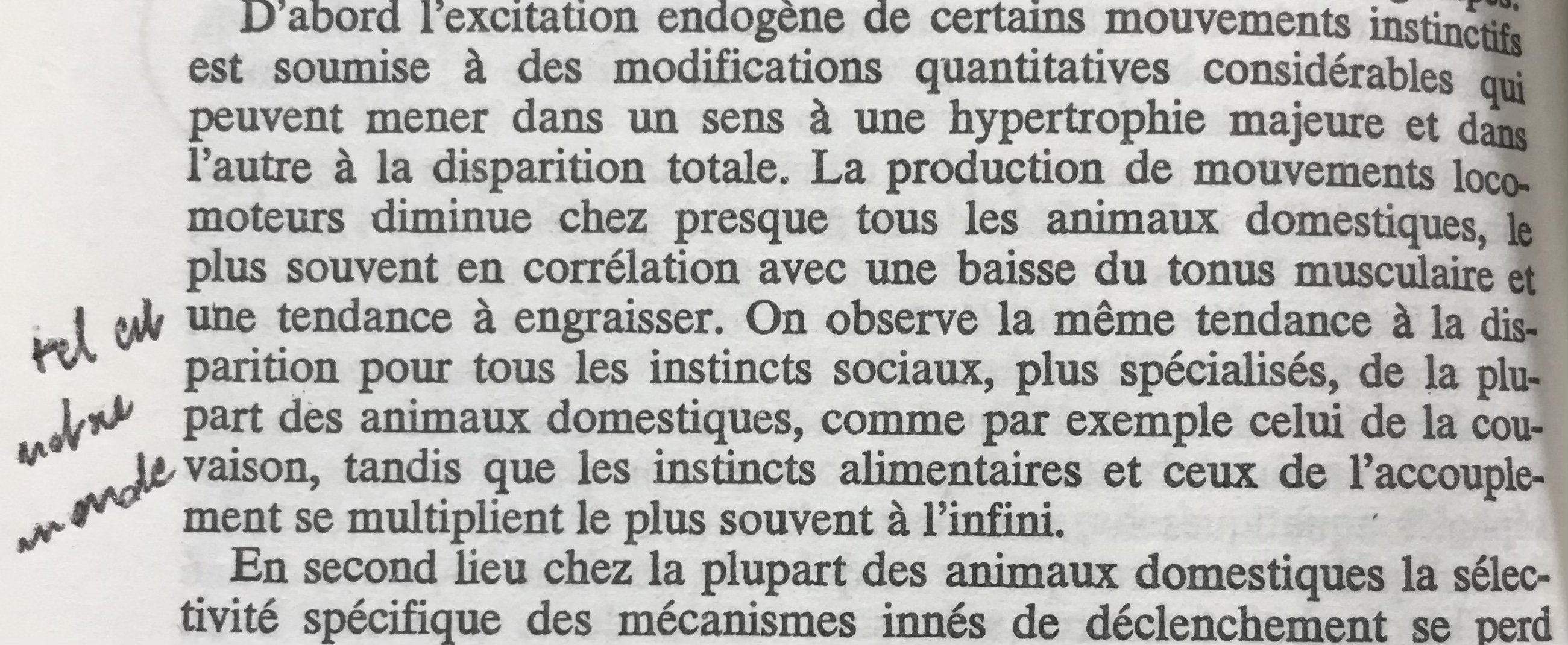-
Compteur de contenus
6 681 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
Ok donc il me semblait que dans Ethique et tac j'avais posté à propos du rapport entre morale et esthétique mais voici ce que j'avais écrit remis dans le cheminement de mes cogitations esthétiques. Il s'agit en fait au départ d'une amie qui m'avait demandé une sorte de cours d'esthétique et finalement ça m'avait intéressé plus que je n'aurais pensé donc j'en ai fait qqch d'un peu plus personnel qui intéressera l'impossible à taguer @JonathanRRazorback dans la mesure où Nietzsche en est le fil conducteur. Dans la mesure où la question de @Lancelot dans ce thread était "qu'est-ce que l'art" et "qu'est-ce que le beau" et que personne y a répondu jusqu'à présent, pas même moi l'an dernier, qui ai préféré utiliser ça comme prétexte pour organiser mes idées en sexologie, je répare cette erreur et maintenant je vais arrêter cette présentation parce que c'est déjà suffisamment long comme ça. Mais si je dois devenir prof j'imagine à peu près qu'un cours pourrait ressembler à ceci. Je l'avais intitulé: L'ART ET LA VIE I) Art et matière L’art est élaboration de la matière. Au début de Le Hasard et la nécessité, Monod écrit que, pour identifier l’existence d’une technique, il suffit de relever, dans les objets qui se présentent à nous, une certaine régularité de formation : des « objets dotés d’un projet ». Cela suppose 1) que la nature est dispendieuse, aléatoire, et ne produit pas de « formes » au sens élaboré du terme, ce qui peut être contesté, par exemple par Mandelbrot, qui étudie la forme fractale de la côte de la Bretagne et utilise les fractales pour définir la beauté « objective » et 2) que l’on suppose une intention humaine derrière cette régularité, ce qui a son complément dans le lieu commun de la théologie médiévale et moderne, qui voit dans la beauté naturelle le signe de l’existence de Dieu. L’idée que l’art transforme la matière la relègue à un rôle subalterne : celui d’une masse informe, ce qui laisse songeur quand on pense à la structure moléculaire des cristaux. La matière est, au mieux, avec Aristote, considérée comme étant enceinte des formes que l’action lui donne. Plotin considère même que la forme est arrachée à la matière, qui résiste. Ce qui devrait valoriser le talent de l’artiste ne le fait en fait pas tant que ça, et jusqu’à la modernité, ce sont principalement les idées ou d’autres facteurs transcendants qui agissent à travers lui. De même, dans l’œuvre s’exprime quelque chose qui la dépasse : c’est le sens de l’idée d’inspiration. L’accusation est toutefois faite que l’art fait obstacle à la connaissance, parce qu’il ne copie pas les idées : c’est l’attaque de Platon, dans la République, X, qui n’est pas une critique de l’imitation en général. Au contraire, Platon est très enthousiaste au sujet de l’imitation des idées : il reproche justement aux artistes de ne pas le faire. En outre, Platon distingue soigneusement la beauté et l’art en général, et la contemplation de la beauté est considérée comme une initiation à la contemplation des idées. II) Art et nature: la beauté objective A partir de la Renaissance, l’art se donne au contraire pour but de reproduire l’impression de la nature : c’est dans ce sens que vont le sfumato, l’expérience de Brunelleschi[1] et l’invention de la perspective aérienne. La notion de beauté est mathématisée : elle serait l’expression de rapports objectifs. Leur contemplation produirait « naturellement » une sensation de plaisir, comme le corroborent les analyses transculturelles sur la symétrie faciale comme critère de beauté. On peut noter tout d’abord que les neurosciences (cf. les travaux de J.-P. Changeux, La Beauté dans le cerveau, mais je ne développe pas trop avant d'avoir lu) identifient certaines aires du cerveau associées à la beauté objective et d’autres à la beauté subjective, ce qui fait que, bien que la beauté soit « naturelle », apprécier un art s’apprend (ht @Rincevent), mais aussi qu’il est commun d’entendre les mathématiciens parler de beauté mathématique : « C’est donc la recherche de cette beauté spéciale, le sens de l’harmonie du monde, qui nous fait choisir les faits les plus propres à contribuer cette harmonie de même que l’artiste choisit, parmi les traits de son modèle, ceux qui complètent le portrait et lui donnent le caractère et la vie. Et il n’y a pas à craindre que cette préoccupation instinctive et inavouée détourne le savant de la recherche de la vérité. On peut rêver un monde harmonieux, combien le monde réel le laissera loin derrière lui ; les plus grands artistes qui furent jamais, les Grecs, s’étaient construit un ciel ; qu’il est mesquin auprès du vrai ciel, le nôtre » (Poincaré, Science et méthode). On notera d’ailleurs en lisant l’extrait cité ci-après de Pascal, qu’il met sur le même plan le poète et le mathématicien (lui-même était un des plus grands mathématiciens de son temps) : « On ne passe point dans le monde pour se connaître en vers si l’on n’a mis l’enseigne de poète, de mathématicien, etc. » Selon Pascal en effet : Pascal envisage surtout la beauté du point de vue de l’agrément, c’est-à-dire par le rapport avec la manière dont l’homme est fait. L’objet de la poésie (comme des arts tels que la musique, la peinture et l’architecture) est d’agréer ou de plaire. Sur la nature de l’art d’agréer, voir L’Esprit géométrique, II, Art de persuader. Louis Marin a composé une bonne étude à des “Réflexions sur la notion de modèle chez Pascal”. Pascal ne se contente pas de reprendre l’idée classique du modèle par imitation : la notion désigne un rapport qui a une valeur normative, sans que cette valeur intervienne dans le fait que le modèle qui est une structure singulière de l'agrément, se retrouve identique dans une collection déterminée d'êtres individuels et les constitue en système d’équivalence parfaite. Le rapport singulier entre la nature de l’homme et la qualité de la chose est la structure générale de l'agrément. Cette structure va permettre la comparaison entre des choses de genre différent, dont la similarité sera définie par le modèle. Mais le modèle par lui-même n’est pas conscient ; comme il fait partie de l’être de l’homme, celui-ci ne peut être conscient que de la chose qui lui plaît, mais non de ce qui fait que cette chose lui plaît. Le modèle dans sa singularité peut être vécu, mais non pensé. Mais il lui est toujours possible de faire fonctionner le modèle, par des comparaisons prises dans des domaines autres que la poésie, qui lui permettent pour ainsi dire de tester la valeur d’un poème proposé. (Analyse piquée sur le site des Pensées de Pascal.) Mais c’est l’imagination qui permet de faire les approchements entre les modèles, et dans Pascal, l’imagination a toujours un rôle créatif : on peut ici contraster ses vues à celles de Descartes, son contemporain, dont nous aurons à reparler brièvement. L’imagination pour Descartes : Elle peut reproduire des images transmises par le sens commun. Elle peut aussi être une production spontanée d’images, ce qui pour l’entendement peut être Positif : imagination toute pure, dégagée de l’influence des sens Elle est alors soumise à la conquête de la vérité. Négatif : imagination influencée par le corps, les humeurs, la folie. Elle est alors source de fausseté. Pascal change cette conception en faisant de l’imagination une faculté originaire, dont les implications sont politiques et qui est interne à l’esprit lui-même et non sous l’influence du corps. Elle crée une seconde nature (cf. fr. 44), exactement comme la coutume. Le fr. 44 commence comme sur un paradoxe : « C’est cette partie dominante de l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté, et d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité, si elle l’était infaillible du mensonge. » D’abord il est question de règle de vérité et pas de vérité : la règle de vérité se définit par son infaillibilité (sans quoi elle ne serait pas une règle) donc par un rapport constant à la vérité, qui n’est pas définie chez Pascal comme chez Spinoza par exemple en termes de cohérence. C’est cette quête de l’infaillibilité qui fait assimiler le douteux au faux, chez Pascal comme chez Descartes pour le coup. « Ces choses qui nous tiennent le plus, comme de cacher son peu de bien, ce n’est souvent presque rien. C’est un néant que notre imagination grossit en montagne ; un autre tour d’imagination nous le fait découvrir sans peine. » (fr. 531) : ainsi en effet l’imagination n’indique-t-elle ni toujours le vrai, ni toujours le faux. Sur l’imagination maîtresse de la raison on peut envisager un sens politique (maître d’une région) ou amoureux, ce qui s’accorde bien avec la « fourberie ». On distingue aussi « fausseté » et « erreur » : l’erreur est le contraire du vrai (logique), la fausseté est le contraire de la franchise (moral). L’une peut donc être voulue, l’autre non. III) La beauté, une nature imaginée? Pascal souligne le plaisir qu’apporte l’imagination, qui est un plaisir narcissique ; et les autres nous aiment en proportion de l’amour que l’on se porte. Mais c’est un leurre : l’imagination nous cache nos misères et semble nous rendre heureux, alors qu’en fait c’est notre plus grande misère, puisque comme la parabole du roseau pensant le montre, notre grandeur est de connaître notre misère. Il y a ici une frappante similitude d’analyse entre Pascal et Nietzsche, qui revendique d’ailleurs cette ascendance. Comment dès lors comprendre la condamnation pascalienne de la peinture (« quelle vanité que la peinture… ! ») ? Dans le fr. 13, Pascal écrit : « Deux visages semblables, dont aucun ne fait rire en particulier[,] font rire ensemble par leur ressemblance. » On peut utiliser ce fragment mystérieux pour dire que la symbolique est contextuelle : par exemple Pascal écrit aussi bien au fr. 25 que la coutume de voir les rois en pompe et accompagnés de serviteurs nous les fait craindre quand nous les voyons seuls. La chose toute seule ne fait pas signe, il faut un système symbolique : deux visages, la pompe du roi, même si cette pompe est vaine et factice (« quelle vanité ») et en même temps, c’est de cette facticité que vient l’effet et non de la chose. Ce n’est pas le roi qui inspire l’autorité par nature, mais sa représentation. On retrouve aussi là une problématique janséniste du signe exigeant qu’il manifeste, sans le trahir, ce qui ne peut être représenté sans lui (Dieu, l’idée, le modèle). Il s’agit donc de la question de la juste mesure, car « ceux qui, après avoir peint, ajoutent encore, font un tableau au lieu d’un portrait » (fr. 578). De même, la juste mesure s’applique au jugement, au peintre qui doit être à la juste distance de son tableau pour en juger (fr. 558) et au lecteur qui doit lire à la bonne vitesse. Ce topos pascalien s’applique à l’épistémologie et à la politique (« La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles que nos instruments sont trop mousses pour y toucher exactement. » fr. 44). A y regarder de plus près, la condamnation pascalienne de la peinture porte une restriction : elle ne porte pas sur la peinture de ce dont on admire les originaux (le Roi par exemple : dans ce cas le tableau manifeste sans la trahir l’autorité du roi : il y a proportion, contrairement à une nature morte, genre que Pascal devait détester). La peinture elle-même n’est donc pas vanité quand elle contribue à la pompe elle-même car c’est précisément son rôle. Regardez un arbre, lisez cette phrase. De même que chaque lettre n’est pas décryptée par l’œil qui parcourt la ligne, de même l’arbre n’est-il perçu qu’en gros, et les détails poétiquement ajoutés. L’analogie n’est pas gratuite, car Nietzsche entend le monde comme un texte et identifie les erreurs de philosophes à des erreurs de lecture. Elles consistent à voir du texte là où il n’y a en fait que de l’interprétation. La philosophie, pour Nietzsche, n’a été jusqu'à lui qu’une entreprise artistique ignorante de sa fantaisie. L’art n’est pas circonscrit à un domaine de l’activité humaine. Il est le prisme par lequel nous nous rapportons au monde. Ce monde est chaotique, la nature est dispendieuse, violente. Elle n’est pas propice à l’existence. L’homme s’est donc trouvé contraint d’inventer ce monde. De là l’idée que la perception est créatrice, qu’elle génère ce que l’esthétique contemporaine (Roger Scruton par exemple) a appelé des « aspects » (pensez au canard-lapin, dont les aspects (respectivement ‘canard’ ou ‘lapin’) sont inséparables de l’objet). On trouve souvent dans Nietzsche l’idée que « le monde est une fable », et cette fable se développe tout autant en art qu’en philosophie, en science comme en religion. Parce que l’homme croit son existence nécessaire, il en est conduit à croire que les représentations qu’il a générées pour vivre, et qui se sont cristallisées avec le temps pour devenir des valeurs, sont nécessaires aussi, mais c’est là une grande erreur. Ce n’est pas le désir de connaissance qui se trouve à la racine de la philosophie, mais une peur panique, une grande détresse. IV) Du sentiment du beau à l'objectivité: le cheminement du jugement réfléchissant Ici, Nietzsche retrouve le chemin de l’entreprise kantienne, à savoir : comment se peut-il que j’affirme que River Phoenix est beau, supposant donc que mon affirmation est universelle et nécessaire, alors que, contre toute apparence, elle ne porte pas tant sur l’apparence de River Phoenix que sur le sentiment de plaisir que j’ai à le regarder, càd la chose la plus intime ? Il convient ici de préciser que Kant distingue le sentiment, intellectuel, de la sensation, physique, parce que le propre du sentiment esthétique est d’être détaché de la question de l’existence de son objet, contrairement à Hume, qui relie la contemplation du beau à un sentiment agréable du corps et à une disposition confortable de l’esprit, qu’il nomme pride, par opposition à l’humility. Hume est en cela plus proche de Nietzsche, qui rejette le dualisme et l’intellectualisme de Kant. Pour Kant en effet, le beau n’est ni un concept (connaissance), ni un agrément (plaisir) : il est bien plutôt une invitation à la recherche conceptuelle, par le libre jeu de l’entendement sous la conduite de l’imagination. L’entendement ne cesse de proposer des concepts sans pouvoir arriver à satiété. Cette voie ouverte, qui rend possible la discussion entre gens instruits, est la « forme de la finalité d’un objet sans représentation d’une fin ». La discussion suppose le partage, comme l’expérience partagée de l’œuvre, dans la postulation d’un sens commun : le plaisir esthétique est donc tout différent du désir érotique, qui aspire à la possession exclusive. La beauté, pour finir au sujet du sens que lui accorde Kant, ne pourrait être expliquée ni en termes de finalité objective, à savoir par la perfection de l’objet en son genre, ce qui suppose une connaissance de l’objet pour pouvoir le trouver beau, et donc un jugement déterminant, ni en termes de finalité subjective. Symétriquement, seul ce qu’on ne peut produire, même en le connaissant parfaitement, relève de l’art : le génie ne connaît pas les règles de sa production, car il est l’intermédiaire par lequel la nature donne ses règles à l’art. La nature est en effet le concept qui permet d’articuler, dans Kant, le jugement esthétique et le jugement moral : elle nous permet de postuler notre accord avec nos semblables, mais seulement en termes d’art. L’art est comme le moyen par lequel nous approchons la compréhension de la nature. L’idée selon laquelle l’art nous permet de voir la nature autrement, ou de la voir telle qu’elle est vraiment, est promise à une longue postérité : Wilde et Bergson défendent la première option, tandis que Schopenhauer, en écrivant dans le livre III du Monde comme volonté et représentation, que l’art nous révèle la force de la volonté dans le cosmos, défend plutôt la deuxième. Ainsi définie, la beauté n’a de valeur que pour les hommes, êtres raisonnables. On peut relever une consonance entre l’argumentation kantienne, qui fait du sentiment esthétique le propre de l’homme, et celle d’Aristote sur la citoyenneté, en tant qu’elle exclut bêtes et dieux, car le beau, pour Kant, « n’intéresse empiriquement que dans la société », et offre un modèle de disposition à la morale, dans la mesure où il suppose de s’affranchir de l’intérêt au monde physique (et pour Kant, la morale est une question métaphysique). Quoique désintéressé, le sentiment esthétique peut donc produire un intérêt social, moral, avec cette différence que le jugement esthétique produit un intérêt « libre », alors que le jugement moral produit un intérêt « fondé sur une loi objective ». Le jugement de goût présente donc une analogie avec le jugement moral (Kant parle « de la beauté comme symbole de la moralité ») : il rend possible le passage de l’ « attrait sensible » (déconstruit par le désintéressement que suppose l’expérience esthétique) à l’ « intérêt moral habituel ». On peut pousser l’esthétique de Kant jusqu’à dire, sans contresens, que ce n’est pas l’objet mais le jugement qui nous plaît. En cela, Kant nous éloigne radicalement du rapport entre beauté sensible et monde intelligible de Platon, en faisant de la contemplation esthétique une activité plaisante pour elle-même pour tout homme. V) L'expérience esthétique Nietzsche se rit de cette image de l’homme civilisé, détaché de ses ancrages dans le sensible. Au contraire, l’homme est constamment le lieu d’une lutte de puissances, et sujet à une peur terrible, jeté dans une nature chaotique. L’homme a donc dû rendre le monde habitable. Il a appelé « beau » ce qu’il trouvait humain. Pour réaliser une œuvre de grande beauté, il a donc fallu qu’il souffre en proportion, car cette beauté sourd d’un besoin proportionnel d’être rassuré. Freud, qui écrit que l’art est une « douce narcose » nous consolant de la vie, et analyse de façon similaire la religion, n’aurait pas écrit autre chose. A bien des égards d’ailleurs, la possibilité que la perception du monde ne soit qu’invention remonte avant Nietzsche : Descartes suspectait déjà que le monde ne soit qu’un rêve. Or la psychologie moderne nous a enseigné que le rêve était souvent la réalisation inconsciente de désirs inassouvis dans la veille. Plus encore, Descartes va jusqu’à écrire que, lorsque nous rêvons, les images nous parviennent comme des tableaux : « il faut au moins avouer que les choses qui nous sont représentées dans le sommeil sont comme des tableaux et des peintures ». Nietzsche propose seulement d’appliquer la même herméneutique au rêve et à l’art. C’est dans cet esprit que Wittgenstein pense l’interprétation des rêves en termes esthétiques. Il propose d’opposer une explication par les causes, qui serait le ressort de la science, à une explication par les raisons, dont le critère de validité est l’assentiment de celui à qui elle est destinée. Wittgenstein reproche à Freud de prétendre à l’explication causale, et prend l’exemple suivant : une femme rêve de fleurs, et dit que ce rêve est beau. Freud, quoique Wittgenstein ne dise pas précisément de quelle façon, fait voir dans l’image des fleurs une symbolique sexuelle, ce qui détruit, pour l’analysée, la beauté de son rêve. Pour Wittgenstein, cette « explication » n’est pas une bonne interprétation, car elle trahit « l’œuvre ». Rien n’empêche de rétorquer à Wittgenstein, cependant, que le rêve n’est pas expérimenté comme une impression esthétique, en particulier parce qu’il ne peut être partagé. Peut-être l’esthétique est-elle toutefois une impression incommunicable. Bien que Wittgenstein critique comme insensés les énoncés sur le « je-ne-sais-quoi », il considère que la perception et la compréhension esthétique d’une œuvre n’est nulle part mieux mise en lumière que dans la réaction physique qu’elle provoque (un certain balancement du corps imperceptible en écoutant de la musique, un regard qui s’illumine quand un lecteur de Proust parle de la Recherche) : la compréhension artistique n’est pas de l’ordre d’une connaissance théorique mais plutôt d’une connaissance pratique tacite, qui se lit dans le comportement. L’idée centrale, pour Wittgenstein, est que la compréhension de l’œuvre ou son interprétation ne doit pas être extérieure à l’œuvre, comme c’est le cas d’une explication scientifique. On songe aux critiques de la réception esthétique dans Proust, qui souligne également l’importance des réactions physiques et du contexte pour la réception de l’œuvre (cf. les réactions exagérées de Mme Verdurin à la sonate de Vinteuil, ou la double expérience de la Berma dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs (le narrateur est déçu parce qu’il s’y attend trop) et Le Côté de Guermantes (le narrateur est surpris en bien parce qu’il n’est pas venu pour ça) : l’expérience esthétique sert de modèle à la tragédie de l’existence). (Illustration : poème de Ponge) L’idée que l’expérience esthétique serait intrinsèquement incommunicable est directement opposée à la perspective kantienne, dont l’interrogation centrale peut être résumée comme suit : comment un jugement singulier peut-il, sans règle, prétendre à l’universalité ? L’universalité du jugement de goût ne provient pas de l’objet mais de la communicabilité du jugement à lui tout seul. D’autre part, on peut résumer les remarques sur le pouvoir créatif de l’imagination (qu’on peut faire remonter à Pascal, voire à Platon), comme unification (Kant dit : « aperception ») du donné, et non comme enregistrement passif des stimuli, à l’idée qu’un texte doit préalablement avoir du sens pour être lisible : sa signification n’est pas découverte ex nihilo. C’est ce mécanisme qui nous fait remonter à une logique apophantique (selon une formule de Michel d’Hermies) dans l’ordre des choses qui est à l’œuvre dans le jugement réfléchissant. Ce mécanisme n’est pas causal (il ne s’agit pas de la théologie médiévale qui remonte du phénomène de la beauté à la cause divine comme au premier moteur aristotélicien) mais il est final : la finalité est un principe d’investigation et non d’explication nécessaire. Kant renverse donc totalement la perspective métaphysique qui prévalait jusqu’alors, qui posait une cause initiale dans le monde (Timée, 29e–30c). Kant effectue ce renversement en distinguant la fin naturelle (Naturzweck) de la fin de la nature (Zweck der Natur) : la première suppose la connaissance des intentions du créateur, ce que la Critique de la raison pure nous a appris à considérer comme dépassant largement notre entendement, tandis que la seconde désigne quelque chose qui nous paraît internement organisé, simultanément moyen et fin, qui ne nous force pas à concevoir la nature comme un tour objectivement organisé, même si, subjectivement, il nous y incite ; c’est d’ailleurs ce qui explique les postulats de Kant sur l’histoire comme processus de moralisation de la nature humaine, ce qui nous incite semblablement à ne pas nous attarder sur les massacres ou les erreurs, qui ne sont que des errements en chemin (cf. Idée d’une histoire universelle…, 7e proposition). Il s’agit in fine d’un impératif moral : il faut que je veuille un règne des fins pour obéir à mon devoir (ou pour que l’obéissance à mon devoir ait un sens, même si Kant ne le dirait pas comme ça). On voit bien ce qui a pu provoquer l’ire de Nietzsche dans une telle perspective. VI) Art et histoire Kant n’est pas le seul à faire un lien entre histoire et art, puisque c’est aussi le cas de Hegel. L’histoire de l’art, comme l’histoire de l’humanité, est celle de l’advenue de l’esprit à lui-même, c’est-à-dire d’une prise de conscience, pensée sur le modèle de la dialectique du maître et de l’esclave. Les trois stades de l’art (symbolique, classique, romantique) correspondent à un développement de plus en plus grand de l’esprit, qui est d’abord extérieur à l’œuvre (les pyramides expriment quelque chose qui n’est pas dans leur forme), puis s’y confond (la statuaire grecque dit la beauté et est belle) et la dépasse (l’art romantique représente des sentiments, donc la pensée). L’exemple que prend Hegel pour illustrer ce dernier stade est la Piéta de Michel-Ange : On n’y voit non pas seulement la Vierge et le Christ, mais le sentiment de résignation et de piété chrétienne peint sur les traits de Marie, et en déchiffrant ce sentiment, l’esprit est en quelque sorte mis en contact avec lui-même dans l’expérience esthétique. Dans les termes de la phénoménologie de l’esprit, il se reconnaît (à entendre dans le sens de la lutte pour la reconnaissance). La conciliation de l’histoire de l’art et de celle de l’homme s’explique par le fait que l’art exprime les conceptions spirituelles d’un peuple. Il est l’universel incarné dans le particulier, et les mésaventures de l’universel aux prises avec la négativité du réel, dont la rationalisation est la définition du processus historique, c’est l’histoire de l’histoire, qui s’achève avec l’avènement de l’Etat, figure de la rationalité advenue. Si Nietzsche, par exemple, s’accordera avec Hegel que la liberté ne peut qu’être le produit d’une culture, il se distinguera très fortement de Hegel, en revanche, en niant que la culture se développe au sein d’un Etat, mais bien au contraire contre lui : le surhomme doit être sa propre œuvre d’art. On peut toutefois prolonger la pensée de Hegel en montrant que, dans l’art romantique, l’art s’affranchit de la recherche du beau au profit du concept, ouvrant par là la voie à l’art abstrait, et en particulier au mouvement suprématiste, digne successeur des icônes, qui mettent en présence de Dieu. Malevitch, par exemple, défendait une interprétation mystique de Carré noir sur fond blanc (qui, pour information, n’est pas noir et n’est pas un carré ; les côtés ne sont pas exactement parallèles) : durant la première exposition, il a mis le tableau dans ce que l’on appelle le « beau coin », l’angle où sont habituellement exposées les icônes dans les maisons paysannes russes. Le critique et artiste Alexandre Benois, qui a relevé le symbolisme de l’emplacement de la peinture, a écrit : « C’est l’icône qu’utilisent les futuristes au lieu de la Vierge à l’Enfant…. Ce n’est plus le futurisme que nous avons à présent devant nous, mais la nouvelle icône du carré. Tout ce que nous avions de saint et de sacré, tout ce que nous aimions et qui était notre raison de vivre a disparu. » (https://art-zoo.com/kasimir-malevitch/) VII) Être artiste ou mourir On voit ici dans quel sens l’art est une manifestation des conceptions morales et spirituelles d’un peuple, et ce qui intéresse Nietzsche est l’art comme manifestation culturelle. L’art grec nous donne l’image d’un peuple obsédé par la mort, la guerre, le sexe et les orgies, à l’opposé de la conception classique de la tempérance et de l’équilibre ainsi que de la raison, dont Nietzsche attribue la prépondérance à l’influence du socratisme, qui porte déjà en ses germes le christianisme. L’art, auparavant, était un stimulant pour la vie, de même que la guerre ou la science, si par là on entend l’application sans scrupule de la raison à la destruction des préjugés, mais pour s’administrer un stimulant aussi vigoureux, il faut être soi-même en bonne santé. Le socratisme n’a pas tant dégradé l’état moral de la Grèce qu’il n’est le symptôme (comme Wagner en Allemagne) d’un état de décadence avancé, c’est-à-dire de domination d’une pulsion particulière (dans le cas de Socrate, la raison) aux dépens de toutes les autres. En conséquence, Socrate, et après lui Platon, ont identifié le Vrai au Beau et le Beau au Bon, négligeant complètement la possibilité, pourtant elle profondément grecque, que le Beau soit terrible, dangereux, mortel. De façon intéressante, pour Nietzsche, le déséquilibre des passions est aussi synonyme de laideur physique. Dans un passage d’Ainsi parlait Zarathoustra, Zarathoustra sort de sa grotte et voit un homme dont l’oreille est si hypertrophiée qu’on croirait avoir affaire à une oreille vivante quand on le voit de loin. Cet homme est l’allégorie de la décadence : la domination d’une pulsion (dans le cas de l’oreille, l’interprétation est ouverte) sur les autres, à l’inverse du corps bien proportionné, qui est l’image de pulsions régulées et, pour employer un terme qui aura aussi une postérité freudienne, sublimées. On retrouve ici, ce qui est fréquent dans Nietzsche (qui définit sa philosophie comme un « platonisme inversé »), un écho de Platon et de la morale grecque qui fait correspondre la beauté du corps à la santé de l’âme. Pour en revenir à Nietzsche, il n’y a pas lieu d’opposer l’art à la science, mais bien plutôt à la nature chaotique. C’est pourquoi Nietzsche s’en prend vivement aux naturalistes. Les deux « fables » ne sont que des outils de survie dans un monde chaotique. A la différence de Darwin, la survie n’est pas obtenue par l’adaptation à l’environnement mais par la poétisation de l’environnement, comme on meuble un appartement désert. Le mythe d’Héraclès, par exemple, signifie notamment que la Terre a été rendue habitable en chassant les monstres. Il faut cependant souligner que la conception nietzschéenne de l’art, comme de la science ou de la religion, n’est pas uniforme. Nietzsche distingue plusieurs formes d’art, notamment l’art « apollinien » et l’art « dionysiaque ». L’art apollinien repose sur le principe d’individuation et la distinction des formes, tandis que l’art dionysiaque est une pulsion de retour au chaos originel, un dérèglement de tous les sens. Nietzsche souligne, dans La Naissance de la Tragédie, comment le chœur des tragédies antiques participe à l’action pour illustrer cette conception moniste de l’art qu’il identifie chez les Grecs et qui trouve la solution à l’angoisse existentielle dans une débauche de puissance vitale, plutôt que dans sa restriction. En ce sens, Nietzsche oppose une conception plus large du dionysiaque, comme tendance au dépassement de soi (ce qu’il appellera, dans un stade ultérieur de sa pensée, le « surhumain »), et l’art chrétien, qui ne cherche pas la tyrannie et le dressage des passions mais leur castration. L’art a donc une position ambiguë. Il peut servir à l’affaiblissement de la vie chez l’homme, quand il s’agit d’un art décadent qui substitue à l’expérience terrible, celle qui pose un défi à l’existence, une représentation affadie, mais il peut aussi servir de stimulant. Nietzsche maintient tout au long de son œuvre cette idée fondamentale qu’on ne devient jamais fort si l’on n’en a pas besoin. [1] https://sites.google.com/site/decouvrirlaperspective/l-experience-de-brunelleschi Trucs que j'ai enlevés pour assurer une meilleure fluidité du raisonnement: Santayana, Wilde, Scruton, les trompe-l'oeil, les algorithmes de reconnaissance faciale estimant la beauté des visages comme etc (ce sera pour le prochain épisode si vous avez aimé ça)
-
Si c'est pas libéral, je lis pas.
-
Oui en effet, et je reconnais que ça commence à sortir du champ de la question que tu posais. Bah j'ai commencé à m'intéresser à cette question justement. Peut-être qu'inconsciemment ma première réponse visait à orienter le débat vers ce qui moi m'intéresse mais puisque tu me tends la perche je crois que c'est vraiment l'optique de Kant dans la Critique de la faculté de juger. L’interrogation centrale de Kant peut être résumée comme suit : comment un jugement singulier peut-il, sans règle, prétendre à l’universalité? L’universalité du jugement de goût ne provient pas de l’objet mais de la communicabilité du jugement à lui tout seul. Pour Kant, le jugement esthétique, dans la mesure où il est "réfléchissant," est une propédeutique à la moralité et la socialité/vie sociale. Je peux développer Comment se peut-il que j’affirme que River Phoenix est beau, supposant donc que mon affirmation est universelle et nécessaire, alors que, contre toute apparence, elle ne porte pas tant sur l’apparence de River Phoenix que sur le sentiment de plaisir que j’ai à le regarder, càd la chose la plus intime ? Il convient ici de préciser que Kant distingue le sentiment, intellectuel, de la sensation, physique, parce que le propre du sentiment esthétique est d’être détaché de la question de l’existence de son objet, contrairement à Hume, qui relie la contemplation du beau à un sentiment agréable du corps et à une disposition confortable de l’esprit, qu’il nomme pride, par opposition à l’humility. Hume est en cela plus proche de Nietzsche, qui rejette le dualisme et l’intellectualisme de Kant. Pour Kant en effet, le beau n’est ni un concept (connaissance), ni un agrément (plaisir) : il est bien plutôt une invitation à la recherche conceptuelle, par le libre jeu de l’entendement sous la conduite de l’imagination. L’entendement ne cesse de proposer des concepts sans pouvoir arriver à satiété. Cette voie ouverte, qui rend possible la discussion entre gens instruits, est la « forme de la finalité d’un objet sans représentation d’une fin ». La discussion suppose le partage, comme l’expérience partagée de l’œuvre, dans la postulation d’un sens commun : le plaisir esthétique est donc tout différent du désir érotique, qui aspire à la possession exclusive. La beauté, pour finir au sujet du sens que lui accorde Kant, ne pourrait être expliquée ni en termes de finalité objective, à savoir par la perfection de l’objet en son genre (même si, et je ne plaisante pas, on pourrait présenter comme ça la beauté physique, et Dieu sait si on l'a fait, et puis il faudrait aussi aborder la magnifique idée grecque que la beauté du corps et la santé de l'âme se reflètent), ce qui suppose une connaissance de l’objet pour pouvoir le trouver beau, et donc un jugement déterminant, ni en termes de finalité subjective. Symétriquement, seul ce qu’on ne peut produire, même en le connaissant parfaitement, relève de l’art : le génie ne connaît pas les règles de sa production, car il est l’intermédiaire par lequel la nature donne ses règles à l’art. La nature est le concept qui permet d’articuler, dans Kant, le jugement esthétique et le jugement moral : elle nous permet de postuler notre accord avec nos semblables, mais seulement en termes d’art. L’art est comme le moyen par lequel nous approchons la compréhension de la nature. L’idée selon laquelle l’art nous permet de voir la nature autrement, ou de la voir telle qu’elle est vraiment, est promise à une longue postérité : Wilde et Bergson défendent la première option, tandis que Schopenhauer, en écrivant dans le livre III du Monde comme volonté et représentation, que l’art nous révèle la force de la volonté dans le cosmos, défend plutôt la deuxième. Kant renverse donc totalement la perspective métaphysique qui prévalait jusqu’alors, qui posait une cause initiale dans le monde (Timée, 29e–30c). Kant effectue ce renversement en distinguant la fin naturelle (Naturzweck) de la fin de la nature (Zweck der Natur) : la première suppose la connaissance des intentions du créateur, ce que la Critique de la raison pure nous a appris à considérer comme dépassant largement notre entendement, tandis que la seconde désigne quelque chose qui nous paraît internement organisé, simultanément moyen et fin, qui ne nous force pas à concevoir la nature comme un tour objectivement organisé, même si, subjectivement, il nous y incite ; c’est d’ailleurs ce qui explique les postulats de Kant sur l’histoire comme processus de moralisation de la nature humaine, ce qui nous incite semblablement à ne pas nous attarder sur les massacres ou les erreurs, qui ne sont que des errements en chemin (cf. Idée d’une histoire universelle…, 7e proposition). Il s’agit in fine d’un impératif moral : il faut que je veuille un règne des fins pour obéir à mon devoir (ou pour que l’obéissance à mon devoir ait un sens, même si Kant ne le dirait pas comme ça). Ainsi définie, la beauté n’a de valeur que pour les hommes, êtres raisonnables. On peut relever (enfin moi je vais pas me gêner) une consonance entre l’argumentation kantienne, qui fait du sentiment esthétique le propre de l’homme, et celle d’Aristote sur la citoyenneté, en tant qu’elle exclut bêtes et dieux, car le beau, pour Kant, « n’intéresse empiriquement que dans la société », et offre un modèle de disposition à la morale, dans la mesure où il suppose de s’affranchir de l’intérêt au monde physique (et pour Kant, la morale est une question métaphysique). Quoique désintéressé, le sentiment esthétique peut donc produire un intérêt social, moral, avec cette différence que le jugement esthétique produit un intérêt « libre », alors que le jugement moral produit un intérêt « fondé sur une loi objective ». Le jugement de goût présente donc une analogie avec le jugement moral (Kant parle « de la beauté comme symbole de la moralité ») : il rend possible le passage de l’ « attrait sensible » (déconstruit par le désintéressement que suppose l’expérience esthétique) à l’ « intérêt moral habituel ». On peut pousser l’esthétique de Kant jusqu’à dire, sans contresens, que ce n’est pas l’objet mais le jugement qui nous plaît. En cela, Kant nous éloigne radicalement du rapport entre beauté sensible et monde intelligible de Platon, en faisant de la contemplation esthétique une activité plaisante pour elle-même pour tout homme. Bien sûr on peut reprendre tout ce que j'ai dit et ajouter comme un ado attardé "... ou pas!" Ça vous donnera l'oeuvre de Nietzsche. Pour continuer mon aventure je lirais bien L'Art et l'illusion de Gombrich, bien sûr, mais aussi The Sense of Beauty de Santayana. Ce qui m'importe c'est que j'aie réussi à argumenter en faveur d'une "éthicité" des jugements esthétiques, ce qui était, je crois, ta question. Pour tes 4 questions d'hier, je ne suis pas assez instruit en sciences cognitives ou psycho pour répondre ou apporter des éléments sur (1) mais j'espère que le présent wot apporte des éléments sur (2).
-
À ce propos j’ai récemment eu dans mes pattes ceci https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674919211 mais ça avait l’air trop matheux pour moi
-
Callicles devait probablement avoir monsieur phi en tête quand il disait que les philosophes ressemblaient à des adultes ridicules n’ayant pas grandi et qui jouaient encore avec les concepts comme les enfants
-

Mélenchon, le Tout Petit Père des Peuples
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Politique, droit et questions de société
Ou alors le mec cherche les emmerdes et Mélenchon a très bien fait de le remettre à sa place. -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Bon moi je vais me faire livrer un bouquin la nuit pour la première fois (Amazon). Ma commande affiche "Livraison aujourd'hui avant 22h". Ticking, ticking. (Comme j'attends de voir ce qui va se passer dans 10 min (en fait ça se trouve et meme assez probablement il est déjà livré, je vais aller voir), Amazon me propose d'acheter Penser dans un monde mauvais de Geoffroy de Lagasnerie. Ce titre ) -
Ben voyons. C'est le début du roman, c'est la grande époque des moralistes, des libertins, du roman épistolaire, du théâtre bourgeois, de Marivaux, de Diderot, mais sinon c'est pas fou fou? (edit cinq heures plus tard: sans oublier les mémorialistes) La France n'est pas le monde entier. On a écrit des romans avec des narrateurs plus complexes et plus de niveaux méta. Je vois pas en quoi ça "tue" davantage l'idée de roman que Bouvard et Pécuchet ou Salômbo ou Tristram Shandy. Et franchement Céline ne change pas grand chose à l'art du roman comme narration ou récit. C'est vraiment pas ce qui frappe quand on lit ses premiers livres (ceux que les gens ont lu). Les derniers romans sont plus abstraits et avant-garde mais on en parle bcp moins justement: des romans sans intrigue, parfois quasiment illisibles sous la couche d'exclamations et d'onomatopées. C'est plus de la musique.
-
Bof. Il n'y a rien eu de "comparable" à Céline avant ou après Céline. D'un certain point de vue Céline est un écrivain d'un autre temps que le sien, un écrivain en "verve" (la "verve" étant une qualité qui disparaît au XXe, je crois que c'est Drieu qui fait remarquer ça dans son Journal) qui appartient davantage, littérairement parlant, au monde des fabliaux et des satires romaines qu'au monde du roman contemporain. Mais quand on arrête d'estimer la valeur d'une période entière à l'aune d'une autre comme si c'était comparable ou, pire, à l'aune d'un seul auteur, on se rend compte que "la littérature" se porte aussi bien que jamais. Un exemple de pourquoi cette approche ne marche pas: au XVIIIe siècle en France, il n'y a aucun poète. Zéro. A part Chénier, à la toute fin. Comparé aux deux siècles précédents, ça fait mal. Et? "La littérature" est devenue moins bien pour autant parce qu'on n'avait plus notre Ronsard?
-
Comparer les antivax aux Bolchéviques, j'aurai vraiment tout lu. Je m'en fiche des conneries des antivax. Les gens suffisamment cons ou manipulateurs pour les produire influenceront le choix des gens suffisamment cons pour y croire. C'est la vie. Les antivax ne font pas "bien pire": on a d'un côté des gens qui influencent l'opinion (en mal, ok), de l'autre des gens qui applaudissent des agressions. Et le gouvernement n'a aucun rôle dans la méfiance vis-à-vis des MSM bien sûr...? C'est un peu facile de renvoyer tout le monde dos-à-dos.
-
Eh bien @Johnnieboy nous parlions de Céline, événement littéraire de l'année: on vient de mettre la main sur les manuscrits volés à la Libération! Il l'avait toujours dit, c'était vrai. Il s'agit, entre autres, de la fin de Casse-pipe et d'un roman inédit (!), intitulé Londres apparemment. Je frétille d'impatience. https://www.la-croix.com/Culture/Lincroyable-reapparition-manuscrits-disparus-Louis-Ferdinand-Celine-2021-08-05-1201169545
-
Ce que je voulais surtout dire est que peut-être tous les êtres humains ne sont pas susceptibles d'agir moralement. Sinon on n'aurait pas d'exempli, on ferait juste comme tout le monde et on appellerait ça "agir moralement", ou on créerait tous nos propres valeurs, et ça ne risque pas d'arriver. Well je pense qu'on peut faire plus de choses que ça avec le dégoût. Je ne veux pas parler des livres que j'ai pas lus *mais* Haidt en fait la pierre de touche de ses études sur les fondements psychologiques des orientations politiques si je me souviens de son podcast chez jbp. Et il a aussi un rôle dans le comportement sexuel. Mais au-delà de ça, ce à quoi je voulais tendre était plutôt un mécanisme tel que la théorie implique les jugements qui sont portés sur elle (et c'est pour ça que je prenais comme illustration les théories de la vérité). A partir du moment où seuls certains êtres d'une constitution précise peuvent porter des jugements sur la théorie, par proxy (le proxy étant ces êtres), la théorie implique les jugements qui sont portés sur elle. Nous ne sommes que les outils de la théorie pour réaliser le bien moral sur Terre. Dites-moi si je délire. En revanche, je suis d'accord qu'il est sans doute difficile de faire pour 'courageux' ce que Carnap a fait pour 'soluble'. Ni très fascinant d'ailleurs. Mais c'était joli dans le raisonnement. On pourrait aussi dire que je choisirais de la répéter dans une autre vie (l'éternel retour). Mais ça laisse ouverte la question: qu'y a-t-il de spécifiquement moral dans cette action? Il y a beaucoup de choses que je choisirais de répéter dans deux instances identiques modulo le nombre de brins d'herbe mais qui ne sont pas morales. Ni immorales d'ailleurs. 99% des trucs que je fais ces jours-ci par exemple. On en revient bien au problème de caractérisation de la moralité des actions.
-

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron
Vilfredo a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société
Je deviens dylsexique -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Ce mec est vraiment Bryan Mills -

Détroit, Californie, New York : le socialisme Made in USA
Vilfredo a répondu à un sujet de NoName dans Europe et international
La vidéo où il se justifie de toucher les joues d'une femme à un mariage, et qui a fait la Une du NYT, est quand même incroyable. Ah oui et il lui a dit 'ciao bella'. Un vrai danger public. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
C'est incroyable cette liste d'articles (principalement de la BBC pour ce que j'ai lu) autour de Matt Damon, que sa fille aurait convaincu de ne pas employer le mot "faggot" (qui n'est même pas écrit en entier dans les articles comme s'il fallait conjurer la présence de Voldemort; il n'y a pas si longtemps on censurait Fairytale of New York de The Pogues pour cette raison je rappelle). D'abord celui-ci: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-58053709 Ensuite ça: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-58069170 Parce que oui, après qu'on a appris qu'il ne dirait plus "faggot", il y a eu des gens pour se scandaliser qu'il ne décide d'arrêter de le dire que maintenant! Qu'est-ce qu'il est supposé faire? Certes, dans un premier temps, ce qu'il serait supposé faire c'est pas d'autocritique sur son vocabulaire. Mais maintenant qu'il nous en a gratifié, comment va-t-il rétroactivement dédire chaque occurrence de "faggot" dans son passé? Je ne sais même pas qui est le plus pathétique entre les gayzelles horrifiées par le langage de Matt Damon (comme les parents qui disent à leurs gosses "language!") et Matt Damon lui-même. -
Ouch. Vu toutes les conneries qu'ils publient, à la place de Mucchielli je serais vexé.
-

L'un des 5 libéraux français arrive pour grossir les rangs
Vilfredo a répondu à un sujet de Airgead dans Forum des nouveaux
Il *faut* que je me souvienne de dire ça à quelqu'un IRL quand l'occasion se présentera -
J'aime bien les mariages. C'est seulement au matin d'un mariage que j'ai eu l'occasion de manger des pizzas froides au petit déjeuner. C'était bizarre mais c'était bon.
-

L'un des 5 libéraux français arrive pour grossir les rangs
Vilfredo a répondu à un sujet de Airgead dans Forum des nouveaux
On a tous notre petit côté Pinochet -

L'un des 5 libéraux français arrive pour grossir les rangs
Vilfredo a répondu à un sujet de Airgead dans Forum des nouveaux
Mmmhhh? -
Cela dit je suis d'accord avec @cedric.org sur le fait qu'il est possible de distinguer l'obligation morale de l'obligation politique. Mais même moralement ça ne tient pas.
-
Bah non il a raison. A partir de quel ratio commence la responsabilité?
-
La question que je me pose est: est-ce que la "valence morale" de l'action est une propriété de l'action ou de l'agent (quoiqu'on puisse rabattre le second ensemble sur le premier et vice-versa, surtout dans un cadre virtue ethics)? La raison pour laquelle je pose cette question est qu'il y a une tendance à définir un archétype d'agent moral (l'homme de bien e.g.) qui fonctionne, dans la théorie morale en question, comme une simulation, dans la mesure où son trait distinctif est: faire de bonnes actions, et à ce titre, il devient effectivement archétypique. Je parle de simulation parce que la manière dont ça fonctionne est: je prends un individu, je lui fous en 'attributs' whatever I need pour le faire agir moralement, et une fois que je l'ai programmé pour agir moralement comme on remonterait une petite voiture, je le laisse évoluer et je regarde. C'est tautologique et ça ne fait que déplacer le problème d'un cran si l'on se demande ce qu'il faut faire ou pas faire, mais ça change l'orientation de la réflexion si on cherche où regarder pour identifier dans le monde réel ce qu'est une bonne action. Dans une perspective un peu NT, je crois que c'est cette fonction archétypique qui est remplie par les saints et, avant, par les exempli latins (Plutarque, la Vie des hommes illustres), de façon radicalement inutile en fait, parce que le problème de l'application de l'action à des circonstances différentes, ou du degré auquel l'action peut-être abstraite (quelque chose qui ressemble à la question: "y a-t-il une "action" indépendante des circonstances? ce qui nous déplace de la métaéthique à la métaphysique, puisque c'est la même question que: y a-t-il quelque chose comme le concept de "chien" ou une différence entre "chien" et "tel chien" etc.?) reste entier. Cela dit, pour être honnête, ce problème est en fait au coeur de la casuistique... à laquelle je ne connais malheureusement rien Je remonte à la question qui occupe ton oisiveté: la première chose qui me vient à l'esprit est une analogie avec une théorie de la vérité qui dirait quelque chose comme: est vrai un fait dont l'occurrence me force à produire un jugement vrai à son propos. Par exemple: si une version radicale du déterminisme matérialiste (:= absolument toutes nos actions sont déterminées par des réactions physiques et, pourquoi pas, programmées dans notre essence individuelle à notre naissance) est vraie, alors elle l'est aussi nécessairement, et donc dans le jugement porté sur la théorie est déjà déterminé par la théorie. J'imagine un truc pareil pour une théorie de l'action morale. C'est pas absurde pour une classe d'actions mauvaises (je pense aux explications darwiniennes du dégoût, et JBP aurait des choses à dire sur le rapport de tout ça avec le péché originel) mais surtout ça réconcilie l'interrogation sur la nature de l'action avec celle sur la nature de l'agent: une action bonne est telle qu'elle est nécessairement considérée comme bonne, voire réalisée, par un homme (de nature) bon. Si je reprends mon analogie avec la théorie de la vérité, la valence des actions serait un être ontologiquement accessible uniquement à certains êtres comme... les êtres bons. Donc généralisable, dans une certaine mesure, et par définition pas universalisable, parce que les hommes ne sont pas tous égaux. Que ce soit généralisable ne veut pas dire qu'on ait la recette pour le généraliser. Le jugement sur l'action 'bonne' n'étant accessible qu'aux hommes 'bons', à partir du moment où l'un des attributs de 'bon' est le souhait de généraliser l'action, le souhait de généraliser l'action est une conséquence de sa constitution. Ça peut se comprendre dans une perspective à la Nietzsche où les théories morales sont des systèmes de valeurs qui sont tout ce qu'il y a de plus réel, et par là façonnent, au niveau biologique, notre perception du monde. A cet égard, les métaphores qui tournent autour de l'idée de perception et de myopie dans N sont légion (un seul exemple dans Le Cas Wagner: "on ne réfute pas le christianisme, on ne réfute pas une maladie des yeux"). Cette contrainte déterministe qui te force à reconnaître la bonté de l'action morale quand elle se présente à toi pourrait être un sens de l'expression 'loi morale' non pas de façon analogue à la loi juridique, qui peut toujours être désobéie, mais à la loi physique, du coup. On pourrait l'appeler 'la loi des corps moraux'. La modernité a vraiment foutu le bordel en distinguant les faits et les valeurs. That's my theory Le problème maintenant, c'est que ça n'empêche pas d'autres hommes de produire des jugements moraux positifs sur des actions qui ne le méritent pas. On peut toujours botter en touche analytiquement et dire que bah ce sont pas des vrais jugements moraux positifs alors, mais le problème est que ça y ressemble drôlement. Je ne suis pas sûr que ce soit un gros problème cela dit: l'autre point commun entre la valeur de vérité d'une proposition et la valence morale d'un jugement est qu'elles présupposent l'intention de l'agent, donc oui on peut produire des propositions vrais sans s'en rendre compte ou par hasard (c'est le fameux Gettier problem) mais ça n'empêche pas l'ensemble de la théorie de fonctionner. Par ailleurs, si qqn produit un jugement moral erronné, la discrepancy entre ce qu'il dit et ce qu'il fait apparaîtra à ceux à qui elle est 'accessible' et ne cessera donc pas d'exister (pour eux (après on peut avoir un débat pour savoir si des choses existent quand personne ne peut les voir... je ne cesse de me poser la question)). Ça pose quand même un risque dans la théorie, ces faux jugements moraux. Du coup le facteur que je voudrais interroger est la valence morale du prédicat 'généralisable'. On pourrait par exemple considérer que le souhait de généraliser une action, même bonne, est moralement mauvais, précisément à cause du risque de se tromper. Une sorte de prudence épistémologique appliquée à l'action morale. Je fais encore un peu du Nietzsche pour NT avec son histoire de créer ses valeurs, qui coupe l'herbe sous le pied, là aussi, à toute généralisation (Le Gai Savoir, 335). On retombe donc sur une théorie de la nature de l'agent comme présupposée par l'action: un agent est défini comme un être tel qu'il est capable de produire plutôt tel ou tel type d'action, c'est pourquoi la plupart des attributs moraux sont des termes dispositionnels. Je pense un peu à Ryle ici, dans la mesure où il écrit que ce qui est apprécié dans une action est le savoir-faire (skill) qu'elle manifeste. Personne ne conteste qu'une action soit réelle (au sens néopositiviste bateau), mais le savoir-faire n'est pas occulte non plus, pas plus que n'importe quelle disposition en fait (prenons 'soluble' par exemple). Le propre d'une disposition est de se manifester naturellement dans un certain contexte: c'est même la définition logique d'une disposition, et c'est la forme que prennent les énoncés de réduction bilatéraux qu'utilise Carnap dans Testability and Meaning pour réduire 'soluble' en termes observationnels. Donc si on pousse jusqu'au bout mon naturalisme moral, il doit exister une manière de formuler des énoncés de réduction bilatéraux pour 'courageux' et 'bon' de façon analogue à 'soluble' sans qu'on ait à se préoccuper activement de la possibilité d'une généralisation du comportement individuel comme critère définitoire de la valence morale de l'individu agent. Maintenant une raison de ne pas valuer positivement le prédicat 'généralisable' (qui a à voir avec mon point métaphysique du début sur la difficulté d'abstraire une action comme on ferait pour un concept: la différence évidente est que l'action n'est pas là dehors, elle est effectuée par un agent, et l'agent est tel qu'il est disposé à effectuer tel type d'action): je suis profondément convaincu que la bonne action dans le dilemme du trolley est de changer de voie et de causer proximalement la mort d'un ouvrier. La raison pour laquelle je pense ça est que cette action n'est pas un meurtre, dans la mesure où mon intention n'est pas de tuer l'ouvrier. On peut vérifier ça (dispositionnellement) en imaginant le contrefactuel où l'ouvrier saute au dernier moment de la voie et échappe à la mort. Dans la 'simulation', est-ce que je dégaine alors mon fusil à lunette pour achever le sonofabitch pendant qu'il détale? Non. Si on revient donc à la première 'simulation', celle où il meurt, force est de constater que, comme je suis la même personne dans cette simulation (ou ce monde possible, pour prendre une terminologie plus morale) que dans l'autre, je ne suis pas un meutrier et donc mon action n'est pas un meurtre (parce que, pour être bien clair, manque l'intention de tuer). Maintenant, qu'est-ce qui est généralisable dans ma bonne action? Bah franchement, j'en sais rien.
-
Oh et il y a l'épisode avec "Gaupette". Cette prostituée qu'il suit pendant des dizaines de pages dans la banlieue de Lyon. C'est presque une petite nouvelle en soi dans le roman, comme faisait Stendhal par exemple avec la Fausta dans La Chartreuse (inspiration évidente de Rebatet). Non vraiment c'est super horny comme bouquin.