-
Compteur de contenus
3 824 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
2
Messages postés par xara
-
-
16 hours ago, PABerryer said:
Je me rappelle du brillant succès de cette stratégie dans les années 1930...
16 hours ago, cedric.org said:Mince, grillé.
Ce n'est pas littéralement un point Godwin, mais cela a quelque chose en commun. D'abord, on l'aura bien compris, comme dans les textes de Bourdillon par exemple, il y a l'affirmation habituelle que l'ennemi est le nouvel Hitler, ce par quoi on entend un type spécial et son régime ayant évidemment pour projet d'envahir l'Europe, voire le monde. Premièrement, l'affirmation est typiquement avancée, répétée, sans même tenter de la justifier, et en ignorant tout simplement les événements suggérant autre chose, comme si c'était automatiquement l'explication plausible à l'intervention russe en Ukraine et la seule. On est censé la tenir pour évidente, comme la plupart des points factuels ou doctrinaux prêtant à controverse avancés par un Tenzer.
Deuxièmement, je ne vais pas me lancer dans un truc dont je ne suis sûrement pas spécialiste, mais un peu de réalisme devrait immédiatement suggérer que même pour la 2ème guerre mondiale, c'était surement un peu plus compliqué que Hitler, le mal incarné, contre les gentils autres qui vaquaient tranquillement à leurs occupations et n'ont bien sûr aucune responsabilité dans la guerre. Là, bien sûr c'est la 2nde guerre mondiale, tout le monde sait ce qu'il en est, le fantôme d'Hitler est un "conversation-stopper" avant même qu'elle ait commencé, donc hahaha, référence à la 2ème guerre mondiale, vous êtes réfuté.Mais en plus du fait qu'un peu de réalisme devrait immédiatement suggéré qu'avec des Etats, il y a généralement des chances qu'il y ait des coups tordus dans tous les sens, un peu de curiosité devrait le confirmer. On pourrait penser que des gens censés être un peu familier de la littérature servant souvent de références chez les libéraux de principe (pas les politiciens) ces dernières décennies (par exemple Taylor The Origins of the Second World War) pourraient au moins la prendre au sérieux, ne serait-ce que pour la réfuter, mais apparemment la référence maintenant, c'est plutôt le style LCI. Il suffit de répéter les mêmes clichés encore et encore en ignorant ou balayant d'un revers de main le reste et en brandissant les habituels hommes de paille et c'est bon. Mais ce n'est pas bon.
Il devrait être clair, par exemple, que se référer au caractère plus ou moins libéral ou illibéral en interne d'un Etat pour juger de ses responsabilités en politique étrangère est complètement naïf. Si l'on veut ramener tout ça à la période de la guerre froide, cela dit surtout quelque chose sur ceux qui le font. Quoi qu'on pense de la Russie d'aujourd'hui en interne, l'union soviétique à n'importe quel moment a certainement été plus totalitaire quand les Etats Unis d'Amérique étaient évidemment moins liberticides vis à vis de leurs résidents. Et pourtant il devrait être évident, pour un libéral ou pour n'importe qui de sensé, que le caractère relativement libéral et/ou démocratique des Etats-Unis ne les rendait pas automatiquement innocents en politique étrangère, même en comparaison avec l'URSS, et ne justifiait pas par exemple de napalmer des gamins vietnamiens, même dans ce contexte de guerre par proxy avec la maléfique union soviétique, que ce n'est pas une excuse (en fait que la seule question concernant les responsables est de savoir s'ils auraient dû finir leurs vies en prison ou être exécutés).
Pour une synthèse, non seulement des affaires russo-ukrainiennes, mais de l'histoire oubliée ou effacée -ou en tout cas plus compliquée- de la 2ème guerre mondiale, voir cet entretien avec l'excellent Scott Horton, figure actuelle du mouvement libéral américain (que je qualifierais d'authentique et par conséquent de non phacocyté par ce qu'on pourrait appelé le "CIA libertarianism":
https://youtu.be/bCyNbuz1DiE?si=RBNoMtCBGlUESk6Q-
 2
2
-
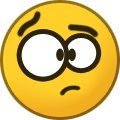 1
1
-
-
14 hours ago, cedric.org said:
Donc en gros comme les Américains ont mis de l'huile sur le feu par rapport à un état totalitaire avec veleités impérialistes, et comme les Américains sont mechants, ce n'est donc pas du tout la faute de la Russie et il faut complètement s'applatir et se laisser faire et jamais on aurait du permettre à des pays de sortie de la zone d'influence plus que néfaste de ce pays. L'idéal, en fait, c'est ce que veut la Russie, donc pas loin du rétablissement du Mur in fine.
Faites déjà un effort à représenter correctement la position de ceux que vous voulez contredire. Il n'y a rien à discuter autrement.
-
16 hours ago, Jensen said:
Parce que bien sûr ces régimes sont contraints par la vérité.
Même les US qui ont le 1er amendement et une presse libre ont réussi à faire avaler à leur opinion que l'Irak avait des armes de destruction massive, donc quand on me dit que la Russie ne pourrait pas faire mieux, j'ai peu l'impression d'être pris pour un con.
L'argument disant que Poutine n'aurait pas eu envie d'envahir l'Ukraine sans l'OTAN est recevable (je n'y crois pas vraiment, mais il est plausible), mais l'argument disant que Poutine avait très envie d'envahir l'Ukraine, mais qu'il aurait été bien embêté sans l'OTAN pour lui servir de prétexte est absurde.
Non, le point n'est pas que ces régimes sont contraints par la vérité, du moins pas directement. Le point est comme je l'ai dit qu'ils sont contraints par l'opinion publique. Les Etats "travaillent au corps" l'opinion publique pour les embarquer dans leurs aventures mais il est plus facile de les convaincre qu'il faut intervenir ici ou là lorsque l'Etat ciblé est effectivement menaçant que lorsqu'il ne l'est pas du tout. On se gargarise de la propagande russe, par exemple, mais les Etats occidentaux l'ont largement écrites eux mêmes en offrant au gouvernement russe sur un plateau une base crédible pour la construire. Il n'y avait pas grand chose à ajouter pour convaincre qu'il y avait besoin de mobiliser le pays dans la guerre. Sans cela, il faut créer à partir de rien toute une histoire, des attentats sous faux drapeau, etc. Ce n'est pas inconcevable, bien sûr, contrairement à ce que suggèrent tous les jours les contempteurs des "théorie du complot" (sauf quand ça peut nourrir leur récit tel Gérald Bronner annoncant sa commision anti-conspirationniste en dénonçant à l'avance des opérations secrètes de forces étrangères pour les élections à venir), mais c'est plus dur. -
On n'aura pas entendu parler de ça sur LCI, mais la volonté de déstabiliser la Russie (via l'Ukraine, entre autres) en la poussant à agir au-delà de ses moyens n'est pas une spéculation sauvage. C'est plutôt le genre de choses avancé ouvertement dans des rapports de la RAND Corporation par exemple (nombre des mesures dont le pour et le contre du point de vue de cet objectif sont là pesés ont été prises) dont voici un extrait de la préface et quelques éléments de sommaire:
QuoteThe purpose of the project was to examine a range of possible means to extend Russia. By this, we mean nonviolent measures that could stress Russia’s military or economy or the regime’s political standing at home and abroad. The steps we posit would not have either defense or deterrence as their prime
purpose, although they might contribute to both. Rather, these steps are conceived of as measures that would lead Russia to compete in
domains or regions where the United States has a competitive advantage, causing Russia to overextend itself militarily or economically or causing the regime to lose domestic and/or international prestige and influence. This report deliberately covers a wide range of military, economic, and political policy options. Its recommendations are directly relevant to everything from military modernization and force posture to economic sanctions and diplomacy; consequently, it speaks to all the military services, other parts of U.S. government that have a hand in foreign policy, and the broader foreign and defense policy audience.
(...)
CHAPTER THREE
Economic Measures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Recent Russian Economic Performance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Measure 1: Hinder Petroleum Exports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Measure 2: Reduce Natural Gas Exports and Hinder
Pipeline Expansions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
vi Extending Russia: Competing from Advantageous Ground
Measure 3: Impose Sanctions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Measure 4: Enhance Russian Brain Drain.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
CHAPTER FOUR
Geopolitical Measures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Measure 1: Provide Lethal Aid to Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Measure 2: Increase Support to the Syrian Rebels.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Measure 3: Promote Regime Change in Belarus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Measure 4: Exploit Tensions in the South Caucasus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Measure 5: Reduce Russian Influence in Central Asia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Measure 6: Challenge Russian Presence in Moldova.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
CHAPTER FIVE
Ideological and Informational Measures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pathways for Influence Operations.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Current Status of Russian Regime Legitimacy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Russian Domestic Environment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Policy Measures to Diminish Domestic and Foreign Support for the
Russian Regime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
CHAPTER SIX
Air and Space Measures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Measure 1: Change Air and Space Force Posture and Operations.. . . . . . . . 175
Measure 2: Increase Aerospace Research and Development.. . . . . . . . . . . . . . . 182
Measure 3: Increase Air and Missile Components of the Nuclear Triad.. . . 189
Recommendations .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
CHAPTER SEVEN
Maritime Measures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Measure 1: Increase U.S. and Allied Naval Force Posture and Presence.. . . 197
Measure 2: Increase Naval Research and Development Efforts.. . . . . . . . . . . 203
Measure 3: Shift Nuclear Posture Toward SSBNs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Measure 4: Check the Black Sea Buildup.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Contents vii
CHAPTER EIGHT
Land and Multidomain Measures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Measure 1: Increase U.S. and NATO Land Forces in Europe.. . . . . . . . . . . . . 214
Measure 2: Increase NATO Exercises in Europe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Measure 3: Withdraw from the INF Treaty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Measure 4: Invest in New Capabilities to Manipulate Russian Risk
Perceptions .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
C'est aussi le genre de choses contre lesquelles des pontes de la politique étrangère US (et non des propagandistes russes) ont mis en garde encore et encore, dès le début de l'expansion de l'OTAN vers la Russie, alors mêmes qu'ils n'avaient souvent pas d'objection de principe à l'interventionnisme néo-conservateur et sa façon de considérer le monde et ses habitants comme des pions à sacrifier sur un échiquier si cela peut avancer les intérêts de leur Etat.
Si les anglo-américains ont tout fait pour instrumentaliser l'Ukraine contre la Russie, avec le résultat qu'on connait, et que notre préoccupation n°1 est la minimisation des dégâts, "ce qu'on devrait faire avec la Russie aujourd'hui" et avec les autres devrait consister d'une manière ou d'une autre à promouvoir un virage à 180°. Par exemple, il semblerait que les gouvernements russe et ukrainien aient eu très vite des velléités de cesser le feu et négocier après que la guerre ouverte ait commencé, et que les sponsors anglo-américains de Zelensky lui aient signifié que non, il fallait se battre. Alors la première chose que les libéraux et partisans de la paix des pays occidentaux auraient à faire est de presser "leurs" gouvernements de ne se mêler que de ce qui se passe "chez eux" et ce cesser ainsi de fournir l'huile, les allumettes et probablement les chèques et promesses de villa en Californie pour la retraite des politiciens ukrainiens concernés. L'urgence, c'est l'arrêt des combats.
Pour cela ou par la suite immédiate, il s'agirait de donner à Poutine ce qu'il demandait raisonnablement -que n'importe qui d'autre à sa place voulant préserver l'indépendance de son pays aurait demandé comme preuve que ses ennemis déclarés depuis des années ne veulent pas la guerre- à savoir que les Etats de l'OTAN n'invitent plus l'Ukraine et autres pays ayant des frontières en commun avec la Russie à faire partie de l'OTAN (et tant qu'à faire les libéraux devraient convaincre l'opinion publique de réclamer de leurs gouvernants une sortie de l'OTAN et autres monstruosités du style OMS -s'assurer que la popularité des "globalistes" soit au plus bas). Et du côté des libéraux et partisans de la paix ukrainiens, de travailler l'opinion publique pour dire que le calcul, affiché par un conseiller de Zelensky connu sur le oueb comme ayant prévu la guerre comme un prophète alors qu'il expliquait que leurs propres choix allait la provoquer mais que c'était le choix à faire pour hâter l'invitation dans l'OTAN et l'UE pour éviter une domination totale de la Russie 10 ans plus tard, était une catastrophe pour l'ukrainien moyen et que c'est au contraire la neutralité qui maximise les chances de paix, en privant la Russie de tout prétexte pour faire la guerre sur ce sol.
Note: on ne laisse pas faire "ce qu'on veut" aux régimes concurrents par le non-interventionisme et la neutralité et on ne suppose pas que le reste du monde est bisounours. A la place, on prive ces régimes des menaces dont ils ont besoin pour mobiliser leur opinion publique en faveur d'une intervention militaire chez le voisin "pour se protéger" (pour rappel, selon La Boétie, Hume, Mises, etc. l'état de l'opinion publique fournit des limites à ce que les gouvernants peuvent se permettre de faire, quel que soit le régime politique en place, sans quoi ils n'auraient pas besoin de propagande). Je réalise que ça a l'air exotique de dire un truc pareil sur liberaux.org aujourd'hui mais c'est le genre de point de vue qui a défini la position libérale traditionnelle, incarnée notamment par les "pères fondateurs" des Etats-Unis.
-
 2
2
-
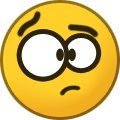 1
1
-
 3
3
-
-
1 hour ago, Adrian said:
Dans la route de la servitude Hayek écrit « dans aucun domaine l'abandon du libéralisme du XIXème siècle n'a coûté au monde aussi cher que dans celui ou la retraite a commencé : les relations internationales ».
Je crois que, dans les relations internationales, on est de nouveau dans un recul du Droit pour la force et Tenzer semble vraiment dans cet état d'esprit, et depuis des décennies ! On dirait des propos années 90.
Il aurait pu aussi s'inspirer de Kant et son projet de paix perpétuelle pour ses actions :
« Nul État ne doit se permettre, dans une guerre avec un autre, des hostilités qui rendraient impossible, au retour de la paix, la confiance réciproque »
Donc l'intensité des sanctions, les vols d'avoirs, l'expulsion de la Russie d'instance internationale, des traités internationaux etc sont contraire à cette maxime.
Puisque certains font comme si de rien n'était, bien que ce soit écrit noir sur blanc, j'ajoute qu'en matière "d'intensité des actions", voilà le genre de choses que Tenzer vend dans l'article susmentionné, saisissant la perche tendue par Viallet :
QuoteLa nécessité d’une intervention directe
[Viallet:] Les alliés de l’Ukraine soutiennent l’effort de guerre de l’Ukraine en aidant financièrement son gouvernement et en lui livrant des armes. Qu’est-ce qui les empêche d’intervenir directement dans le conflit ?
[Tenzer:] La réponse est rien.
Dès le 24 février 2022 j’avais insisté pour que nous intervenions directement en suggérant qu’on cible les troupes russes entrées illégalement en Ukraine et sans troupes au sol. J’avais même, à vrai dire, plaidé pour une telle intervention dès 2014, date du début de l’agression russe contre le Donbass et la Crimée ukrainiens.
-
1 hour ago, cedric.org said:
Ce qu'il dit, en résumé, c'est qu'il n'est pas deconnant d'assister un (ex ?) futur allié contre un envahisseur impérialiste aux antipodes du libéralisme, et que l'Europe devrait arrêter de se reposer sur les Américains pour leur défense. Je n'y vois pas d'illiberalisme. Malheureusement, et à cause d'une ou deux expériences dans l'histoire, la défense nationale est encore jugée comme faisant partie des domaines regaliens.
L'autre solution est de les laisser tous se démerder parce qu'après tout ce n'est pas chez nous. Pourquoi pas. Au risque de parler chinois dans deux generations.
Je l'accorde, il y a, surtout vers la fin, quelques écarts teintés de naïveté comme le fait de vouloir imposer des ultimatums aux pays liés à Moscou ou du saupoudrage de politiques d'investissement vers les pays en voie de développement (quelle originalité).
Laissez moi proposer à la communauté un critère ultra-minimal de libéralisme, fondé sur le traditionnel principe de "non-agression" ou "d'auto-propriété". En matière de politique étrangère, les décisions à soutenir sont celles qui évitent les boucheries de masse style 3ème guerre mondiale.
-
 2
2
-
-
Il ne m'avait pas échappé que la tendance à relayer favorablement le discours "NATO-friendly" n'était pas nouvelle, mais d'une part, un simple article n'engageait pas la rédaction comme une interview aux questions complaisantes et, surtout, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on lit dans CP que l'OTAN devrait faire la guerre à la Russie et qu'elle aurait même dû commencer en 2014 à l'occasion de "l'agression russe" d'alors (évidemment pour ces auteurs, il n'y a pas à discuter des indices que le coup d'Etat a été décisivement poussé par les Etats-Unis, et qu'il s'est agi de réprimer dans la violence toute vélléité de ne pas reconnaitre le nouveau gouvernement, autrement dit que c'est vite parti en guerre civile, ni même à fournir quelque preuve que l'Etat russe a alors conspiré en Ukraine).
Bref, on est sur LCI, version web.-
 2
2
-
-
Même pas caricaturable: https://www.contrepoints.org/2024/01/29/470876-nous-devons-mettre-en-place-une-diplomatie-de-guerre-grand-entretien-avec-nicolas-tenzer
Contrepoints promeut maintenant les pires va-t-en-guerre, au nom du libéralisme (comme on pouvait s'y attendre en lisant la déclaration d'intentions à la prise e fonction du nouveau rédac chef). C'est une réussite complète.-
 1
1
-
-
On 10/13/2023 at 8:41 PM, Rincevent said:
Hé, tu sais quoi ? Il y a plein d'autres gens qui bouffent au râtelier de la NED !
 (Oui, ça m'a beaucoup redpillé...)
(Oui, ça m'a beaucoup redpillé...)
https://mises.org/library/liberty-movements-pro-war-fifth-column
-
36 minutes ago, Rincevent said:
Hé, tu sais quoi ? Il y a plein d'autres gens qui bouffent au râtelier de la NED !
 (Oui, ça m'a beaucoup redpillé...)
(Oui, ça m'a beaucoup redpillé...)
Cute!
-
On 9/8/2023 at 9:06 PM, Rincevent said:
C'est bien de s'en rendre compte, mais ça aurait été mieux si les gens s'en étaient rendu compte, disons, dès 2015 ou avant encore.
Corollaire : toute la sphère du "fact checking" qui gravite autour des MSM ment aussi effrontément.
A lire absolument sur ce sujet:
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/guide-understanding-hoax-century-thirteen-ways-looking-disinformation
Also:https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/invasion-fact-checkers
QuoteThe IFCN was launched in 2015 as a division of the Poynter Institute, a St. Petersburg, Florida-based media nonprofit that calls itself a “global leader in journalism” and has become a central hub in the sprawling counter-disinformation complex. Poynter’s funding comes from the triumvirate that undergirds the U.S. nonprofit sector: Silicon Valley tech companies, philanthropic organizations with political agendas, and the U.S. government. The nonprofit sector, as it’s euphemistically called, is an immense, labyrinthine engine of ideological and financial activism that was valued at almost $4 trillion in 2019, the overwhelming majority of which is dedicated to “progressive” causes. The IFCN’s initial funding came from the U.S. State Department-backed National Endowment for Democracy, the Omidyar Network, Google, Facebook, the Bill & Melinda Gates Foundation, and George Soros’ Open Society Foundations.
With no formal membership, the IFCN acts as the high body for the dozens of fact-checking organizations grouped under its umbrella that have endorsed its code of principles. According to the organization’s website, its mission is “to bring together the growing community of fact-checkers around the world and advocates of factual information in the global fight against misinformation."En France, les signataires du code de conduite de l'IFCN sont:
-AFP
-France 24
-Les surligneurs
-Science Feedback
-LCI/TF1
-France Info
-20 Minutes
-Le Monde
-Libération-
 2
2
-
-
On 8/20/2021 at 3:20 PM, fm06 said:
Bouzou persiste. Sa conclusion est un sommet de mauvaise foi:
Il y a une phrase collector là-dedans:
"Que tous les grands pays démocratiques adoptent les uns après les autres ce même "sésame" devrait donner une indication sur le bien-fondé de la mesure, mais l'idéologie est tellement forte qu'elle empêche visiblement tout effort intellectuel, même minimal. "
-
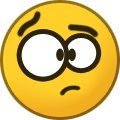 2
2
-
 1
1
-
-
Quelqu'un a-t-il accès aux articles pour abonnés de l'Opinion? J'aimerais bien lire celui-là en entier:
https://www.lopinion.fr/edition/politique/il-va-etre-temps-s-occuper-ceux-qui-refusent-vaccin-chronique-d-eric-243452 -
Coeur avec les pieds:
La vaccination obligatoire est une politique libérale!-
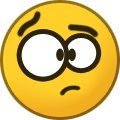 1
1
-
-
19 hours ago, Rincevent said:
Et le fait de ne pas avoir fait buter des millions de civils innocents pour asseoir son pouvoir, sans doute.

Une montagne de cadavres militaires et civils ne fait-elle pas partie de son bilan (sans parler du fait que la distinction entre civils et militaires perd beaucoup de son sens quand le gros des militaires sont des conscrits?-
 1
1
-
-
On 3/12/2021 at 10:37 PM, Axpoulpe said:
Chers liborgiens, comme j'ai le privilège de donner des cours d'introduction à l'économie à des Licence 1 de Droit, je veux leur donner quelques bases sur la méthodologie mais souvent je galère pour être assez clair et trouver les bons exemples. Dans mon propre cursus en éco-gestion je n'ai jamais eu un seul cours de pure méthodologie et ça m'a clairement manqué. Dans mon souvenir on nous apprenait à "faire" des choses (notamment des maths) mais on nous apprenait rarement pourquoi les faire, quelle était la logique de la recherche en économie et sa solidité. J'ai donc ajouté une section sur la méthodologie sans moi-même maîtriser en profondeur le sujet car je ne suis pas chercheur à la base.
A l'intérieur de cette section, voici une sous-section qui manifestement n'a pas été bien comprise par les étudiants, et j'aimerais y remédier notamment en donnant des exemples les plus concrets possibles. Si vous avez des suggestions d'exemples ou toute autre remarque permettant d'améliorer ce paragraphe (sans l'allonger ou presque) je vous serai très reconnaissant. Pour ceux qui seraient intéressés de lire l'ensemble du chapitre je suis preneur de tout feedback, en particulier sur le V (Méthodologie). Je mentionne @Tramp, @Vilfredo Pareto, @xara, @Domiqui auront peut-être des idées.
C - Inductivisme ou déductivisme ?
Une autre question importante à trancher dans toutes les sciences est le processus de découverte des connaissances scientifiques. La méthodologie de l’économie est une branche commune à la philosophie de l’économie et à la philosophie des sciences. Elle s’intéresse à la manière dont l’économiste acquiert, pourrait ou devrait acquérir des connaissances sur son objet d’étude.
En la matière deux approches s'opposent et se complètent : l'inductivisme et le déductivisme. On parle aussi d'empirico-inductivisme et d'hypothético-déductivisme car la première approche repose avant tout sur une observation préalable à toute théorie, tandis que la seconde élabore des hypothèses avant d'aller observer le terrain.
La première consiste essentiellement à détecter des régularités dans les données empiriques et à procéder ensuite par inférence généralisante. c'est pourquoi on a l'habitude de schématiser la méthode inductive en disant qu'elle consiste à aller du particulier au général.
La seconde méthode consiste à raisonner déductivement à partir d’hypothèses préalables. Le processus se décompose en trois étapes : 1. les hypothèses sont d’abord formulées et établies de manière inductive. 2. Les conséquences de ces hypothèses sont extraites par déduction. 3. Ces conséquences sont comparées aux données empiriques disponibles. Il faut insister sur le fait que les hypothèses qui forment le point de départ du raisonnement sont, elles, établies par inférence généralisante (ou déduites d’autres hypothèses encore, établies par inférence généralisante). Le terme d’ « a priori », qui renvoie le plus fréquemment, depuis Kant, à la propriété qu’ont des propositions de pouvoir être justifiées indépendamment de l’expérience, prête à confusion. La méthode a priori est en réalité une méthode d’induction indirecte.
La méthode déductive n’est pas propre à l’économie – selon John Stuart Mill, c’est elle que l’on emploie, par exemple, en mécanique. Elle s’impose à l’économiste parce que la méthode a posteriori n’est pas applicable à son domaine. L’inapplicabilité de la méthode a posteriori tient à deux caractéristiques fondamentales de l’économie : c’est une science non-expérimentale de phénomènes complexes. Les données empiriques (ou données de terrain, du monde réel) de l’économie proviennent essentiellement de l’observation, et non de l’expérimentation. Selon les déductivistes, de telles données ne permettent pas, en général, de procéder inductivement (ou a posteriori), à cause de la complexité intrinsèque des phénomènes en cause : trop de facteurs interagissent simultanément pour qu’on puisse espérer en extraire directement des régularités robustes ou des relations de causalité. Si l’on voulait par exemple établir qu’une législation commerciale « restrictive et prohibitive » influence la richesse nationale, il faudrait, pour appliquer ce que Mill appelle la « Méthode des Différences », trouver deux nations qui s’accordent en tout sauf dans leur législation commerciale. Si l’on veut procéder par induction directe, seule l’expérimentation est à même de démêler la complexité des phénomènes économiques, mais elle est exclue. On ne peut donc pas espérer justifier a posteriori les propositions économiques.
Toutefois les hypothèses à partir desquelles les économistes vont procéder par déduction pour aboutir à une théorie ne sortent pas de nulle part. En effet, l'avantage de l'économiste sur d'autres scientifiques est qu'il est lui-même une partie de son objet d'étude. Ainsi, sa propre expérience d'être humain dans ses aspects les plus universels et les moins discutables lui permet déjà d'établir quelques hypothèses qui ne demandent aucune vérification particulière. Par exemple, et sauf exceptions très particulières, l'être humain n'aime pas la douleur et met toute son ingéniosité à inventer des moyens d'y échapper, ce qui a des conséquences économiques certaines. Selon John Elliot Cairnes (1823-1875), ce sont des « faits d’expérience indiscutables » qui n’exigent pas d’investigation empirique supplémentaire. Ainsi, pour Cairnes, à la différence du physicien, « l’économiste part avec une connaissance des causes ultimes » des phénomènes qui l’intéressent. Cela nous ramène à l'idée développée plus haut et selon laquelle l'activité économique est consciente, délibérée, et vise à accomplir des objectifs en y allouant des moyens.
L'économiste français Edmond Malinvaud (1923-2015) est aussi partisan de la méthode déductive, mais dans une version un peu modernisée : « L’impossibilité d’expérimenter, jointe à la complexité et à la variabilité des phénomènes, rend l’induction à partir des données collectées plus difficile et moins fiable, tandis que la connaissance directe que nous pouvons avoir des comportements, des contraintes et des institutions permet à la déduction de s’exercer avec une certaine assurance. ». Autrement dit la déduction n'est pas une méthode parfaite, mais l'induction étant impossible, nous devons nous en contenter. De fait, la méthode déductive semble intéressante et acceptable si et seulement si une grande attention est prêtée à la fiabilité des hypothèses fondamentales et des hypothèses perturbatrices (celles qui viendraient fausser le résultat obtenu à partir des hypothèses fondamentales).
Si une grande partie des travaux d'économistes au XXème siècle reposent au moins en partie sur une approche déductive, l'inductivisme connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, en particulier au travers des disciplines que sont l'économie expérimentale et la neuroéconomie.
Voici une brève description de la première par Mikaël Cozic (2014)" Pendant longtemps, la conception dominante a été que l’économie était exclusivement une science d’observation, et non une science expérimentale. Mais depuis une quarantaine d’années, l’économie expérimentale, se développe progressivement. Le Prix de la Banque de Suède (dit « Nobel ») 2002, attribué aux expérimentateurs D. Kahneman et V. Smith, témoigne de ce développement, et de sa reconnaissance par la communauté des économistes. Le nombre et la variété des travaux expérimentaux sont désormais considérables, comme en témoignent le Handbook of Experimental Results de Smith et Plott [2008] ou le Handbook of Experimental Economics de Kagel et Rott [1995]. Les expériences portent en effet aussi bien sur la décision individuelle et les marchés que les interactions stratégiques. Par ailleurs, elles peuvent être de laboratoire ou de terrain (field experiments). Dans les premières, les sujets évoluent dans un contexte (fixé par la tâche qu’ils doivent accomplir, les informations qu’ils peuvent recevoir, les biens qu’ils considèrent, etc.) qui est largement artificiel, tandis que dans les secondes, on se rapproche d’un environnement naturel".
Vernon Smith, auquel il est ici fait allusion, est par exemple l'auteur d'expériences visant à vérifier la théorie du prix d'équilibre. C'est le type de concept qui se prête plutôt bien à l'expérience, puisqu'on peut fixer un objectif aux participants, leur confier une somme d'argent réelle ou fictive, et voir à quel prix les biens finissent par s'échanger dans l'expérience. C'est ainsi que Smith a pu démontrer la très large validité de la théorie du prix d'équilibre.
Voici enfin ce qu'écrit Cozic à propos de la neuroéconomie : "La neuroéconomie, née au début des années 2000, a pour but d’explorer les bases cérébrales des comportements économiques. Pour ce faire, elle emploie les méthodes et les outils des neurosciences contemporaines, notamment l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (voir Glimcher et al. [2009] pour un état de l’art encyclopédique). Par exemple, McClure et al. [2004] soumettent des choix entre deux options à gains monétaires retardés. La première option (sooner-smaller) rapporte la somme R après le délai d et la seconde (later-larger) la somme R ′ après le délai d ′ , avec d < d ′ (où d est aujourd’hui, dans deux semaines ou dans un mois) et R < R ′ . Les auteurs mettent en évidence que (a) le système limbique est préférentiellement activé quand la première option met en jeu un gain immédiat ( d = aujourd’hui), (b) le cortex pariétal et préfrontal est uniformément engagé dans la tâche (quelle que soit la valeur de d) et (c) une plus grande activité du cortex pariétal et préfrontal est associée à un choix de la seconde option plutôt que de la première."
En termes plus courants, il s'agit de démontrer que notre cerveau nous joue des tours, en ce sens qu'il nous pousse à certaines décisions en dépit de la pure rationalité dont nous aimerions nous prévaloir et que les économistes néo-classiques tiennent très (trop ?) largement pour acquise, par exemple en privilégiant les choix qui impliquent un gain immédiat.
En conclusion de cette sous-partie, il ne nous appartient évidemment pas de trancher entre ces différentes méthodes mais il nous apparaît utile de les présenter, car de leur compréhension découle l'explication de beaucoup des désaccords et controverses qui agitent le monde des économistes.
Le problème, je pense, c'est que ton article source (le Cozic) est difficile -a des ambitions bien plus élevées que ce dont on a besoin pour une introduction- et prête facilement à confusion en conséquence.
Donc tu parles d'inductivisme vs déductivisme au début, suivant une description de Mill mentionnée par Cozic et assimile ce déductivisme à "hypothetico-déductivisme" qui se réfère habituellement à la démarche mainstream à la Popper. Mais du coup des positions "proto-misesiennes" à la Cairnes se retrouvent dans le même panier que ce mainstream alors que ce mainstream considère l'ancien mainstream proto-misesien comme largement non scientifique. Et puis la méthode déductive à la Cairnes a l'air d'être commune dans le paysage contemporain. Mais qui fait ça aujourd'hui à part les partisans de la praxéologie?
Vient ensuite l'économie expérimentale qui constituerait un renouveau de l'inductivisme (on n'a pas eu d'exemple de qui était inductiviste jusqu'à présent) mais dans le même souffle on apprend que Vernon Smith teste des théories avec la démarche expérimentale, ce qui constitue en fait une caractéristique de la méthode habituelle hypothético-déductive auparavant assimilée au déductivisme... De plus dans la citation de Cozic il nous dit que pendant longtemps l'économie était une science exclusivement d'observation et non expérimentale, ce qui n'aide pas à comprendre. Même en revenant à la source et en ayant survolé tout son article, je ne comprends pas ce qu'il dit. Si avant l'avènement récent de l'économie dite expérimentale, tout n'était qu'observation, quid des méthodes déductives dont il a fait grand cas auparavant?
Bref, pour ma part, quand il s'agit d'aborder ce genre de questions en cours, je vais au plus simple:
Les économistes professionnels aujourd'hui disent suivre majoritairement une méthode hypothético-déductive selon les critères de scientificité de Popper. Autrement dit, ils ont tendance à considérer que la méthode pour l'économie est grosso modo la même que pour les sciences naturelles. Là dessus je décris une expérience la plus simple possible de laboratoire (faire de l'eau avec des atomes d'hydrogène et d'oxygène) et décris un exemple simplifié de dérivation d'une loi économique quelconque selon la même démarche. Puis je vais décrire brièvement des difficultés de cette méthode et les attitudes des dissidents face à ces difficultés, d'une part les "hétérodoxes" héritiers de l'école historique allemande bien représentés en France qui nous expliquent qu'en fait, on ne peut pas trouver de lois économiques, et d'autre part le retour à ce qu'on faisait auparavant de manière plus ou moins consciente, la "praxéologie". Et si je suis chaud comme la braise, je leur explique à propos de cette dernière que ce genre de démarche remonte à Aristote et que c'est pas un truc de tapettes. -
Food for thought:
QuoteThe ZeroCovid proponents do not address the reality that China, Australia, and New Zealand have continually had to implement lockdown policies in response to new cases arising even after declaring victory over the virus
-
 1
1
-
-
8 hours ago, Rincevent said:
@Antoninov : pas forcément besoin qu'un raisonnement soit tenu explicitement pour que les gens agissent de la sorte.
Je suppose que c'est un résultat connu en économie de la famille ? Peut-être @xara a-t-il des pointeurs vers la littérature dédiée.
Oui, le truc est connu dans la littérature en tant que "old age security motive for fertility". Je ne suis pas spécialiste mais ça a l'air d'être pris au sérieux en démographie et en sociologie. Chez les économistes aussi avec la conséquence qu'on peut développer l'argument en termes de "free rider" que j'ai utilisé quand on introduit le système de répartition obligatoire. Evidemment aujourd'hui on veut tester tout ça économétriquement et une étude à grande échelle de 2005 dans une revue réputée prétend avoir des résultats très robustes.
J'ai d'ailleurs demandé à un de nos éditeurs préférés d'insérer en lien cette brève revue de littérature qui repose notamment dessus, histoire qu'on ne prétende pas que je sors tout ça d'un coin obscur de mon anatomie.-
 1
1
-
-
4 hours ago, Mathieu_D said:
"Le sort du futur retraité en dépendant aussi moins qu’avant, l’investissement dans l’éducation des enfants qui naissent néanmoins baisse."
Je n'envoie pas mes enfants à l'école pour qu'ils aient les moyens de s'occuper de moi plus tard.
Bah, personne ne dit qu'il n'y a jamais eu d'autres raisons de faire des enfants. Et ça pourrait tout aussi bien illustrer mon propos: il y a moins de raison aujourd'hui d'envoyer ses enfants à l'école pour qu'ils aient les moyens de s'occuper de soi plus tard.
Surtout, quel rapport avec "on s'en fout des gosses on aura une retraite plus tard" quand je dis là précisément qu'on a une source de financement des retraites qui se tarit? -
9 minutes ago, Mathieu_D said:
J'ai bien aimé l'article sauf le passage sur l'éducation que je n'ai pas compris visiblement.
(mais si moi j'ai compris "on s'en fout des gosses on aura une retraite", probablement que d'autres aussi)
La question est: comment as-tu réussi à comprendre cela? -
11 hours ago, Largo Winch said:
Excellentissime article de xara : https://www.contrepoints.org/2020/01/07/361775-2-contradictions-internes-au-systeme-de-retraites-francais
Tout y est.
Merci!
8 hours ago, Mathieu_D said:Dans ce sens je veux bien, même si ce n'est pas si clair dans l'article. (qui penche un peu trop vers le "on s'en fout des gosses on n'aura plus besoin d'eux plus tard, yolo !")
???!
-
On 10/31/2019 at 10:39 PM, Cortalus said:
Pour moi, les Flower Kings sont avec Spock's Beard l'un des groupes séminaux du renouveau prog à partir des années 90 (plus Dream Theater du côté metal). Un nouvel album est donc toujours un évènement.
Nous sommes d'accord. A mon avis TFK (et autres groupes/projets associés) n'ont rien à envier aux groupes phares des années 70, si ce n'est d'avoir inventé les idiomes dont ils s'inspirent.
Pour ceux qui ne connaissent pas, en vrac (leur leader Roine Stolt est un mélodiste hors pair):-
 1
1
-
-
J'ai fini par me laisser séduire par Big Big Train (fituring Nick D'Virgilio, ex-Spock's Beard)
-
No Cohen-Dumouchel ni Geyres ne maitrisent leur sujet, et enchainent même quelques énormités sur le ton on ne peut plus sérieux de ceux qui sachent. Par dessus le marché, le dernier article commentant le débat les traite comme des gens sérieux représentatifs des supposés courants qu'ils défendent. N'importe quoi.



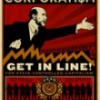
[Sérieux] Guerre en Ukraine
dans Europe et international
Posté
Ca fait au moins 20 ans que Poutine parle de la menace de l'OTAN, dans les meetings internationaux, comme dans la communication destinée au peuple...