-
Compteur de contenus
3 824 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
2
Tout ce qui a été posté par xara
-
C'est sur ce genre de passage qu'on voit que sa posture de philosophe est une farce. Il n'y a aucun lien logique entre la liberté négative et le reste. Soit il le sait et il s'agit d'une manoeuvre stratégique malhonnête, soit il ne le sait pas et il est gland.
-
Sur le plan de l'anecdote, on peut aussi noter que la thèse du "caractère extrêmement intolérant" de Mises est basée sur deux anecdotes et que Friedman ne nous dit jamais à quoi Mises réagissait précisément. A la place il nous dit qu'on peut difficilement appeler Robbins, lui même et d'autres membres de la Mont Pèlerin des socialistes. Mais dans n'importe quelle conversation comme celles qu'on peut avoir ici, on pourra avoir des gens qui généralement défendent des positions libérales et qui défendront une proposition sur la base de prémisses étrangères. Là on aura quelqu'un qui, dans le contexte, a d'excellentes raisons de pointer du doigt la chose. Mais Friedman ne nous fournit pas le contexte et on pourra, si on fait comme lui, évacuer l'objection par une pirouette. Par ailleurs, Friedman nous laisse dans le vague sur ce qu'il entend exactement par "intolérance" mais je note que contrairement à Mises qui n'avait pas pour habitude de parler des personnalités des uns et des autres, Friedman a répété à l'envi cette histoire dans plein de conférences. Et en terme d'attitude, quand on l'écoute et en particulier quand on voit comment il s'adresse à des interlocuteurs, il ne donne pas l'impression de "ne pas savoir" et d'avoir quelque chose à apprendre d'eux (ça c'est pour "l'humilité").
-
Deux choses ici, sur l'humilité (je sais que je ne sais pas) qui fonderait le libéralisme et la position épistémologique de Mises qui mènerait à une certaine "intolérance". Sur l'humilité et le libéralisme: Déjà, si on ne doit pas interférer dans les choix de quelqu'un parce qu'on n'est pas sûr qu'il a tort, pourquoi ça ne s'appliquerait pas aussi au choix de la violence? Ensuite, et ce n'est pas Friedman qui dira le contraire, il y a quantités de choix dans le marché libre chéri de Friedman qui sont basés justement sur l'idée qu'on croit savoir que quelqu'un d'autre sait mieux que moi (je consulte un spécialiste de X ou Y, des labels émergent fournissant des informations aux ignorants en mettant leur réputation en jeu, etc.) donc cette question semble pour le moins orthogonale à ce qui le préoccupe ici et ça la fout mal lorsque le fonctionnement normal de ce que tu défends est basé sur une prémisse dont la négation est censée être décisive pour ta défense. Par ailleurs, tout au plus, son critère ne servirait à objecter contre la coercition que lorsque celle-ci est basée sur la croyance de l'agresseur qu'il sait mieux que sa victime. Mais ce n'est pas un prérequis à l'existence de l'agression. Sans cette croyance, reste toujours le problème central: les ressources sont rares et tout le monde n'a pas forcément envie d'en faire la même chose. Et même en présence de cette croyance -qui peut bien être correcte- depuis quand l'agresseur est censé avoir quelque chose à foutre de ce qui est bon pour sa victime? Ce n'est pas forcément son problème. Sur la praxéologie de Mises et l'idée que le "rejet de l'expérience et des faits" conduit à un dogmatisme intolérant car il empêcherait de trancher un désaccord entre deux personnes, même entre deux praxéologistes: C'est extrêmement faible. Il n'y a bien sûr jamais de garantie que deux personnes tombent d'accord. Et alors que des praxéologistes peuvent se pointer du doigt une erreur de déduction par exemple, ce sont les adeptes du positivisme friedmanien qui ont toujours une excuse à disposition pour ne pas être convaincu par d'autres positivistes, étant donné qu'une proposition scientifique demeure à jamais hypothétique pour eux (ce qui invite au passage à renouveler à l'infini les expériences en tout genre, y compris d'ingénierie sociale, au mépris de la "tolérance" libérale). Il n'y a pas plus de raison pour un praxéologiste que pour un autre de se mettre sur la gueule. Je passe sur l'idée que la position de Mises impliquerait une sorte de croyance en une infaillibilité du praxéologiste, qui est un non sequitur flagrant. Plus important, cette façon de présenter les choses préjuge justement de la réponse à la question de savoir comment on établit que telle ou telle proposition est vraie, comment on établit un "fait", ce qu'une "expérience" nous apprend ou non. Dès lors qu'on retire les procédés rhétoriques douteux, il reste ceci: des gens sont en désaccord en épistémologie, et certains d'entre eux éludent la question grâce à un raisonnement circulaire et une attitude parfaitement dogmatique illustrée par la récente controverse lancée par Cahuc et Zylberberg. Car le constat empirique flagrant, si on veut se prêter à l'exercice de Friedman consistant à corréler une thèse épistémologique et une attitude, est que les C&Z, reflétant l'attitude qui prévaut aujourd'hui en économie, tiennent pour acquis leur thèse sur ce qu'est une approche scientifique sans daigner réfuter les autres approches. Toute leur thèse consiste à dire: des mecs n'adoptent pas le positivisme, ce dogme que nous n'avons pas besoin de défendre tant il est évident en soi, donc ils ont tort (et donc il faut se débarrasser des 10 mecs qui ont réussi à avoir un poste universitaire malgré ça).
-
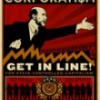
Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
xara a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
En plus court et informé par des considérations "austro-libertariennes": https://mises.org/library/short-history-man-progress-and-decline La discussion qui a particulièrement retenue mon attention est celle sur l'invention de la famille. -
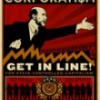
Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
xara a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
Après une brève recherche, j'ai l'impression que ça se fait en Chine, et pas forcément dans l'idée de corrompre les profs (offrir des cadeaux, pas sucer des b...) Je ne sais pas s'il y a une politique prévue à ce sujet dans nos universités françaises (au sujet des cadeaux, pas des fella.....) -
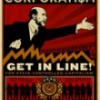
Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
xara a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
Dernier cours du semestre avec ma chinoise: elle m'offre un cadeau!!! -
Le monopole de la force, cela veut dire que tous les participants ne sont pas engagés dans une relation contractuelle, et donc qu'ils n'adhérent pas tous en ce sens là (ils "adhèrent" dans le sens où, comme aujourd'hui, ils se soumettent face à la menace de l'usage de la force). S'ils adhérent vraiment tous, c'est qu'il n'y a pas monopole de la force, c'est "l'anarchie" (il ne faut pas confondre la situation où il y a un seul fournisseur d'un service de protection soutenu par des clients volontaires dans une région avec un monopole de l'usage de la force, interdisant toute concurrence dans ce domaine sur le territoire revendiqué). On est en pleine équivoque. Que tu te réfères à l'absence de monopole de l'usage de la force ou à autre chose, il est difficile de voir ce que la "minarchie" vient faire là-dedans. Dans le premier cas, c'est ce qu'on appelle normalement "anarchie" et dans le second, puisque tu dis toi-même que la minarchie peut se décliner en divers arrangements institutionnels, pourquoi évoquer le tout sous un terme -minarchie- qui s'appliquerait à un des arrangements possibles à l'intérieur? C'est comme si tu disais que dans l'espèce "chien", il y a des bulldogs, des caniches, des bergers allemands et des chiens. C'est confus. Ce n'est pas une pique gratuite. Cela illustre mon propos ci-dessus. On se gargarise de labels qui tiennent des choses pour acquises -leurs significations- qui manifestement ne le sont pas après des années d'échanges sur le sujet. L'objet du fil a été largement détourné par ma faute. Donc bienvenue Romy.
-
Le monopole de l'usage de la force implique au moins ("minarchie") qu'il s'arroge le droit d'être l'arbitre ultime en matière de conflits sur le territoire revendiqué et que ses sujets paient des impôts (paient pour ses "services" de tribunaux/police sous la menace). Le "droit de sécession" veut donc dire que la menace n'est plus exercée, que ce soit pour financer les activités de l'ex-monopole ou lorsque quelqu'un s'adresserait à un arbitre non assermenté par l'ex-monopole pour trancher un conflit. Est-ce que ce n'est pas considéré comme le B.A.BA en un lieu où l'on parle d'anarchisme vs minarchisme comme si il allait de soi qu'on savait de quoi on parle?
-
Ca veut dire quoi "appliquer l'anarchie"? C'est un modèle d'organisation "l'anarchie"? J'appelle "anarchie" de manière absolument pas originale l'absence d'Etat. J'appelle "Etat" de manière absolument pas originale un monopole de l'usage de la force sur un territoire donné. Partant, s'il y a droit de sécession illimité, il n'y a plus d'Etat. Le monopole est dissout. La seule façon de "ne pas appliquer l'anarchie" étant donné les définitions habituelles, c'est de refuser le droit de sécession au moins à certains.
-
Si dans ta minarchie, il y a de la minarchie mais pas que, c'est qu'il doit y avoir un truc pas net sur la définition du terme. Le fait est que pour qu'il y ait un Etat selon la définition habituelle, fût-il une minarchie, il ne peut pas y avoir de droit de sécession illimité. Droit de sécession illimité, c'est la dissolution de l'Etat, c'est l'anarchie. Et que des contrats de copropriété à l'intérieur aient une forme ou une autre n'y change rien.
-
Ca s'appelle l'anarchie
-
C'est trop près! Je crois surtout que lorsqu'on y réfléchit, on réalise que cette question sur la sensibilité politique est la dernière roue du carrosse. Que la réponse devrait être la conséquence d'une réflexion en long, en large et en travers. Et donc qu'on était con d'être obsédé comme on le voit si souvent ici par cette question d'étiquette comme premier marqueur de ce qu'on est (étiquette du coup adoptée au feeling avant d'avoir fait le boulot qui permettrait de juger en connaissance de cause). En parlant de soupçons d'ailleurs, je soupçonne que cette obsession est surtout le reflet d'un certain narcissisme "hé les gens, JE suis ceci, JE suis cela", comme l'ado qui montre ostensiblement ses gouts avec mon t-shirt Metallica/Whatever, jusqu'au jour où, s'il grandit, il se rend compte que tout le monde s'en branle, sauf contexte très particulier, et que ça n'impressionne que les autres ados narcissiques. Cette obsession explique, je pense, les "vérités" inventées dans les discussions sur ces étiquettes. J'entends par là qu'en dehors d'un microcosme d'obsédés, on aura bien du mal à trouver des distinctions entre "libéralisme classique" et "minarchisme" par exemple dans la littérature sérieuse. Ca ne prend que dans le cadre de ces discussions où on ressent le besoin de se démarquer, comme l'ado ci-dessus ou le militant LGBTQWXYZ qui se gargarise de son "identité", au point d'inventer des distinctions qu'on ne définit même pas. Le seul truc de base à bien capter pour éviter des malentendus est que "libertarian" est bien le terme anglais pour "libéral". Le reste est très largement superflu et ne cesse éventuellement de l'être que dans le cadre d'une discussion entre des gens qui ont fait leurs devoir à la maison avant de causer des problèmes spécifiques auxquels des distinctions plus fines peuvent se rapporter. Finalement, le truc à capter est que cette histoire d'étiquettes est largement une distraction qui invite à en rester au niveau le plus superficiel et constitue donc un obstacle à une réflexion sérieuse.
-
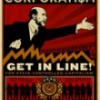
Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
xara a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
Les canadiens, c'est normal, ils ne sont pas comme nous. -
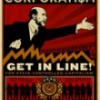
Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
xara a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
J'ai une élève qui m'a récemment envoyé une invitation sur Facebook... Je l'ignore mais ça m'a bien fait marrer de voir sa photo de couverture avec des nounours. Elle est chinoise. Peut-être que ça se fait là bas. -
Bien que Peterson ne soit pas économiste, il a tout de suite vu que c'est crétin même du point de vue des objectifs annoncés, que les transsexuels se sentent plus intégrés. Car cela implique que le simple fait de s'adresser à quelqu'un implique un risque légal, d'autant plus que le texte semble apparemment indiquer que même une "discrimination" non intentionnelle serait punissable. Un économiste doit voir tout de suite le genre de conséquences que ça peut avoir. Si on soupçonne à son allure que quelqu'un est transsexuel, on aura d'autant moins de raison de lui adresser la parole. On aura un intérêt qu'on n'aurait pas autrement à l'éviter.
-
Le débat de samedi:
-
Bah justement, qui peut comprendre ce que "liborg" peut bien vouloir dire à part quelqu'un qui est déjà familier du forum?
-
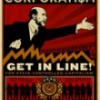
UK - vote de la loi de surveillance la plus extrême jamais passée dans une démocratie
xara a répondu à un sujet de Librekom dans Actualités
Democtary, the word that failed. -
Le problème, c'est le reste du package. Il est notamment question, de ce que j'ai compris, d'un élargissement de la définition des "hate crimes" pour "protéger" la communauté LGBTQWXYZ en rendant possible de condamner pour "discrimination" le refus d'appeler des gens par les pronoms de leurs choix (soit tous les nouveaux pronoms qui se multiplient toutes les semaines avec la création de nouvelles identités basées uniquement sur le ressenti des personnes), entre autres "discriminations" à la définition très vague mais qui consistent manifestement à ne pas faire quelque chose pour quelqu'un. Jordan B. Peterson, prof de psycho de l'université de Toronto a dit stop: Voir en particulier l'exposé qu'il fait ici et les épisodes suivants: Il a bien sûr des soucis avec son université qui veut se protéger du risque légal que son refus représente. Apparemment l'université a accepté d'organiser un débat samedi, mais il aurait deux contradicteurs, ce qui sent le traquenard (à ne pas confondre avec le braquemard) Au delà de ce sujet, je recommande ses vidéos sur ses sujets d'expertise (sur sa page youtube), qui sont d'un très grand intérêt.
-
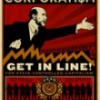
Le libéralisme a-t-il un avenir ?
xara a répondu à un sujet de Johnnieboy dans Philosophie, éthique et histoire
Ah oui, vraiment? -
"Vérité évidente" ici, veut dire: qu'on ne peut nier sans contradiction (performative). C'est-à-dire que la tentative même de la nier la présuppose vraie. Par exemple, on ne peut pas nier sans contradiction qu'on agit. Cette tentative serait elle-même une action. C'est tout ce dont il s'agit. Tu as l'air de dire, sans le dire vraiment, que l'axiome est réfuté du fait du constat empirique de "comportements contradictoires" et je ne suis pas sûr de ce qu'on entend par là étant donné que ce n'est pas précisé. Ce que tu dois vouloir dire, je suppose, est que ce la "transitivité" des préférences serait nécessairement impliquée dans l'axiome et qu'empiriquement on constate qu'elle ne l'est pas. Et donc qu'il doit y avoir un problème avec l'axiome. Si c'est ce que tu veux dire, faudrait le dire. Le fait est pourtant qu'on ne peut nier l'axiome. Si la transitivité était une conséquence nécessaire de l'axiome, alors où serait le problème? Cela suggérerait plutôt que les expériences sont foireuses. Par ailleurs, le raisonnement praxéologique là dessus ressemblerait à quelque chose de ce genre: Dès lors qu'on parle d'action, il y a mise en oeuvre de moyens pour satisfaire des fins. Cela suppose une rareté des moyens -ils sont limités par rapport à toutes les fins qu'ils peuvent servir, si bien qu'elles ne peuvent être toutes satisfaites (autrement ils seraient déjà disponibles en surabondance et les fins seraient automatiquement satisfaites): il n'y aurait pas d'action. D'où la nécessité du choix. C'est là que la notion de préférences rentre en jeu. Si je suis obligé de choisir, je choisis A plutôt que B ou C, ou bien je fais un autre choix (je préfère une option à une autre). Il y a transitivité de toute nécessité ici. Dans le contexte concret d'une action, il n'est pas possible que A soit préféré à B, B à C et C à A. Cela voudrait dire qu'on préfère A à C et qu'on préfère C à A, ce qui est absurde. Dans la réalité qui nous concerne, devant la nécessité de choisir, on fait un choix ou l'autre. On préfère A à C ou on préfère C à A. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dire qu'il y a transitivité revient simplement à reconnaitre la contrainte hardcore qui caractérise l'action, la nécessité de choisir. Quel que soit notre état psychologique et ce qu'on pourrait en dire à un chercheur, le fait est qu'on "préfère" une option à une autre en la choisissant, dès lors qu'on ne peut pas tout avoir. Si l'on reste sur ce terrain donc, un résultat apparent de "non transitivité" découle soit du fait que lorsqu'on répète l'expérience, elle ne l'est pas à l'identique (les conditions du choix ne sont pas les mêmes) soit que les acteurs ont changé d'avis, ce qui veut simplement dire que les préférences ne sont pas nécessairement "stables", comme on dit dans le jargon. Ceci n'est bien sûr pas un problème pour la praxéologie. On le sait dès le départ que les préférence peuvent changer, du fait qu'on parle de choix, d'action. Sinon il s'agirait seulement de réponses mécaniques à des stimuli externes. Mais justement avec l'axiome de l'action, on a abandonné la vaine tentative d'expliquer des choix par des causes extérieures, comme on explique la réaction de l'eau quand on jette un caillou dedans. C'est par contre un problème pour celui qui a décidé que la science était forcément faite de prédictions quantitatives, démarche qui présuppose justement -et dont la méthode est construite pour- appréhender le mouvement de corps inanimés, qui "réagissent" toujours de la même manière aux mêmes stimuli. Partant, les autrichiens n'établissent pas à proprement parler de "modèles" visant à simuler, pour ainsi dire en miniature, le fonctionnement d'un système. Ils construisent un édifice de déductions à partir de l'axiome, pour ce qui est des implications nécessaires de l'action, ce qui n'est pas la même chose. A noter que la seule raison de regretter qu'on ne puisse pas faire de tels modèles est de présupposer que c'est la seule façon de tirer quelques vérités de notre recherche, ce qui encore une fois préjuge entièrement de la question épistémologique. On ne fait pas de modèles juste pour faire des modèles, mais pour trouver quelque chose de vrai (science = connaissance correcte). Si on peut trouver d'une autre manière (et s'il n'est pas possible de faire autrement que sans modèle), c'est de la science, pas moins que la physique. En fait, on pourrait même dire que c'est de la science plus "dure" encore pour ce qui est de la praxéologie. Parce qu'en physique, on n'a pas d'accès direct aux causes. On fait des modèles pour tester nos hypothèses et en principe, elles sont toujours sujettes à une falsification future. Avec l'action c'est l'inverse: comme on est ce qu'on n'étudie, on a accès au point de départ irréductible, le choix/l'action, et il s'agit de déduire ce qui est impliqué là dedans.
- 594 réponses
-
- 1
-

-
- économétrie
- libéralisme
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-
Si Neomatix me dit que c'est "là que ça doit déconner" en réponse à l'idée qu'il n'y a qu'un axiome (de l'action), c'est bien que ça doit avoir un rapport avec, non? Bref c'est un peu cryptique.
- 594 réponses
-
- économétrie
- libéralisme
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-
Ton affirmation implicite et non argumentée est qu'on peut déduire de l'axiome de l'action qu'il est possible de préférer A à B, B à C et C à A. D'où ça sort? Et quel rapport avec la cardinalité?
- 594 réponses
-
- économétrie
- libéralisme
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-
Hein?
- 594 réponses
-
- économétrie
- libéralisme
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-
On dirait oui, mais à vrai dire pour la théorie économique, il n'y a qu'un axiome, une vérité "évidente" -dans le sens d'indéniable sans contradiction- celle de l'action, c'est-à-dire de la mise en oeuvre de moyens pour arriver à des fins.
- 594 réponses
-
- économétrie
- libéralisme
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :

