-
Compteur de contenus
603 -
Inscription
-
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par a455bcd9
-
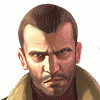
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
La citation exacte est « Il y a trois manières de se ruiner, disait le grand Rothschild : le jeu, les femmes - et les ingénieurs. Les deux premières sont plus agréables - mais la dernière est plus sûre. » Et c'est Auguste Detœuf, polytechnicien de son état, qui l'a écrit (par contre c'est bien dans Propos de O.-L. Barenton, confiseur : ancien élève de l'École Polytechnique). Enfin bon le même Detœuf s'est opposé à von Mises au colloque Walter Lippmann et sa conférence sur « La fin du libéralisme » a malheureusement dû influencer la politique d'après-guerre (et peut-être aussi de l'État français [celui de Vichy...]).- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
... Mesure d'un intérêt limité (le seuil de messages hein, pas les boobs !)
-
Je savais pas où poster ça mais : comment ça se fait que je puisse par voir la liste des membres, ni consulter le profil d'un membre ni voter aux différents sondages ?
-
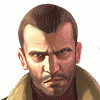
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
En fait ce que je veux te dire c'est qu'il y aura forcément de la concurrence. À partir du moment où chacun est libre de poursuivre ses propres objectifs il y a concurrence. Seulement rien ne permet de dire que la dynamique de la concurrence aboutisse à la situation que tu décris (à savoir un exploitant qui ouvre son réseau aux différentes compagnies). On peut le souhaiter mais l'imposer serait absurde et surtout liberticide. À vrai dire il y a de fortes chances pour que sur un marché libre certaines lignes soient « monopolisées » (de facto pas de dure, ce sera a priori le cas des métro notamment) tandis que d'autres soient ouvertes à la concurrence (si Vinci possède une ligne on peut raisonnablement imaginer qu'il choisisse cette option à moins de se lancer dans un nouveau métier qu'il ne connaît pas ou de racheter une compagnie). Par contre, pour une transition vers la liberté ta solution (qui se doit d'être temporaire) me paraît la bonne (c'est d'ailleurs le schéma retenu au Royaume-Uni, au Japon pour les lignes privatisées et dans les différentes paquets ferroviaires européens). Évidemment. L'État serait déjà un meilleur gestionnaire s'il avait l'interdiction de s'endetter (au minimum un frein à l'endettement), d'augmenter les impôts (un article dans la constitution du type : « Toute augmentation de la charge fiscale est soumise à référendum » éviterait a priori tout abus ^^) et de jouer sur la monnaie (de ce côté-là, l'euro est un moindre mal...).- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
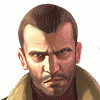
Les articles que vous voulez faire buzzer
a455bcd9 a répondu à un sujet de Nick de Cusa dans Action !
Barack Obama a le premier transformé les petits donateurs en grands électeurs Sur l'inutilité du financement public de la vie politique, extraits : -
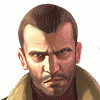
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
Ce n'est effectivement pas du tout dû aux cheminots mais au simple fait que l'État est un mauvais entrepreneur, un mauvais gestionnaire et un mauvais actionnaire (voir par exemple le rapport sur l'État actionnaire publié tous les ans : l'État gère moins bien ses actions que l'actionnaire moyen au CAC40...). Le simple fait de soumettre l'État à la concurrence et à la logique de marché peut d'ailleurs suffire à le remettre dans le droit chemin. Par exemple la Deutsche Bahn (toujours publique) avait 33 milliards d'euros de dette en 1993. En 1994 l'Allemagne libéralise le transport ferroviaire. À partir de 2004 la DB repasse en positif. Aujourd'hui la DB réalise plus de 2 milliards de bénéfice par an. (sources : iFRAP , http://www.finances.net/infos/actions/Deutsche-Bahn-a-souffert-sur-le-premier-semestre-528533 ) Comme quoi : impossible n'est pas français allemand Mais pourquoi devrait-il y avoir forcément une concurrence dans l'exploitation des chemins de fer ? C'est comme si on obligeait les avions Air France à recevoir des passagers easyJet. L'exemple japonais montre que le fait d'avoir une même entreprise qui gère un réseau et y fait rouler ses trains peut être très profitable aux consommateurs et à la société. (Dans L'Opinion d'aujourd'hui il y a d'ailleurs un article sur le rail japonais : http://www.lopinion.fr/29-juillet-2013/grace-a-koji-karaike-rail-sort-train-train-quotidien-2497 . Sur certaines lignes circulent maintenant des trains touristiques, des trains « hotels » ou encore des trains à vapeur. Difficile de mettre en place cela si celui qui fait rouler les trains ne possèdent pas le réseau vu la lenteur de ces trains). Mais à l'inverse il se peut très bien qu'en Europe un autre modèle apparaisse avec un gestionnaire de réseau qui fait payer les compagnies pour qu'elles viennent rouler sur les rails qu'il a construits et qu'il entretient. Après tout, c'est bien ce qui se passe pour les aéroports (et même les privés). Les normes sont faites par les professionnels. On a pas eu besoin de l'État pour créer le DVD, la clé USB, le PDF, etc. Bien sûr il peut y avoir plusieurs normes en concurrence mais en général un norme l'emporte car tout le monde (entreprises et consommateurs) y gagne (Blu-ray vs HD-DVD par exemple). Même pour l'écartement des voies tous les pays s'alignent avec l'ouverture des frontières (par exemple les nouveaux trains espagnols). Le seul rôle qu'on puisse concéder à l'État c'est de nous protéger des autres et par exemple de contrôler la sécurité d'une ligne afin que chaque consommateur soit assuré (ou plutôt suffisamment rassuré) de ne pas mourir en le prenant.- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
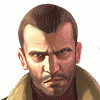
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
On découpe le réseau. Si Vinci a les moyens d'acheter la nouvelle LGV Paris-Bordeaux je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour d'autres lignes.- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
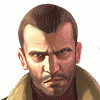
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
Pourquoi tu refuses la concurrence des autres moyens de transport ? Voir le fait de renoncer à prendre le train, par exemple pour privilégier la visio-conférence. C'est bien une concurrence non ? Ainsi l'Eurostar est en concurrence directe avec l'avion et les ferrys. Mais pour aller plus loin si l'on considère ton système (que je trouve bien pour une transition) alors comment peut-on, au nom de la liberté, empêcher une des compagnies de racheter l'exploitant du réseau ? N'est-elle pas aussi libre ? Le but de cette LGV est de désengorger le Paris-Lyon. Évidemment si tu habites à Lyon ça n'a aucun intérêt. Mais actuellement il y a des gens qui prennent le Paris-Lyon pour ensuite aller ailleurs. Et c'est ceux là qui seraient mieux déservis par la ligne POCL. Ainsi les deux lignes seraient en concurrence pour certains passagers.- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
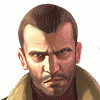
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
L'intérêt ? C'est que les contribuables ne déboursent rien et qu'on laisse payer ceux qui consomment s'ils le désirent. Ainsi on évite les projets pharaoniques inutiles tout droit sortis du cerveau d'un politique qui aimeraient gagner 40 minutes pour aller dans sa maison de vacances ou d'un ingénieur qui aime construire un beau réseau. On ne construit que ce que les gens veulent. Le seul despote éclairé, c'est le consommateur. En quoi il n'y a pas concurrence ? La concurrence ça ne se décrète pas. Par exemple le secteur postal est entièrement ouvert à la concurrence en Union Européenne et pourtant globalement il n'y a qu'un acteur (en France La Poste a 99 % du courrier léger) : on ne va pas forcer la concurrence en obligeant d'autres acteurs à venir ? (c'est ce qui a été fait aux États-Unis et ce n'est pas génial) De plus la concurrence ne se limite pas à un secteur. Si je ne veux pas prendre la ligne TGV, je peux prendre des TER, je peux prendre la route, l'autoroute, le bus, l'avion, etc. D'ailleurs l'exemple d'une nouvelle ligne en parallèle n'est pas si absurde : c'est le cas de la LGV POCL pour doubler la LGV Sud-Est : https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Paris_Orl%C3%A9ans_Clermont-Ferrand_Lyon_%28POCL%29- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
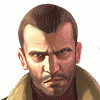
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
Oui... mais (je me cite, sur ce même topic) : « La Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency (qui est une « Independent Administrative Institution ») paie les nouvelles lignes avec l'argent de l'État ( http://www.jrtt.go.j...AboutJrtt03.pdf , http://www.railwayga...s-approved.html ) puis les met en leasing auprès des JR. » « L'exemple japonais montre pourtant que c'est à la fois possible, rentable et intéressant pour tout le monde : l'État verse 0 pour le transport ferroviaire. Au pire il finance la construction des voies les plus coûteuses (Shinkansen) qu'il se fait ensuite rembourser en les mettant en concession. S'il fait ça c'est à mon avis plus pour régler des problèmes d'expropriation que pour le financement même car si la boîte à la moyen de payer pour 50 ou 100 d'exploitation renouvelables elle a aussi les moyens pour payer à vie a priori. » Les JR sont en situation de monopole de facto et non pas de jure. Ça change tout. À chaque ouverture d'une nouvelle ligne il y a une concurrence POUR le marché. On ne peut pas obliger à ce qu'il y ait une concurrence SUR le marché. Après rien n'empêche un gestionnaire de réseau d'ouvrir son réseau à la concurrence (tout comme le fait pour une banque d'autoriser les clients d'autres banques à venir y tirer de l'argent). Mais le modèle japonais ne s'est pas fait comme cela et c'est tout l'objet de l'article dont j'ai mis le lien : les compagnies se diversifient dans l'immobilier et la gestion des gares pour rentabiliser le réseau. Ce pourquoi les tarifs des compagnies privées étaient moins élevés que ceux de l'ancienne JNR.- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
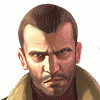
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
Si les gens ont besoin de ces lignes, alors ils seront prêts à payer (éventuellement plus cher). Sinon c'est qu'ils n'en veulent pas et ils se reporteront sur d'autres moyens de transports, en particulier le bus (actuellement la SNCF a le monopole des liaisons interrégionales en bus) et la voiture. Concernant le Japon, je te redonne le lien : http://jrtr.net/jrtr10/pdf/f02_sai.pdf Les compagnies « vraiment privées » (autre que les JR, celles qui n'ont jamais été nationalisées) gèrent un quart du réseau (source : https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Japan )- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
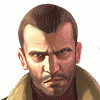
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
Chef d'orchestre ? C'est beau : « il me tarde d'avoir, moi aussi, à ma portée, cette source intarissable de richesses et de lumières, ce médecin universel, ce trésor sans fond, ce conseiller infaillible que vous nommez l'État. » L'exemple du Japon ne te suffit pas ? Des dizaines de lignes construites et exploitées par le privé sans un yen de subvention étatique, sans une seule nationalisation ? [la nationalisation n'a concerné que certaines lignes entre 1905 et les années 70, les autres sont restées privées] Ça semble plus une mesure de transition. Mais en effet le saucissonnage serait plus efficace. De plus les subventions et aides d'État devrait être interdites (d'ailleurs l'UE veut aussi supprimer les aides d'État pour les aéroports : http://www.businesstravel.fr/l-union-europeenne-veut-supprimer-les-aides-d-etat-au-aeroports-d-ici-10-ans.html ).- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
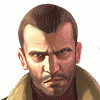
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
Loi : tu penses qu'on a besoin de l'État parce que tu n'envisages par qu'une compagnie puisse se diversifier et posséder les trains, les rails, les gares, leurs alentours... L'exemple japonais montre pourtant que c'est à la fois possible, rentable et intéressant pour tout le monde ( http://jrtr.net/jrtr10/pdf/f02_sai.pdf ). L'État verse 0 pour le transport ferroviaire. Au pire il finance la construction des voies les plus coûteuses (Shinkansen) qu'il se fait ensuite rembourser en les mettant en concession. S'il fait ça c'est à mon avis plus pour régler des problèmes d'expropriation que pour le financement même car si la boîte à la moyen de payer pour 50 ou 100 d'exploitation renouvelables elle a aussi les moyens pour payer à vie a priori. Le rôle de l'État comme garant de la sécurité est le seul que l'on puisse accepter à partir du moment où l'État fixe des règles qui s'appliquent à tous les acteurs. Mais ça relève du droit (tout comme le fait de refuser qu'une nouvelle ligne passe près de chez toi). L'exemple britannique montre aussi que : 1. L'État est un mauvais gestionnaire (voir l'état du réseau avant la privatisation, le sous-investissement, le matériel de mauvaise qualité) 2. Libéraliser tout en gardant un contrôle par l'État (autre que le contrôle des normes de sécurité) conduit à la catastrophe. Quand on libéralise, c'est tout ou rien ( cf. http://www.libertarian.co.uk/lapubs/econn/econn091.pdf ). En particulier, comme l'État avait peur du monopole qu'avait le gestionnaire privé du réseau (Railtrack) il avait fixé les tarifs payés par les compagnies à Railtrack (cf. http://www.publicworld.org/files/britrail.pdf ). Or avec la privatisation le trafic a augmenté, si bien que les tarifs payés ne permettaient plus d'entretenir le réseau correctement... En revanche aujourd'hui la Grande-Bretagne a le système ferroviaire le plus sûr d'Europe. (à rappeler à tous ceux qui évoquent les problèmes de sécurité liés à la privatisation, c'est d'actualité en plus...) En revanche, le VRAI problème c'est celui de la transition. Comment passe-t-on du système actuel à un système libre ? À mon avis il faudrait séparer construction de réseau, entretien du réseau, gares et compagnies ferroviaires et scinder chacun en autant de sociétés différentes qu'il y a de régions (en gros, faire comme au Japon). Privatiser tous ces sociétés, ouvrir à la concurrence. Puis les autoriser à faire ce qu'elles veulent, même à ce qu'une compagnie rachète un exploitant et possède un monopole de facto.- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
Sinon est-ce que des députés et sénateurs soutiennent déjà cette initiative (ou la réforme du droit d'auteur en général) ? Si oui alors il faudrait en convaincre un de lancer une proposition de loi sur la plateforme Parlement et Citoyens : il y a déjà six projets de lancés dont un (celui de Bruno Le Maire) qui doit bientôt déboucher sur le dépôt d'une proposition de loi à l'Assemblée (malgré tout il semble peu plausible que la loi soit votée...).
-
Voilà sûrement la seule proposition que retiendront les députés : « Instauration d’une contribution créative : Le mécénat collectif peut être organisé à plus grande échelle sous la forme d’un système dit de mécénat global ou de contribution créative, par lequel chaque internaute disposant d’une connexion Internet participe au financement de la création par le biais d’une redevance ajoutée au coût de sa connexion. » Un impôt de plus qui vient consacrer le principe de « présomption de culpabilité » déjà en vigueur pour la copie privée...
-
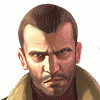
Bitcoin et autres cryptomonnaies
a455bcd9 a répondu à un sujet de Nicolas Azor dans Cryptomonnaies & Co
« First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. » -
Ce ne sont (que) pas des notes de bas de page. Hayek fait surtout référence à Rawls (Théorie de la justice, 1982) dans l'introduction du volume 2 (1976), du volume 3 (1979) et il reprend ces deux références dans l'introduction en un seul volume de 1982. Pour reprendre la citation complète : Et page 515 (qui est la conclusion du chapitre 9 : Justice « sociale » ou distributive) : Et en note 1 : Du coup tu penses que c'est Hayek qui a mal compris Rawls ? C'est possible, néanmoins sur l'essentiel j'ai l'impression qu'ils sont d'accord : « c'est le système des institutions qui doit être jugé, et jugé d'un point de vue général », « la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté elle-même », « chaque personne a droit à un système pleinement adéquat de libertés de base égales pour tous, compatible avec un même système de liberté pour tous ». Puis vient l'égalité des chances. Enfin, et en dernier, le principe de différence. Par contre sur les applications et sur les précisions qu'a donné Rawls sur sa théorie (après la mort de Hayek) c'est plus compliqué... En particulier dans « La justice comme équité - Une reformulation de Théorie de la justice » (Justice as Fairness: A Restatement) que Rawls a écrit un an avant de mourir il considère que parmi les cinq systèmes suivants seuls les deux derniers sont compatibles avec sa conception de la justice : « Laissez-faire capitalism, Welfare-state capitalism, State socialism with a command economy, Property-owning democracy (POD), Liberal (democratic) socialism. » Et sa POD... (cf. http://www-users.york.ac.uk/~mpon500/L.E.POD.pdf , http://bleedingheartlibertarians.com/2012/11/property-owning-democracy/ )
-
Hayek et Rawls sur la justice sociale : les différences sont-elles "plus verbales que substantielles" ? Dans cet article l'auteur (Claude Gamel, Aix-Marseille) analyse cette phrase de Hayek dans Droit, législation et liberté, qui m'avait vraiment surpris lorsque je l'avais lue pour la première fois : « À un moment donné, le sentiment que je devrais justifier ma position vis-à-vis d’un ouvrage récent de grande valeur a également contribué à retarder l’achèvement de ce volume-ci. Mais après avoir soigneusement considéré la chose, je suis arrivé à la conclusion que ce que je pourrais avoir à dire du livre de John Rawls A Theory of Justice (1972) [sic] ne servirait pas à mon objectif immédiat, parce que les différences entre nous apparaissent plus verbales que substantielles. » C'est assez bien écrit : il montre les points communs et différences entre Hayek et Rawls que ce soit sur la théorie ou les applications. Néanmoins Gamel ne mentionne pas le fait (ou alors je n'ai pas bien lu l'article) qu'après avoir publié sa Théorie de la justice, Rawls l'a reformulé en faisant passer l'égalité des chances devant le principe de différence (ces deux principes restant, comme auparavant, subordonnés au principe de liberté). C'est ce que je me suis dit aussi. Mais franchement le mec d'ATTAC est tellement mauvais... Enfin bon je compte tester ça sur un ami altermondialiste pour voir le résultat ^^.
-
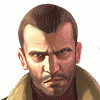
Libéralisation du transport de passagers
a455bcd9 a répondu à un sujet de dexter79 dans Politique, droit et questions de société
Concernant le Japon apparemment la construction reste publique, en tout cas pour les lignes les plus importantes (Shinkansen) : La Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency (qui est une « Independent Administrative Institution ») paie les nouvelles lignes avec l'argent de l'État ( http://www.jrtt.go.jp/11English/pdf/AboutJrtt03.pdf , http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/three-shinkansen-extensions-approved.html ) puis les met en leasing auprès des JR. Par contre pour les plus petites lignes, tout est financé par le privé. L'article suivant explique bien la diversification des compagnies privées japonaises : « The private railway companies promoted business diversification from the time they constructed their lines. Since there was strong tendency to readily permit private railway companies in areas with no railway lines, in order to survive, the newly-established companies had to increase the population near their lines and attract as many passengers as possible by creating entertainment near their lines. This practice created a stereotype for business diversification of private railway companies. [...] In many cases, community building by private railway companies accompanies development of residential and commercial areas, improvement of public access to the stations, and construction of neighborhood amenities. Some companies even invite in campuses of well-known universities to improve the town’s image. Generally speaking, these railway towns are well-maintained in a planned manner and offer affordable housing lots and high-quality houses. Private railway companies receive high social recognition as developers because of this. [...] The essence of railway management practiced by Japanese private railway companies is that genuinely private railway companies have played an important role in the social field of transportation without government subsidy; their successful urban development activity along their railway lines has helped support their main business. The above method of railway management has something in common with the ‘developer proposition’ (optimum behavior for developers) in economic theory. If a railway company carries out railway improvement and urban development simultaneously, the deficits from railway operations under optimum fares (equal to marginal costs) can be covered by the revenues from land (internalization of profits from development). In other countries, business diversification at monopolistic railway companies has often been subject to strict regulation and companies were susceptible to public ownership. As a result, the method of railway management practiced by Japanese private railway companies is found only in exceptional cases as in the history of the Metropolitan Railways in London. Private railway companies in Japan were lucky that after nationalization in 1906, only private companies engaging in local transport were permitted, and that regulations were seldom enforced because of the fragile management foundation. It was also fortunate for the railway companies that although public ownership of urban transport was often suggested, it was not put into effect. Nevertheless, the present sound management could not have been achieved without a favourable market. The most fortunate aspect is the concentration of population and industry in large cities» ( http://jrtr.net/jrtr10/pdf/f02_sai.pdf ) Ça mérite un article sur Contrepoints... Par ailleurs le dernier point mentionné (la concentration) me paraît plutôt une conséquence qu'une cause. En France où l'État subventionne tout il incite justement à l'étalement urbain (par exemple en « dézonant » ou en réduisant le nombre de zones du RER en Île-de-France). Les écolos devraient pourtant y être sensibles...- 1 576 réponses
-
- libéralisation
- train
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
Évidemment ! Je publie tous mes textes sous licence LPRAB
-
En quoi l'État pourrait empêcher le projet ? Ça constitue juste à déménager dans une certaine ville afin de pouvoir peser lors des élections. Plus généralement le principe c'est que quelques individus très engagés suffisent à infléchir voire à véritablement influencer une politique. Au NH les membres du projet ne représente qu'un habitant sur mille mais ils sont environ 3 % au parlement. Une ville privée en France c'est possible ? Et quels intérêts y auraient les politiciens ? C'était peut-être le maire qui voulait attirer des habitants
-
Salut, Le Free State Project a dix ans et les conclusions semblent plutôt positives, bien qu'un millier de libertarien « seulement » ait fait le déplacement. Voici quelques articles à ce propos (pour et contre) : www.reason.com/archives/2013/05/15/the-free-state-project-grows-up www.nhpr.org/post/one-decade-free-state-project http://www.unionleader.com/article/20121220/NEWHAMPSHIRE14/121229936&source=RSS http://www.foxnews.com/politics/2013/05/25/libertarian-movement-in-new-hampshire-10-years-later-successes-more-challenges/ http://www.gonzotimes.com/2012/12/the-free-state-project/ Du coup peut-on imaginer un tel projet en France ? Mais avec une ville plutôt qu'un département ou une région (le New Hampshire par rapport aux États-Unis ça équivaut à une ville de 280 000 en France). C'est peut-être (sûrement ?) une utopie mais l'idée me paraît intéressante, vu la difficulté de faire passer les idées libérales (même si au niveau d'une ville les moyens d'agir sont limités...). Faudrait prendre une « petite » ville (moins de 100 000 habitants), peu endettée (voire pas du tout), avec peu d'impôts locaux, ouverte aux entreprises, pas à gauche, etc. Par exemple Issy-les-Moulineaux, 65 000 habitants, faibles impôts (ils ont même baissé), moins endettée que la moyenne, maire UDI (enfin bon c'est André Santini...), pas mal d'entreprises y ont leur siège social (HP, Coca, Microsoft, pépinière pour les start-up), blablabla... Enfin bon voici quelques liens pour trouver les villes les moins imposées et les moins endettées et voir au passage si votre commune est bien gérée : http://www.capital.fr/immobilier/special-impots-locaux/le-palmares-2012-des-impots-locaux-ville-par-ville/%28s%29/1/%28o%29/d http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/statistiques.donnees_detaillees?espId=-4&pageId=stat_donnees_synthetiques&sfid=4502 http://www.journaldunet.com/business/budget-ville https://www.decomptes-publics.fr/actualites/le-point/classement-des-collectivites-territoriales
-
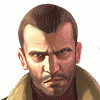
Coucou, les nouveaux : présentez-vous !
a455bcd9 a répondu à un sujet de Copeau dans Forum des nouveaux
Malgré ce qu'en a dit Hayek, la situation est en réalité bien moins inquiétante que ce que tu penses (et que je pensais aussi ^^). Que ce soit parmi les élèves, parmi les profs (Philippe Nemo et Jean Petitot y étaient profs et j'ai Hayek et Benjamin Constant au programme l'année prochaine) ou parmi les anciens élèves (rien que parmi les auteurs de « Libres ! » yen a au moins deux, ce qui est pas mal quand on sait que les X représentent 0,05 % d'une classe d'âge ). Tu bosses où si c'est pas trop indiscret ? Vu l'escalier, on sort en effet rarement du platâl (chéri) -
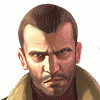
Coucou, les nouveaux : présentez-vous !
a455bcd9 a répondu à un sujet de Copeau dans Forum des nouveaux
Bon me vaut tard que jamais je me présente... Antoine (le pseudo bizarre, c'est une longue histoire...), fraîchement « converti » au libéralisme (ou plutôt j'ai récemment appris à mettre un mot sur ce à quoi j'ai toujours cru) et étudiant (en deuxième année à l'École polytechnique). -
Mondialisation : Consommateur ou acteur ? Déjà le principe du livre est pas mal : une intro neutre qui définit le thème, puis chaque auteur (ici, un d'ATTAC et un chercheur à l'IREF) présente sa thèse, puis il y a un « droit de réponse » et enfin une conclusion, toujours neutre. Le mec d'ATTAC ne parle que de sentiments et tente de convaincre en utilisant des gros mots « mondialisation néolibérale », « ultralibérale ». Sa thèse des « biens publics mondiaux » ne repose que sur du vent. À côté le libéral s'appuie sur une analyse philosophique, historique, économique et statistique pour montrer les errements du protectionnisme et les bienfaits de la mondialisation. Victoire par KO. À offrir aux chantres de la démondialisation, de l'antimondialisme et de l'altermondialisme.

