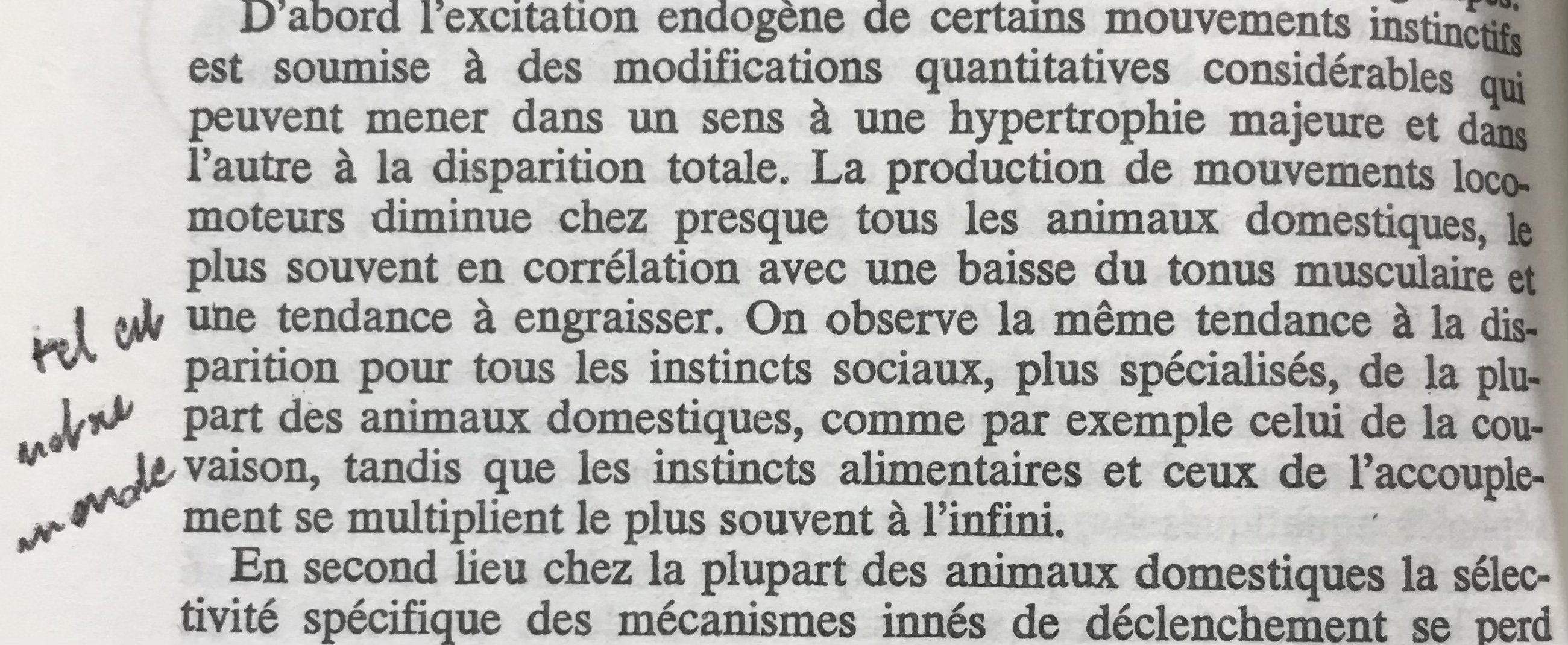-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
Du Husserl dans le texte. Étonné de le lire sous la plume de Rand.
-

Anthropologie libérale
Vilfredo a répondu à un sujet de Troy89 dans Philosophie, éthique et histoire
Quel troll, ce Dieu ! C'est un peu bizarre de séparer comme ça l'individu d'un côté qui bride "la société" de l'autre. Exemple précis ? -
J'avoue ça revient au même (j'aurais défini la sociobiologie comme un paradigme interprétatif consistant à expliquer les comportements sociaux par la préservation de l'espèce). Oui : le marché n'est ni naturel ni culturel (d'où l'intérêt de parler de "spontanéité"). Je vais essayer de m'en charger anytime soon.
-
Certes mais comment garder l'euro sans se taper une BCE, qui pose le même problème ? (Mais je pinaille parce qu'on est d'accord sur le fond, since : )
-
Ou à un niveau élevé de testostérone. Il est vrai que ça n'exclut nullement ton point de vue évolutionniste, au contraire : c'est la group selection. Dawkins gonna hate. J'ai l'impression que tu défends plutôt un point de vue assez sociobiologiste, arrête-moi si je dis une bêtise. Sinon, pourquoi ne pas évoquer l'évolution culturelle de Hayek (surtout sur Liborg) ? Précisément, elle s'applique au processus de sélection de règles sociales, de plus en plus abstraites. J'avais pensé créer un thread sur le sujet et sur la critique de l'évolution culturelle par les praxéologistes, qui y voient un irrationalisme.
-
Pourquoi garder l'euro ? Je m'en fiche qu'on le garde ou pas mais quel avantage ça aurait ? En quoi garder l'euro est-il préférable à une concurrence des monnaies ?
-
Oui mais même sans imposer une égalité stricte, les taux de change ne seront jamais flottants… Si mes souvenirs sont bons, à Bretton Woods, on avait décidé que 1 ounce = $30. Mais même sans cette égalité-là, on risque toujours d'avoir, comme dans les années 60-70, avant que Nixon ne suspende la convertibilité, un taux fixe supérieur au taux du marché et donc désavantageux. Défendre l'étalon-or et le taux de change flottant me paraît voué à l'incompatibilité (il est vrai que tu n'as pas défendu l'étalon-or positivement sur cette conversation).
-
Ok mais est-ce que l'or serait un "cours forcé" ? Il est moins flexible, par définition, qu'une fiat money… Et il a pour avantage d'éviter que l'État ou la banque centrale manipule la monnaie comme ça la chante (=> minimisation des risques de distorsion de la structure productive). J'ai bon ? (Je ne suis pas encore venu à bout de mes lectures obligatoires du corpus misésien mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il déploie à peu près cette idée pour défendre l'étalon-or (par ex. dans Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow.)
-
Ta réponse ironique me semblait moquer l'argument des taux de change réels soi-disant importants entre les pays de l'UEM malgré l'existence de la monnaie commune. Dès lors, l'immuabilité du taux de change, en l'absence d'une parité monétaire de toute façon impossible à obtenir, me semblait être un problème, qui, pour toi, ne devrait pas être réglé par la dévaluation si je comprends bien.
-
Tu soutiens l'immuabilité du taux de change entre les pays ?
-
J'ai aussi lu des analyses sur les "taux de change réels" (l'euro qui serait "trop lourd" pour l'économie française et l'impossibilité de dévaluer nuirait à notre compétitivité) mais comme je n'ai pas d'autres sources que Jacques Sapir je me demandais quel crédit accorder à cette analyse des impacts de la politique monétaire européenne, l'atrophie de la compétitivité des entreprises et l'impossibilité de la dévaluation interne me semblant être des explications a priori rationnelles de l'inflation... Le vrai problème est donc lié à la centralisation bancaire.
-
Je dis peut-être une bêtise mais son défaut, d'un point de vue autrichien, n'est-il pas de considérer le niveau général et non relatif des prix (puisqu'il s'intéresse au niveau moyen) ? Sinon pourquoi ne pas ouvrir un thread sur la polémique des réserves fractionnaires dans l'école autrichienne sur le forum ? Sur les précédents historiques du free-banking (le fameux débat autour de la banque écossaise) ? Parce que c'est un peu HS à propos des classes moyennes amha. Mes lectures sur le free banking se limitent à White et l'article de Rothbard qui le réfute (ou plutôt, le défonce), mais sur ce sujet, Alt-M avait publié une série plutôt pas mal : (par le poulain de White, Selgin) la présentation est un peu emmerdante, mais la deuxième partie est d'une rigueur historique appréciable.
-
Dans un topic (appelé à durer j'imagine) sur les classes moyennes, ce ne serait pas intéressant de lancer aussi quelques idées sur l'inflation ? Sauf erreur, le sujet n'a pas été évoqué, et je crois que les calculs de l'inflation en France par l'Insee font débat... C'est aussi de là qu'est partie la manifestation des GJ. Faut-il une inflation à 2%, à 0% ? Je crois que Hayek se riait des économistes qui voulaient préserver "un peu" d'inflation (politique de nombreuses banques centrales, 2% est environ le taux tendance).
-
En effet, mais justement ça me paraissait bien coller à la position de frigo.
-
Ça marche tellement bien partout. Ce que je ne comprends pas dans les logiques protectionnistes est que s'il faut arrêter les échanges entre deux pays parce que le niveau des salaires est différent (entre autres), il faudrait aussi le faire entre deux régions, deux quartiers etc. Les différences de salaires existent à différentes échelles. Triple H est excellent pour décaper cet argument. Il faut aussi lire ce qu'écrit Hayek de List dans la Route. Ce n'est pas tellement le sujet mais en même temps, on met si souvent sur le dos du libre échange, de l'euro, de la "concurrence mondialisée" l'appauvrissement des classes moyennes qu'il me semble que ça méritait quand même d'être évoqué.
-
Donc en route pour le protectionnisme éducateur de Friedrich List ?
-

Ocasio-Cortez : le côté obscur de la force ?
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Europe et international
Parmi les très nombreux articles du Mises Institue sur Ocasio Cortez, ceux de Robert P. Murphy et le Green New Deal sont chouettes, je ne sais pas si vous les avez lus : https://mises.org/wire/green-new-deal-debunked-part-1-2 La comparaison entre les chiffres du chômage des USA grâce au fantastique New Deal de FDR et du Canada à la même époque est particulièrement frappante. Cependant, et bien que Murphy, comme il le précise, ait écrit tout un bouquin sur le sujet, je ne comprends pas bien où la comparaison le mène : le Canada dans les années 30 n'est vraiment pas la Libéralie… Est-ce qu'un spécialiste aurait une idée pour expliquer ce différentiel ? -
Cela ne justifie pas que les plus défavorisés payent des impôts. Ce qui serait juste, c'est que personne ne paye d'impôts (ou par capitation en effet). Je vais abuser de ta gentillesse et te demander : comment fixe-t-on Z ? Puisque ton équation (X-Z)/Y permet seulement de calculer le montant de l'impôt en supposant une année A-1, donc dans un système où l'impôt est déjà installé. On en revient toujours à un 1er prélèvement.
-
Pourquoi conserver, en plus de l'impôt par tête, un impôt proportionnel sur le revenu ? Comment défendre un impôt dont les tranches marginales pèseraient sur les plus bas revenus ?
-
Oui pardon je veux dire qu'il prendrait la forme d'un don et donc plus d'un impôt. Ok mais comment le fixe-t-on ?
-
Merci pour cette réponse. Et je m'excuse pour ce pénible malentendu.
-
Dans cet ordre Impôt volontaire alors ? (pas du tout comme la poll tax)
-
Mais la poll tax pour le coup c'est justement la capitation. C'est bien à ça que tu pensais en mentionnant Thatcher ? Et justement ça n'a pas l'air proportionnel... Après je m'y connais mal, mais...
-
Merci @Tramp et @frigo. Vous avez des sources pour les libertariens en faveur de l'impôt non proportionnel ou par tête ?
-
Je crois que j'ai dû mal comprendre "en proportion du revenu" dans ton message au-dessus : dans la mesure où la flat tax n'admet qu'une tranche d'imposition, je ne considérais pas ça comme proportionnel au revenu (puisqu'il n'y a pas d'ajustement proportionnellement au revenu (bas pour les bas revenus, élevé pour les revenus élevés)), contrairement à l'impôt progressif. En fait, il faut considérer les deux comme des impôts proportionnels au revenu mais du coup "impôt proportionnel au revenu" est un pléonasme : quel impôt sur le revenu ne serait pas proportionnel ? On n'a jamais vu quelqu'un décider d'un impôt de 800$ par revenu, si ? Je ne sais même pas si ce truc a un nom