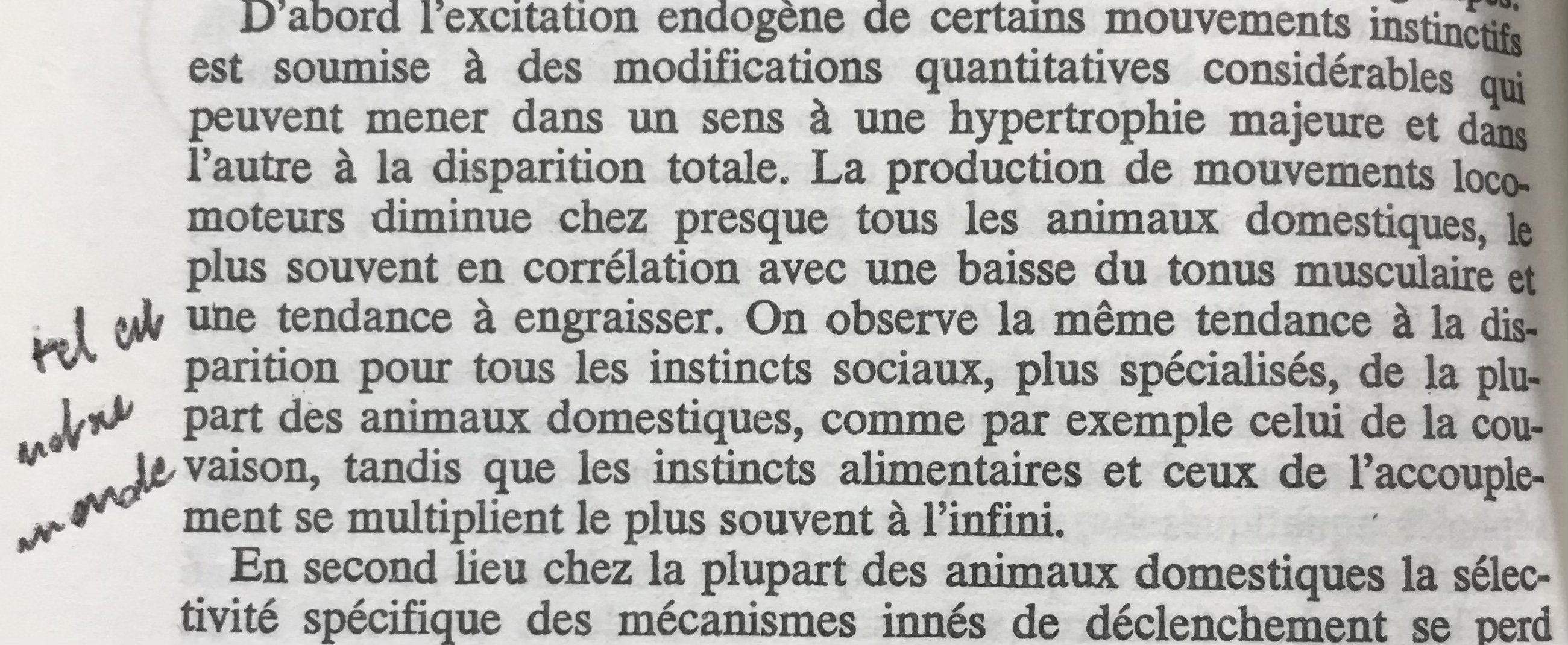-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
J'ai bien compris : donc contrairement à ce que tu citais de Adam Smith, l'individu n'est pas imposé en proportion de son revenu, puisque quel que soit le revenu, il est imposé à 10% (ce qui ne veut pas dire, je sais, que la somme est identique). En proportion du revenu = impôt progressif. Sinon, quel impôt ne serait pas en proportion du revenu ?
-
Bah oui... Pour x = 1500 et y = 7000, Tx = 20% et Ty = 75% (je mets n'importe quoi en valeur, ce qui compte c'est que Tx reste > Ty). Je ne vois toujours pas le problème. Tx et Ty sont des rapports entre deux valeurs (puisque ce sont des parts, des quotients), des pourcentages, des proportions.
-
Soient x et y des revenus. Si x > y, alors le taux d'imposition (la part du revenu que l'état préempte) sera noté Tx et Ty de telle sorte que Tx > Ty.
-
Je vois pas bien où tu veux en venir honnêtement : tu proposes, si je te suis bien, d'appliquer l'idée avancée par Smith d'un impôt proportionnel (donc avec des taux différents en proportion du revenu) et quand j'y oppose l'idée de flat tax (taux unique, pas de proportionnalité) tu me dis que je n'ai pas compris ce qu'était la flat tax. Je suis tout ouïe. Et au départ, j'ajoutais que l'impôt proportionnel avait côté distributif par définition... Voilà l'état de la discussion.
-
Un quotient non ? 20% = 1/5
-
Un régime dont le taux d'imposition est unique ? Dans le Wikibéral (je viens de regarder) c'est : Du coup où est mon erreur ?
-
Si chaque contribuable contribue en proportion de son revenu, les revenus les plus élevés seront les plus imposés. Donc en quoi est-ce que c'est différent d'une redistribution (à moins qu'on ne dépense pas l'argent imposé) donc pas une flat tax ? Avec une flat tax précisément, on ne contribue pas en proportion de son revenu. Avec Salvini, quel que soit ton revenu, tu es imposé à 15%.
-
Je viens de terminer le bref Le libéralisme de Hayek de Dostaler (que je soupçonne de keynésianisme) qui est plein de mauvaise foi. Il range Hayek parmi les individualistes méthodologiques, ce que je trouve nettement caricatural (l'ordre spontané est à lui seul l'exemple même d'un individualisme anti-rationaliste (ce que lui reprochent précisément les praxéologistes) puisque c'est un processus sans sujet) et sa conclusion est risible : C'est débile. D'abord, Hayek n'a jamais prétendu que la constitution est un ordre spontané (wtf d'ailleurs) mais qu'elle encadre les mécanismes autogénérés : comment un ordre spontané encadrerait-il un ordre spontané ? Il faudrait qu'il ait été designed dans ce but, ce qui revient à postuler l'existence d'un ordre spontané téléologique, c'est-à-dire d'une vilaine bestiole. Et quel intérêt d'encadrer un ordre spontané par un autre ordre spontané ? Ils sont censés se contrôler mutuellement ? Bref, Dostaler nous prend vraiment pour des idiots. Sinon j'ai lu Individu et justice sociale, un collectif des années 80 sur Rawls édité au Seuil avec des articles de JP Dupuy : très bon, avec un titre provoc' : "L'individu libéral, cet inconnu", je regrette seulement que ce soit un peu court sur Hayek et sa dénonciation de la justice antisacrificielle de Nozick ne me convainc pas : il explique que Nozick ne peut considérer une situation sacrificielle, dans laquelle une foule en délire s'acharne sur un homme, et si on l'en empêche, elle risque de massacrer tout le monde, situation dans laquelle les utilitaristes seraient donc susceptibles de préférer voir un seul homme crever plutôt que d'en mettre plusieurs en danger. Il explique qu'en effet, l'anthropologie de Nozick qui est celle d'un être autonome et souverain est incompatible avec celle de l'homme de la foule, envieux et mimétique tel que le décrivent en fait Keynes (le célèbre exemple du prix littéraire) et Adam Smith (la sympathie). N'empêche que l'argument ne tient pas vraiment en l'air : on pourrait simplement commencer par dire que l'homme pris dans une foule ne raisonne ni ne se comporte de la même façon qu'un homme pris individuellement (Le Bon l'a écrit partout, Canetti dans Masse et puissance arrive par des biais différents à la même conclusion). Ensuite, Dupuy déploie une argumentation plus filandreuse en disant que choisir le principe sacrificiel, c'est le faire depuis un point de vue extérieur, qui suppose une certaine lucidité, par opposition à la foule, qui, si elle était lucide, arrêterait son sacrifice (en se rendant compte, je ne sais pas moi, que le mec est innocent par exemple) (on voit au passage que Dupuy nous donne des armes pour casser en deux son précédent argument "anthropologique" contre Nozick). Admettons : celui qui serait susceptible de choisir ce principe est l'individu utilitariste ou l'olibrius de Rawls et pas l'homme nozickien, jusque-là. Chez Rawls, justement, écrit Dupuy, la justice est publique. Il en conclut donc que le principe sacrificiel est en droit impossible, puisque rendre le principe sacrificiel public, "c'est le condamner ipso facto à l'inefficacité" (éd. Le Seuil, coll. Points, 1988, p. 112). Pour Dupuy du coup, accuser l'utilitarisme d'être un principe sacrificiel est anthropologiquement et logiquement impossible. Je passe sur l'argument anthropologique du coup, mais l'argument logique (la contradiction d'un principe sacrificiel public) est invalidé par les faits : l'existence même d'un principe de redistribution. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas où veut en venir Dupuy ou si lui-même pédale dans la choucroute, mais je suis déconcerté. Enfin j'ai lu l'Histoire de l'Union Soviétique de l'excellent Nicolas Werth ; en dépit du fait qu'il donne deux dates différentes du retrait des troupes allemandes d'URSS (traité de Rapallo) avec la montée d'Hitler, j'aimerais citer cette pépite :
-
Il me semble que la question est moins de savoir de qui c'est que de savoir comment on l'utilise. Adam Smith n'est pas maoïste mais on peut difficilement prendre pour argent comptant les thèses d'un théoricien libéral (par ailleurs prudent (certains diront timoré)) du XVIIIe aujourd'hui en économie fiscale. Et en l'occurrence je me demande innocemment comment on peut justifier ce passage de Smith au regard du fonctionnement de nos sociétés complexes et de l'évolution postérieure de la pensée libérale qu'on ne peut pas non plus complètement mettre entre parenthèses. Il ne me suffit pas de savoir que c'est Adam Smith pour que j'arrête de me demander si c'est du flan ou pas.
-
Dans une catallaxie, le revenu ne correspond pas aux facultés. Le fait est qu'un individu peut perdre tout dans une transaction ou tout gagner, mais ce processus n'est pas personnel, donc il n'est ni juste ni injuste et par extension, le concept de justice sociale est vide de sens. Je suis le premier à défendre un basic income pour protéger les plus vulnérables (j'ai un peu revu mes prétentions sur le smic ) mais en revanche ton option distributive est difficile à défendre.
-
Juste au nom de quoi ? De la fameuse justice sociale ?
-

Anthropologie libérale
Vilfredo a répondu à un sujet de Troy89 dans Philosophie, éthique et histoire
Bof, il me semble qu'il est difficile d'être d'accord ou en désaccord avec ça : choisie comment ? Par qui ? Je ne sais pas si tu as lu DLL de Hayek mais le cadre juridique dans lequel s'exerce la démocratie (Hayek lui-même n'étant pas un sectateur inconditionnel de ce système) est précisément défini (les règles concurrentielles sélectionnées au terme de processus d'essais et d'erreurs). Et c'est quoi une "morale nationale unique" ? Un exemple ? -
Et du coup c'est comment ? edit : ah pardon tu as répondu
-
Quelqu'un a vu le dernier Lars von Trier ?
-

Anthropologie libérale
Vilfredo a répondu à un sujet de Troy89 dans Philosophie, éthique et histoire
La corrélation entre les deux me paraît pas si évidente qu'elle se passe d'explications (surtout quand on sait que Gehlen, avec toute l'admiration que les sociologues comme Luhmann et d'autres ont pour lui, était nazi)… -

Ces phrases qui vous ont fait littéralement hérisser le poil 2
Vilfredo a répondu à un sujet de Mathieu_D dans La Taverne
Bien obligé. Mais ça leur déchire le cœur. Bruno Le Maire, comme Libération, fait seulement preuve du minimum requis de bon sens en politique (et applique (à son insu ?) la théorie des choix publics : combattre l'inflation qu'on a créée) : -
Je rajoute un truc que je viens de lire dans Mises, qui m'a fait lever le nez et penser à ton message :
-

Ces phrases qui vous ont fait littéralement hérisser le poil 2
Vilfredo a répondu à un sujet de Mathieu_D dans La Taverne
Personne sur ce fil à propos de la proposition merveilleuse de Terra Nova sur l'héritage ? Ça me fait penser aux FAQ de Milton Friedman… et sans être un friedmanien du tout, ce qu'il dit est parfait. -

Anthropologie libérale
Vilfredo a répondu à un sujet de Troy89 dans Philosophie, éthique et histoire
Oui mais C'est justement l'idéologie émancipatrice, la volonté conservatrice (absurde pour Gehlen) de contrôler le matériau technique méta-humain, l'expansion de la technique au-delà du contrôle que peut exercer l'homme sur elle, l'humanisme version XVIe siècle, qui menace la cohésion des institutions dans Der Mensch. C'est cette perspective que rejette Gehlen lorsqu'il évoque (en faisant la grimace) l'"exagération de la subjectivité" ou le subjectivisme. Bref, c'est l'inverse du libéralisme classique : un petit teaser : Je ne vois pas bien comment tu peux mobiliser Gehlen dans un débat sur le libéralisme et l'émancipation individuelle… il n'aide pas à comprendre le type de coercition que "le libéralisme peut accepter", si ? Et deuxièmement, la critique de Gehlen sur le subjectivisme ne me paraît pas être exactement une critique du libéralisme. Enfin, c'est moi ou il y a une contradiction entre et Comment les règles devraient-elles être choisies pour toi ? -

Pourquoi Gustave le Bon n'est pas considéré comme un libéral ?
Vilfredo a répondu à un sujet de M.Valérien dans Philosophie, éthique et histoire
Pourquoi la liberté d'échanger serait-elle limitée ? J'avoue que j'ai du mal à comprendre : pour Hoppe, soit les deux contractants se sont entendus sur l'échange (échange de biens) soit non (immigration pour Hoppe) : c'est le critère définitoire d'un "capitalist act between consenting adults" comme écrit Nozick. Le problème qui m'était apparu était plutôt de savoir comment on mesurait si oui ou non deux pays se sont "entendus" au sujet de l'immigration. Mais la liberté d'échanger, dans le cas de l'immigration comme dans celui des biens me semble souffrir de la même et unique potentielle restriction : le refus d'un des contractants. Hoppe pousse même le bouchon plus loin en montrant dans la suite du texte que libre-échange et immigration se nuisent l'un à l'autre ; plus exactement : c'est lorsqu'on restreint le libre-échange qu'on alimente l'immigration, car "Tant que les produits mexicains - les produits de la zone à faibles salaires - peuvent entrer librement dans une zone à hauts salaires comme les États-Unis, l'incitation des Mexicains à émigrer vers les États-Unis est réduite. Au contraire, si les produits mexicains sont empêchés d'entrer sur le marché nord-américain, la tentation des travailleurs à partir pour les États-Unis augmente." En effet, dans une situation où tous les pays pratiquent le libre-échange, le travail se dirige vers les zones de hauts salaires et les entreprises vers les zones de bas salaires, ce qui équilibre les salaires pour un travail de même niveau de qualification. Hoppe (comme Rothbard, qui déclarait dans ce sens que Harding était son président américain préféré : "a lovable character") soutient donc une politique de laissez-faire, le libre-échange étant supposé maintenir un bas niveau d'immigration. Bon je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça un peu abracadabrantesque… -
Si, si : https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/8558/la-visibilite-de-l-eglise-catholicisme-romain-et-forme-politique-donoso-cortes-quatre-essais Si, si : https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/8558/la-visibilite-de-l-eglise-catholicisme-romain-et-forme-politique-donoso-cortes-quatre-essais
-
Je vais quand même résumer parce que c'est vrai que ça commence à faire "wall of text" : > l'utilité de Coase = maximisation de la richesse. Je corrige : maximisation de la richesse individuelle : nécessite une allocation juste des ressources, qui protège alors la propriété privée (il n'y a pas de juge "arbitraire"). Cette allocation maximise les capabilités de base. > j'ai du mal à me dire utilitariste parce que, pour justifier d'un point de vue utilitariste une position normative, il faut faire intervenir une comparaison interpersonnelle d'utilités ou tomber dans des nunucheries comme les biens premiers de Rawls. "Il ne s'agit pas de quantifier l'utilité mais de la répartir de façon équilibrée (optimum) ce qui ne veut pas dire : la répartir de façon égale ou égalitaire, de telle sorte que chacun puisse partir de certaines capabilités de base (ce qui est une norme et non un chiffre, d'où ma réfutation de la quantification de l'utilité)." > je laisse tomber la défense de l'espace public.
-
La citation de Block abordait la question de l'utilité (comme le soulignait Atika : "Ce qui entraîne nécessairement des comparaisons interpersonnelles d'utilité. "), le fil est à propos du salaire minimum, Block s'inquiète de la disparition de la propriété privée, qui est forcément en elle-même un sujet qui touche à l'opposition public/privé et à la propriété… Je veux bien être plus concis à l'avenir, mais s'il y a des passages incompréhensibles dans mon message, je suis tout prêt à expliciter.
-
Ta citation de Block est très éclairante/stimulante : c'est dans Defending the Undefendable, son fameux bouquin ou ailleurs ? Oui (Pareto aussi utilise un argumentaire utilitariste mais se fondant sur l'utilité ordinale et non cardinale tandis que Sen réintroduit des comparaisons interpersonnelles), la position que je défends est utilitariste dans une certaine mesure, sachant qu'il y a une tension entre les utilitaristes sur le sujet bancal de la maximisation de l'utilité. Tu comprends donc que si je veux bien être considéré comme utilitariste, je rejette partiellement Coase ou la lecture par Block de Coase : 1°) Le vrai débat est sur les comparaisons interpersonnelles. Il ne s'agit pas de quantifier l'utilité mais de la répartir de façon équilibrée (optimum) ce qui ne veut pas dire : la répartir de façon égale ou égalitaire, de telle sorte que chacun puisse partir de certaines capabilités de base (ce qui est une norme et non un chiffre, d'où ma réfutation de la quantification de l'utilité). Un argument qu'aucun conservateur, je pense, ne renierait. Je me demande si je ne suis pas en train de tendre le bâton pour me faire battre mais Sen et Rawls rejoignent une forme d'"utilitarisme de la règle" (expression de Rawls) du plus grand bien du plus grand nombre. Comme Arendt l'explique dans la Condition de l'homme moderne, il faut se demander à quoi sert l'utilité. Dans l'extrait de Block, l'utilité coasienne vise à maximiser la richesse (protéger le productive worker) ; ce n'est ni le cas de Sen, ni le cas de l'utilité rawlsienne. Le problème, c'est que si (comme beaucoup l'ont défendu sur ce fil jusqu'à présent) l'on entend par richesse le PIB, alors incontestablement une dérégulation complète sans aucune garantie (smic, basic income etc.) est incontestablement le meilleur système de production de richesse. Quand je distinguais richesse personnelle et richesse au sens du PIB, je voulais simplement parler de l'inadéquation entre l'augmentation du PIB et l'augmentation de la richesse de la femme de ménage (richesse personnelle ≠ PIB/hab). L'efficience du marché est hors concours quand il s'agit de parler d'élévation globale du niveau de vie ; simplement, puisque nous ne vivons pas dans une catallaxie et que nous n'y avons jamais vraiment vécu, nous ne pouvons historiquement que mesurer les effets d'une légère libéralisation entachée d'étatisme et d'interventionnisme. Comme le titre du fil le précisait maladroitement, je me plaçais dans une situation "optimale" et me demandais si un smic resterait pertinent dans cette situation (et défendais l'affirmative (le "resterait" est taquin, car il suppose que le smic est pertinent dans la France socialiste d'aujourd'hui !)). Donc bref, ce qui me chiffonne dans Coase (qui d'ailleurs aurait été farouchement opposé au smic puisqu'il ne pense pas que les externalités négatives du marché doivent être internalisées dans l'économie par l'État -> taxe pigouvienne, tout type de réglementation en fait, et je ne suis pas assez marteau pour défendre l'idée que le smic ou le basic income ne seraient pas des réglementations !), c'est cette histoire de "increase wealth by the greatest amount" : s'il s'agit d'augmenter maximalement la richesse de l'ouvrier, sa fortune personnelle, son salaire ou s'il s'agit de maximiser la production de l'entreprise, ou si les deux coïncident : that, I cannot decide. 2°) Dommage que tu aies coupé avant "No man's property will ever be safe" parce que j'aurais bien aimé savoir comment il en arrivait là : l'idée est soit que chacun devrait pouvoir jouir de capabilités minimales ou des "capabilités de base" pour reprendre la terminologie de Sen ; si l'allocation de ressources est optimale, c'est-à-dire (dans un sens anti-parétien) qu'elle correspond au plus grand bien du plus grand nombre, cette condition est satisfaite (ce que l'on peut démontrer par l'absurde : si cette condition n'était pas satisfaite, le plus grand nombre (les pauvres) ne jouirait pas des capabilités de base -> ne pourrait pas exercer son droit de propriété (sauf sur son corps me dira-t-on) -> l'individu n'est pas libre. (les sigles -> ne sont pas des implications logiques). Dans cette situation optimale, les ressources étant utilement distribuées, il n'y aucune raison que la propriété ne soit pas garantie. Donc Block se place dans une situation contradictoire : à la fois on est dans le théorème de Coase (qui, rappelons-le quand même, stipule que cette allocation optimale n'est pas le fait de l'État et s'oppose plus généralement à toute réglementation), donc dans une situation d'allocation parfaite des ressources, et en même temps, la propriété serait en danger : mais précisément puisque nous sommes dans une situation coasienne, la propriété est optimalement (j'adore cet adjectif, je pense que ça se voit, donc je l'adverbialise) répartie. Le problème que me poserait le bannissement de la comparaison des préférences interpersonnelles est qu'elle empêche tout jugement sur le degré d'égalité ou d'inégalité d'une situation à partir du moment où l'on abandonne la position cardinale pour adopter l'ordinale, ce qui ôterait donc sa légitimité à l'approche utilitariste. 3°) Pour sortir de ce mauvais pas, il faut distinguer deux choses : une position utilitariste consistant, comme Pareto, à comparer les utilités sans prendre en compte les agents (l'utilité d'un riche = l'utilité d'un pauvre, pour simplifier, ce qui revient à défendre une sociologie anormative) et une approche utilitariste à la Coase consistant à valoriser ce qui est utile à (fin transitive : Hayek dirait qu'on se dirige dangereusement vers une société télocratique) : d'où la question : utile à quoi (richesse globale ou richesse personnelle) ? C'est la valeur et la limite du conséquentialisme utilitariste : il ne se préoccupe ni de savoir qui est l'agent ni même de savoir comment l'action est exécutée. Autrement dit, l'utilitarisme est difficile à concilier avec une approche normative. En fait, la conséquence, dans l'approche conséquentialiste, a même tendance à uniformiser rétrospectivement des actions hétérogènes et normativement antithétiques pourvu qu'elles aboutissent au même résultat. D'un autre point de vue, l'utilitarisme donne à voir les limites d'une société strictement nomocratique (qui ne donne qu'un cadre légal sans se préoccuper des fins). L'opposition caricaturale que fait Garapon entre régulation et justice découle de ce questionnement, auquel je ne prétends pas apporter LA réponse. Je peux formuler une hypothèse (arendtienne) : l'homme serait la seule chose existante qui échappe à la quantification ou à l'ordination utilitaire (transitive : ce en vue de quoi les ressources sont allouées) : il est une fin en soi. C'est pourquoi, dans une réflexion économique, je recentrerais l'allocation des ressources vers la satisfaction de la liberté individuelle et donc de la propriété individuelle et non vers la maximisation de la richesse du pays ou de la société (PIB). Pardon de dépasser la catégorie du fil ("économie") mais il me semble que cette réorientation au-delà du primat utilitariste est la condition de la politique : si l'allocation de ressources est seulement et optimalement réalisée par le marché, l'espace public et l'espace politique disparaissent. Je ne crois donc pas me reconnaître dans l'utilitarisme de Coase, que je ne connais, toutefois, que de seconde main (et que la citation de Block ne donne pas envie de travailler plus avant !). En dehors de la citation passionnante de Block, pour conclure, je reviendrais sur le passage qui ouvrait ton message : Il me semble avoir été clair mais au cas où : en effet je ne justifie pas la légitimité de la propriété privée d'un point de vue historique mais pas non plus en vue de la maximisation de richesses globales (bref, il faut définir ce qu'on entend par "richesses" dans ton message, car seule la richesse individuelle permet la maximisation des capabilités, car des capabilités interpersonnelles ou globales, c'est oxymorique (sinon Sen n'aurait rien à redire à la philosophie utilitariste et le monde serait bien plus simple comme ça)). J'ajoute en relisant avant d'envoyer cette réponse une remarque sur l'argument qui m'a été opposé de la première propriété qui est celle du corps : c'est ici que la critique que fait Sen de Rawls au sujet de ce que ce dernier appelle les "biens premiers" est pertinente : les biens premiers de Rawls (liberté de circulation par exemple) doivent être rapportés à la capabilité de l'agent : un handicapé n'a pas la même capabilité vis-à-vis de son corps, la même liberté de circulation, que moi.
-
Alors est-ce que ce serait plus simple dans un système dans lequel la monnaie serait reliée à un étalon (l'étalon-or ou n'importe quel étalon métallique, Rincevent m'ayant expliqué que n'importe quelle marchandise simple et limitée en quantité "peut faire l'affaire") ?