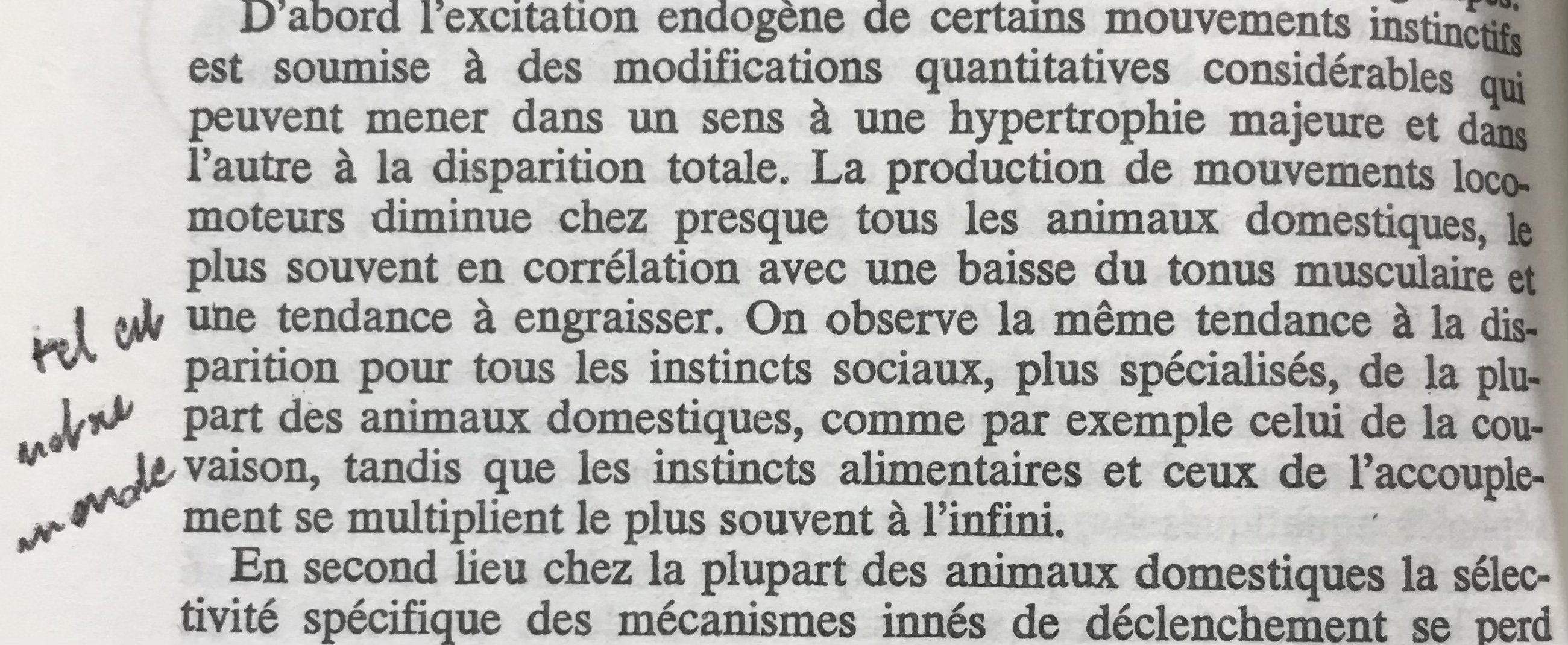-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-

Problème dur de la conscience, survivre à sa mort, et autres billevesées
Vilfredo a répondu à un sujet de Jesrad dans Science et technologie
Parce que seuls les etres conscients souffrent et que la souffrance est généralement observable -

Problème dur de la conscience, survivre à sa mort, et autres billevesées
Vilfredo a répondu à un sujet de Jesrad dans Science et technologie
Ben ça se discute ça. La douleur par exemple. -
Cela dit c'est une bonne question à laquelle aucune réponse objective n'est possible qui se pose: quel type de personnalité est le plus fun?
-
Google dit que Thatcher était ENTJ. Donc sourire qui fout la trouille, check, mais humour noir, check aussi.
-
Oui, très, dans le genre ENTJ (ne s'intéresse pas aux problèmes abstraits, connaît des masses de faits comme un INTP mais les intègre à son système prédéterminé (Ni/Se, comme un INTJ), mais avec une pensée bien, bien extravertie (débat de tout et n'importe quoi) et un sentiment bien, bien introverti (rien à branler de ce que le groupe pense)). Enfin là je pense à une personne en particulier. Que j'aime bien d'ailleurs. Un truc bien avec les ENTJs c'est notamment leur humour noir. On partage ça avec eux, nous, les INTJs. Après on est un peu dans deux mondes parce que eux, évidemment, ont une connaissance factuelle détaillée du monde, de l'économie, de la sociologie, de la physique etc. (le mieux est d'adopter l'attitude petersonienne de: j'ai deux raisons de l'écouter et de ne pas parler: 1) il va m'apprendre des choses 2) il a visiblement envie de montrer qu'il en connaît plein) alors que moi je ne connais rien à la réalité et je m'informe sur le monde en lisant Hegel. Donc même si on s'accorde à définir l'intelligence en termes de problem solving, moi je poserais le problème en termes toujours beaucoup plus abstraits que eux. Les discussions qui ne sont pas des discussions d'idées ne m'intéressent pas. Eux, si, avec ce travers inverse qui est que tout aspect de la réalité devient objet de discussion et de débat. Ils peuvent te faire des "topos". Vraiment pas le genre à être unaware of his physical environment, il connaît (ou croit ou veut connaître) la structure de la réalité pour conformer son action avec elle. A l'inverse, si je lis un bouquin de pop science (ce que j'adore faire), je le lis juste pour trouver des idées qui m'occupent l'esprit. Donc je ne peux pas vraiment entrer dans une conversation avec eux et je ne peux surtout pas les contredire. C'est étrange, j'ai assez peu d'idées arrêtées sur quoi que ce soit (je peux passer comme en ce moment deux mois à lire de la psychanalyse, puis je vais peut-être lire tout Etienne Gilson, sans dévier de mon travail de recherche le reste du temps, je peux même écouter Zizek faire l'éloge du socialisme et en tirer des idées intéressantes ou un problème pertinent), par contre, j'aime défendre des idées dans lesquelles je ne crois pas forcément (je ne sais même pas ce que ça veut dire: il y a très peu de convictions viscérales chez moi, je crois que je ne pourrais par exemple jamais être croyant ou ce genre de choses, je suis trop névrotique postmoderne) juste pour voir, ce qui prend la forme de: et si on considérait tel point de vue, juste pour voir? Quelles sont vos raisons de ne pas penser telle chose? Ils détestent cette approche: si tu as un argument, il faut que tu le défendes with facts and logic comme dans un débat politique un peu. Alors que j'aime bien réfléchir à des trucs comme ça complètement contre-intuitifs, ce qui s'attire juste des we don't do that here. En gros c'est un peu comme s'ils jouaient à un jeu et que j'arrêtais pas de dire "pouce, je voudrais changer les règles". Beaucoup de discussions ressemblent à ça. Bref, c'est la rencontre entre un étudiant de philo et un étudiant en sciences sociales (du genre qui sait coder, pas du genre qui bloque Tolbiac). C'est quand même difficile d'évaluer l'intelligence d'un type psychologique différent du tien. Ils sont intelligents mais pas de façon fun. Ce n'était pas exactement ta question mais c'est ma réponse. Ce genre de réponses me fait penser à la pensée de Pascal où il dit que "la justice et la vérité sont deux pointes si subtiles que nos instruments sont trop mousses pour y toucher exactement. S'ils y arrivent, ils en écachent la pointe et appuient tout autour plus sur le faux que sur le vrai." Je réponds à ta question et à d'autres trucs que tu ne demandais pas, parce que mes instruments sont trop mousses. Si la modo pouvait rétablir les surnoms, je m'appellerais "Petit Mousse". Celui qu'on mange.
-

Pécresse, candidate LR
Vilfredo a répondu à un sujet de Sekonda dans Politique, droit et questions de société
Cette élection c'est plutôt L'Attaque des clones de Macron- 381 réponses
-
- 10
-

-

-

-

-
Ah oui pardon. Je ne dirai rien parce que je connais les auteurs. Je dirai seulement que l'un d'eux sait très bien faire les gin tonic.
-
Pourquoi l'ENS? Je veux dire, oui, il y a des semi-deficiente à l'ENS et bientôt des couloirs non-mixtes (mais juste pour ceux qui veulent, manquerait plus que ce soit l'inverse), mais le rapport avec cet article?
-
Je viens de revoir The Silence of the Lambs. Ce film est absolument prodigieux, et j'avais oublié le génie de l'évasion de Lecter. Je suis béat d'admiration.
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Oui c'est ça. Rigoureusement en effet, L'Incorrect est plus proche de Philitt et de Limites (en plus à droite pour la dernière, en moins bien pour la première revue). C'est pas mal Eléments. Dans ma période rebelle ado, je l'achetais souvent (pendant un an environ). -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Réac, se prétend rebelle et provocant, intello prétentieux, arrogant, insupportable. Pourquoi? Politiquement c'est entre Eléments et Causeur. -

Z, Pétain et les Juifs, une histoire nazie
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Je pensais à Heidegger et pas à Adorno (que je connais presque pas). Il y a une conférence célèbre intitulée Das Gefahr ("Le Danger") citée par Agamben dans Auschwitz, l'archive, le témoin, où il explique que la différence entre l'extermination et tout ce qui a pu précéder est qu'on ne tue pas des hommes, on fabrique des cadavres. On pense qu'il avait vu, comme tout le monde quand les camps ont ouvert, les images des cadavres squelettiques soulevés par des monte-charges. De diverses façons (je renvoie à Agamben pour ceux que ça intéresse), l'homme est privé de sa mort propre, d'une expérience personnelle de la mort, par exemple parce qu'il vit dans l'odeur pestilentielle des corps brûlés. C'est ici qu'intervient la figure du "musulman", qui incarne à elle seule la nouveauté qu'Auschwitz a introduite dans l'histoire: ce que Heidegger appelle la mort non morte (ungestorbene Tod), ce qui prend aussi son sens pour qui revient à Être et Temps et à l'être pour la mort, càd la mort comme possibilité de l'impossibilité de toute existence, le vide intégral qui rend rétrospectivement possible mon existence factice dans le monde quotidien (le monde du "On"). Mais ce rapport n'est plus possible quand le monde du quotidien est la mort. Adorno lui-même (je m'appuie sur Agamben) ne partage pas cette analyse. Il se moque de l'idée de "mort propre" (qui remonte à Rilke). Auschwitz est à la fois le triomphe de la mort (la mort partout, tout le temps) et son avilissement suprême, de la besogne des Sonderkommando aux chambres à gaz et aux fours. J'ai lu le livre de Agamben ces derniers jours justement, c'est un livre formidable. C'est une perspective très intéressante, même si du coup la raison ressort renforcée de cette "humiliation". Ce n'est pas parce qu'on a un folklore à côté que ça "humilie" les progrès scientifiques sur lesquels les nazis comptaient pour remporter la guerre. Et il y a une dimension très "scientifique" aussi dans leurs mythes raciaux. Je ne vois pas bien comment on peut humilier la raison sans la faire triompher, à moins d'entrer en religion (le seul domaine dans lequel l'humiliation de la raison soit compréhensible pour moi). Ce qui, d'ailleurs, nous ramène au thème de la religion séculaire. J'ai une autre lecture, plus politique, du mythe: je le vois, avec Schmitt, comme le fondement alternatif au droit (naturel ou positif) de la légitimité politique. Dans le domaine politique, la raison ne peut servir de principe unificateur de la Volksgemeinschaft. Pour s'insurger, comme disait Sorel, l'homme a d'abord besoin d'un grand mythe. Ici, on a effectivement quelque chose d'assez anti-Lumières (la pensée des droits en dérivant pour beaucoup); par contre, sa mise en place pratique, avec d'une part le regain du nationalisme allemand et d'autre part, la place de l'Etat, qui n'est pas énorme et centralisé comme dans le socialisme, mais fractionné en corporations toutes unifiées dans la seule autorité du Führer, seul principe de légitimité, ça c'est résolument moderne. Même les mythes ancestraux sur les juifs sont corrigés pour intégrer le vocabulaire et les motivations scientifiques (les images modernes d'infection, de parasites). La personnalisation du pouvoir, qui est un corrélaire de ce mythe, est résolument moderne (parce que ce n'est plus une personnalisation légitimée par la transcendance, mon fil rouge). C'est l'hybris, l'homme sans Dieu etc. Oui là je suis d'accord. Carl Gustav? Le psychanalyste suisse qui travaillait pour les espions américains? Je ne connais pas bien ses livres (j'ai lu Introduction à la psychologie de l'inconscient et Analytical Psychology sans enthousiasme; ses contributions à la psychanalyse avant sa rupture avec Freud sont souvent louées mais à part le complexe d'Electre je ne vois pas trop de quoi on parle; j'ai eu parfois entre les mains ses livres plus politiques comme L'Homme à la découverte de son âme ou Présent et avenir et ça ressemblait plus à du Jordan Morgan Peterson Freeman qu'à du nazisme-ish). J'en parlais à propos de la swastika, je ne vois pas bien ce qu'ils ont de romantiques. Je pense là au livre de MH Abrams sur le romantisme, The Mirror and the Lamp, qui explique que l'art, pour les romantiques, est une lumière qui vient de la subjectivité et illumine le monde ('Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings'), et si nous ne pouvons pas changer le monde, nous pouvons au moins nous changer nous-mêmes ("Poets are the unacknowledged legislators of the world.") Selon Abrams, ce renversement résulte de l'internalisation de la désillusion ressentie (par exemple par Kant ou Fichte, et en Angleterre par Coleridge) à la suite de la Révolution. Donc j'ai du mal à voir dans le nazisme du romantisme politique, surtout quand on connaît l'analyse qu'en donne Schmitt dans ce qui doit être son premier livre, justement nommé Romantisme politique (1919). Pour lui, l'esthétique du spectateur passif élaborée par le romantisme aboutit à une forme d'apolitisme. Le mythe, dont il commence à parler dans son grand article de 1923 (La Théorie politique du mythe), est justement censé aller contre cette tendance en fait 'bourgeoise'. Je veux bien que tu en dises plus parce que je pense plutôt le contraire: Nietzsche a été très clair dans ses livres publiés (ne me sortez pas une lettre de quand il avait 25 ans) sur sa condamnation radicale de toute forme d'antisémitisme, haïssait toutes les manifestations du nationalisme allemand et craignait comme la peste les conséquences politiques du nihilisme. Si ça en fait un penseur douteux ou compromettant ou pas assez clair, je ne sais pas qui trouvera grâce à tes yeux. -
Je sors d'un cours sur zoom donc je ne sais pas si c'est objectivement drôle ou si ça reflète juste mon stream of consciousness ces deux dernières heures.
-

Z, Pétain et les Juifs, une histoire nazie
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
C'est très gentil de ta part, merci, mais j'ai accès par la Sorbonne -
When she goes to the dance club She seems so shy and alone Until the music she wants comes on And, boy, then she's out on her own ❤️ ❤️ ❤️
-
-

Z, Pétain et les Juifs, une histoire nazie
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Certes mais pour les standards d’un pays occupé, tout ce “zèle” doit être relativisé. Mais je ne savais pas que Hilberg était aussi dépassé dans l’historiographie. Les historiens qui valident pourtant l’intention de Petain sont nombreux donc il faudra lire Friedlander pour voir -

Z, Pétain et les Juifs, une histoire nazie
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
My point c'est juste que Vichy a déporté prioritairement les juifs étrangers et que c'est pas un artefact statistique mais la volonté de Pétain. Rien de ce que dit Poliakov n'infirme ça. Pour la généalogie de l'argument, je ne peux que t'inviter à lire Hilberg et Poliakov qui écrivent littéralement que Vichy a "sauvé" des juifs (ce sont leurs mots). Mais j'écouterai le podcast de Laurent Joly, sans doute mieux que le résumé qui en est fait dans la vidéo, et je prends note du point sur le rôle sélectif de la population. Bah non c'est pas vraiment maigre, c'est ce qui distingue l'extermination des autres génocides qui l'ont précédée. Ça ressort bien à la fois des récits de déportés et de certaines analyses philosophiques. C'est la vérité instrumentale qui s'oppose à la vérité révélée. C’est sur la base de cette nouvelle conception de la raison (dans la mesure où elle est l'outil d'accès à la vérité) qu’est défendue la nécessité de sa publicité, par exemple par Kant (l’intersubjectivité devient une condition d’accès à la vérité). Oui mais il n'y a pas vraiment de corrélation, ou du moins c'est discutable (je disais que les deux hypothèses étaient intéressantes, mais clairement je préfère celle que je défends ici). Le romantisme allemand ça va de la défense exaltée de la religion chrétienne de Fichte (on sait ce que vaut le christianisme des nazis), c'est Stefan George, qui était opposé au nazisme (quoique de droite), c'est éventuellement vaguement Nietzsche, tout sauf un nazi... Et puis il y a des romantiques allemands très pro-Lumières, et pas vraiment mineurs (Heine, Goethe qui adore Napoléon, pourquoi pas Hegel, surtout si on ne le lit pas comme Popper). Et les romantiques anglais sont tout aussi vindicatifs contre les Lumières. On reconstruit une généalogie du nazisme complètement a posteriori. Je faisais référence à la thèse plus précise qui voit dans le totalitarisme une religion séculaire. On en trouve des échos un peu partout: dans Voegelin, Monnerot, Gauchet et dans n'importe quelle bonne histoire de l'URSS (le mausolée de Lénine et ce genre de folklore). Les Lumières ne sont pas un courant anti-religieux. C'est plutôt un courant contre l'Eglise catholique romaine à l'époque. Tous les grands arguments finalistes sur la nature viennent d'hommes des Lumières par exemple (à commencer par Newton). Mais il y a une perversion de la religion (le "dieu des philosophes"), un éloignement incontestable du dogme, même si on en est pas encore à Darwin. Si on entre dans cette lecture de religion séculaire, alors force est de constater que Hitler est assez loin du pape. Après je suis pas fou au point de dire que Voltaire et Kant étaient proto-nazis. Mais c'est très intéressant de voir que quand Eichmann justifie ses actions à Jérusalem, il ne va pas te citer Nietzsche ou les romantiques allemands et partir dans une diatribe heideggérienne contre le Gestell et la raison. Il cite Kant. Il raconte absolument n'importe quoi sur Kant, mais ça fait pour lui figure d'autorité. Je crois que ça ressort d'une forme d'invention de la tradition. Je dirais donc avant tout que ces constructions rétrospectives sont douteuses et ensuite que je trouve un grand mérite à la lecture "théologie politique", qui voit effectivement de très haut l'histoire précise des idées, pour s'intéresser à la modification de la conception de l'homme. Là-dessus Lubac est magnifique mais je n'ai pas le bouquin sous la main malheureusement (dans Le Drame de l'humanisme athée). On pourrait dire que sa thèse est que les Lumières ont rendu possible leur propre perversion en ne fixant pas d'idée au-dessus de l'homme, rendant in fine impossible une idée claire de l'homme, digne de respect, ce qui le laisse "up for grabs". J'aime énormément Lubac. Il écrit très bien. Je ne trouve pas mais on peut détailler. Pour commencer, Chapoutot distingue dans son dernier livre la conception de l'histoire nazie, qui se caractérise en fait par une paradoxale peur du temps (haine de la vieillesse, mise en avant des jeunes, ce genre de choses) qui motive une vénération du progrès (le passé terrible de l'humiliation, le futur radieux du Reich: l'humiliation est un fort stimulant du totalitarisme, cf Mao) et de fabrication du passé (les "fausses ruines" de Speer) parce qu'on se projette dans une sorte de "futur passé" (les ruines du Reich de 1000 ans à venir sont déjà là). Ça rejoint un autre livre dont j'ai déjà parlé je crois, L'Invention de la tradition de Hobsbawm et Ranger, qui voit dans ce phénomène (tout est dans le titre) une reprise des politiques coloniales (de l'Allemagne, de l'Italie et de la France) qui recréent un faux passé, une fausse tradition, dans les territoires colonisés. Et la colonisation, c'est très clairement un héritage des Lumières aussi. Comme vous savez, la gauche républicaine était colonisatrice et la droite anti-révolutionnaire non (en gros, pour la France, et jusqu'à 1914). Donc ce terme d'"invention de la tradition" me paraît bien capturer ce rapport étrange et nouveau au temps qui va de la Révolution (nouveau calendrier, nouvelle religion) au totalitarisme. Là je ne suis pas d'accord avec quelqu'un que j'aime bien défendre d'habitude pour amuser la galerie, à savoir Nolte, qui a cette lecture vaguement poppérienne qui consiste à dire que le nazisme et le fascisme sont contre les Lumières parce que les Lumières veulent créer un homme nouveau détaché des traditions. Sauf que le nazisme veut aussi créer un homme nouveau, pas détaché de toute tradition, mais rattaché à des traditions inventées qui constituent un patchwork bordélique de références hindoues (la swastika, c'est pas vraiment une vieille tradition allemande, ça remonte aux cercles Völkisch des années 20 si je ne m'abuse, et puis le soleil noir des SS), astrologiques, médiévales (Henri le Lion), chrétiennes, grecques... C'est pas étonnant que pas mal de "vrais" conservateurs style Van den Bruck et Spengler trouvent ça grotesque. Et ça tombe bien parce que les Lumières n'ont jamais voulu séparer l'homme de toute tradition civile ou religieuse (on ne lit pas ça dans Rousseau par exemple, dont Constant se moque en disant qu'il veut nous ramener aux Grecs). Ça, c'est la caricature qu'en donnent les penseurs contre-révolutionnaires comme Burke quand il bitche sur les "philosophes parisiens". Mais en un sens, Burke c'est un peu les Lumières aussi. Il est plus proche des Lumières écossaises que de William Blake. Donc c'est pas vraiment les Lumières qui sont mal définies, c'est plutôt cette catégorie d'anti-Lumières (où Sternhell, par exemple, range Burke), qui, à la différence des Lumières, n'a aucune consistance. C'est "tout ce qui n'est pas X". On n'a jamais constitué des courants d'idées comme ça. Vous savez aussi à quel point les nazis vénéraient Kant et Goethe (le chêne de Goethe au milieu de Buchenwald), la quintessence des Lumières allemandes, de la haute culture allemande tout court en fait. Il y a un côté révolutionnaire dans le nazisme (qu'il n'y a pas du tout chez les anti-Lumières comme Maistre, précisément parce qu'ils sont religieux au sens propre, contrairement aux nazis) qui est qu'on va brûler le monde, détruire la culture, mais il y a aussi un intérêt aigu des nazis pour l'art, pour le progrès scientifique, et la recherche scientifique jusque dans les opérations les plus morbides pour améliorer l'homme. Je sais qu'on peut dire que c'est facile de ramener tout ça à un divorce d'avec la religion mais c'est difficile de ne pas avoir envie. On trouve aussi ce contraste dans le fait que de très nombreux artistes non pas vieillots réacs et peintres de croûtes mais au top du top de la modernité et de l'avant-garde rallient le nazisme ou le fascisme: c'est Pound, Benn, Marinetti, De Chirico, Blanchot, Riefenstahl, Morand, Wyndham Lewis et j'en passe. C'est bien résumé dans le futurisme, qui ne se caractérise pas vraiment par son adoration de la ruralité profonde contre la rationalité de la ville. Cette discussion nous emmènerait sur le rapport des nazis à l'art, et à cet étonnement éternel de: comment des gens cultivés peuvent-ils commettre de telles atrocités? Je trouve ça parfaitement cohérent. A la limite, comme Max Von Sydow dans Woody Allen, je me demande plutôt pourquoi ça n'arrive pas plus souvent. Merci beaucoup. Le point qu'il souligne, outre ce que corrigeait déjà @Rincevent, c'est que Vichy le faisait pour des raisons d'opinion. J'ai jamais pensé que Pétain était philosémite donc ça ne me surprend pas beaucoup. C'est important de préciser les motivations de cette déportation sélective, mais elle n'en est pas moins sélective. -

Z, Pétain et les Juifs, une histoire nazie
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Ah d'accord, merci. Enfin c'était aussi facilité, j'imagine, par l'existence de la zone libre, qui a été obtenue à l'armistice. Donc en conformité avec l'intention de Pétain, sinon de Vichy. -

Z, Pétain et les Juifs, une histoire nazie
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Oui, sans rire, vraiment beaucoup. Avant j'avais l'attitude zen/Bret Easton Ellis-inspired de laisser filer. Depuis deux trois trucs où on a commencé à me faire chier pour ce que je pensais, je suis beaucoup plus dans une "toi je vais pas te rater" attitude. C'est assez général. J'imagine que ça s'appelle "libérer l'INTJ qui est en moi". Premièrement je ne parle pas du fait que 75% des juifs ont échappé à la déportation, je parle de la différence entre juifs français et étrangers (selon les lois de Vichy). Ensuite, on serait bien en peine de dire ce qui change par rapport à ça dans les "positions ultérieures" de Poliakov: not my point ah tiens: my point again, my point i guess that's my point exactly doesn't it look like my point? Oui bien sûr tout le monde croyait que Vichy faisait ça pour être gentil. Il nous prend pour des cons en plus. Je prends ça pour une nouvelle confirmation de my point Après il ajoute que la population a aidé. Evidemment. Peut-être même que son rôle a été décisif. Il n'en est pas moins vrai que les juifs étrangers (selon les lois de Vichy) étaient déportés en priorité dans la plupart des cas. Par ailleurs, cet argument de la population n'explique pas pourquoi ce sont les juifs français qui ont davantage survécu que les juifs étrangers. La population sauvait prioritairement les juifs français? Wtf? Il faut il est vrai distinguer aussi au sein de l'Etat, entre Laval/Pétain et la police de Bousquet, beaucoup plus radicale: https://fr.wikipedia.org/wiki/Collaboration_policière_sous_le_régime_de_Vichy Donc il me semble qu'on voit un peu un pattern se dessiner, assez éloigné de l'idée que ce serait une thèse pro-pétainiste ressortie par le cerveau malade d'un journaliste juif berbère qui souffre de self-hate. Je parlais plutôt de sa conception de ce qui fait un Français. -

Z, Pétain et les Juifs, une histoire nazie
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Et dernière chose mais on a un exemple tellement typique de so you're saying dans la vidéo de NB: le mec qui parle dit: non, la France n'a pas protégé les juifs français, la preuve, il y a eu plus de juifs déportés tout court par Vichy que l'Allemagne en demandait. Mais, mec, ça te provoquerait vraiment une crise cardiaque de rester sur le sujet? Qu'est-ce que tu comprends pas dans: "Juifs étrangers"? Et il conclut: donc non, la France n'a pas protégé les juifs. Mais: Personne. Dit. Ça. Désolé mais j'ai déjà eu cette conversation irl et les gens à qui je parlais m'ont ressorti ce raisonnement absolument lunaire qui consiste à dire: il est faux que Vichy a protégé les juifs français: la preuve, quand on regarde les chiffres, il y a une minorité de juifs français déportés. Et l'étape suivante c'est de me dire que je suis pas objectif sur le sujet ou de m'attribuer je ne sais quelle motivation psychologique inconsciente de self-hating Jew à défendre le nazisme. Je me demande vraiment si ces gens sont complètement cyniques au point de dire une chose et son contraire, ou juste débiles. Pour les historiens ils sont clairement cyniques (ils veulent attaquer Zemmour, Zemmour l'a bien cherché, c'est de bonne guerre). Pour les gens irl ils sont clairement demeurés. -

Z, Pétain et les Juifs, une histoire nazie
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Sur Voltaire, ce que dit Zemmour n'est pas une idée nouvelle, et ce n'est pas une question pour un historien, encore moins des sciences et des techniques, mais pour un historien des idées. Que Voltaire soit panthéonisé à la Révolution n'en fait pas un penseur révolutionnaire (pas plus que Rousseau). La pensée de Voltaire est beaucoup plus conservatrice que celle de Saint-Just; c'est un admirateur de Colbert et de la puissance de Louis XIV ou de Pierre le Grand. On peut tout à fait argumenter qu'il y a une forme de continuité entre la vision rationalisée du monde prônée par les Lumières et la rationalisation de la mort pour les nazis. On peut aussi voir un rapport si on regarde les deux phénomènes comme des conséquences de la sécularisation. On peut enfin les voir comme des témoignages d'une croyance dans le progrès de l'espèce humaine, en rupture avec les conceptions cycliques du temps et de l'histoire pré-modernes. Bien sûr, ce dernier point est en connexion avec le deuxième, l'idée de progès étant un exemple paradigmatique de pensée sécularisée de la politique (relisez John Gray). Je n'exclus pas que dans le passage cité, Z dise des âneries. Mais on peut faire un lien entre anti-Lumières et nazisme (Sternhell) ou l'inverse. Les deux sont intéressants. Sur les juifs français: non, ce n'est pas un argument classique des pétainistes. C'est écrit noir sur blanc dans La Destruction des juifs d'Europe de Raul Hilberg, le livre de référence dans l'historiographie sur la Shoah (edit et qui date de 1961), et aussi dans Le Bréviaire de la haine d'un autre historien de renom mondial, Léon Poliakov. Ce n'est d'ailleurs un mystère pour personne. Il l'a réitéré ensuite. (Tout en disant, comme le précise l'auteur du post, que ce n'était pas par humanité, no shit.) Plutôt que de nier ce fait, ou de se lancer des procès d'intention (-- Vichy a déporté les juifs étrangers en priorité par rapport aux juifs français -- So you're saying qu'on devrait déporter les étrangers?), il faut le comprendre: Vichy dénaturalise, on le sait, beaucoup de juifs auparavant français et qui ne le sont plus (abrogation du décret Crémieux etc). Ça ne sert à rien de changer de sujet en disant, comme elle le fait: mais Vichy a aussi persécuté les juifs français (spoliation etc). Là encore, c'est du pur so you're saying que les juifs français s'amusaient comme des fous sous Vichy? Non bordel je dis juste qu'ils ne sont pas morts. Et le comble de ce truc c'est qu'elle donne raison à Zemmour avec les chiffres de la fin: sur 74k juifs déportés seulement 24k sont français. Ça fait un tiers. Donc c'est bien une majorité de juifs étrangers et une minorité de juifs français. My. Fucking. Point. A cela, deux réponses possibles: cette abrogation est illégitime, et c'est certain, mais de ça on ne peut pas déduire qu'ils sont toujours français (ils ne sont pas français s'ils sont considérés comme étrangers par l'Etat). On peut dire: c'est illégitime qu'ils ne soient plus français, mais ça confirme bien qu'ils ne le sont plus. Ou alors on considère qu'être français n'est pas seulement un statut légal, que c'est quelque chose de culturel, ce qui est bien la position de Zemmour. Et justement, ces juifs fraîchement francisés, Zemmour ne les considèrent peut-être pas comme vraiment français (pas assez assimilés peut-être). Cette controverse ne fait qu'interroger le rapport des Français à la loi, leur respect pour le positivisme juridique d'un côté, et l'inspiration maurrassienne de Zemmour de l'autre. Bon sur le reste j'y connais rien et Zemmour est jeté donc c'est très probablement vrai. Mais parfois, surtout sur le truc des Lumières, je me dis que les historiens répondent mesquinement sur des sujets qui demandent un traitement conceptuel et pas seulement factuel. Et puis je me dis aussi qu'il est fort possible que la nouille qui fait la présentation donne une assez mauvaise idée de ce qu'ont effectivement écrit les historiens (notamment Laurent Joly). Elle a l'air d'avoir découvert la veille l'existence du "plan Constantine" et elle confond 1949 et 1939 donc j'ai mes doutes sur son QI. -
= n'importe quelle dictature Le reste répète ça avec les termes connotés seconde guerre donc l'argument est circulaire.
-
J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as besoin que ça soit le nazisme (et tant pis si ça n'a rien à voir) pour te réveiller puisque tu nous bassines avec le petit moustachu régulièrement. Contrairement à toi, beaucoup ici n'ont pas besoin de convoquer la Shoah ou de se donner des grands airs pour réagir, écrire, manifester etc.
-

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron
Vilfredo a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société
+1 Et honnêtement vu la phrase qu’il emploie je soupçonne fort le trolling ou la parade virile pour s’échapper d’une situation embarrassante. C’est aussi une réaction typique d’homme de pouvoir: c’est moi qui te protège, je suis le chef de la police, je suis surpuissant, ça va bien se passer (comprendre: me casse pas les couilles)