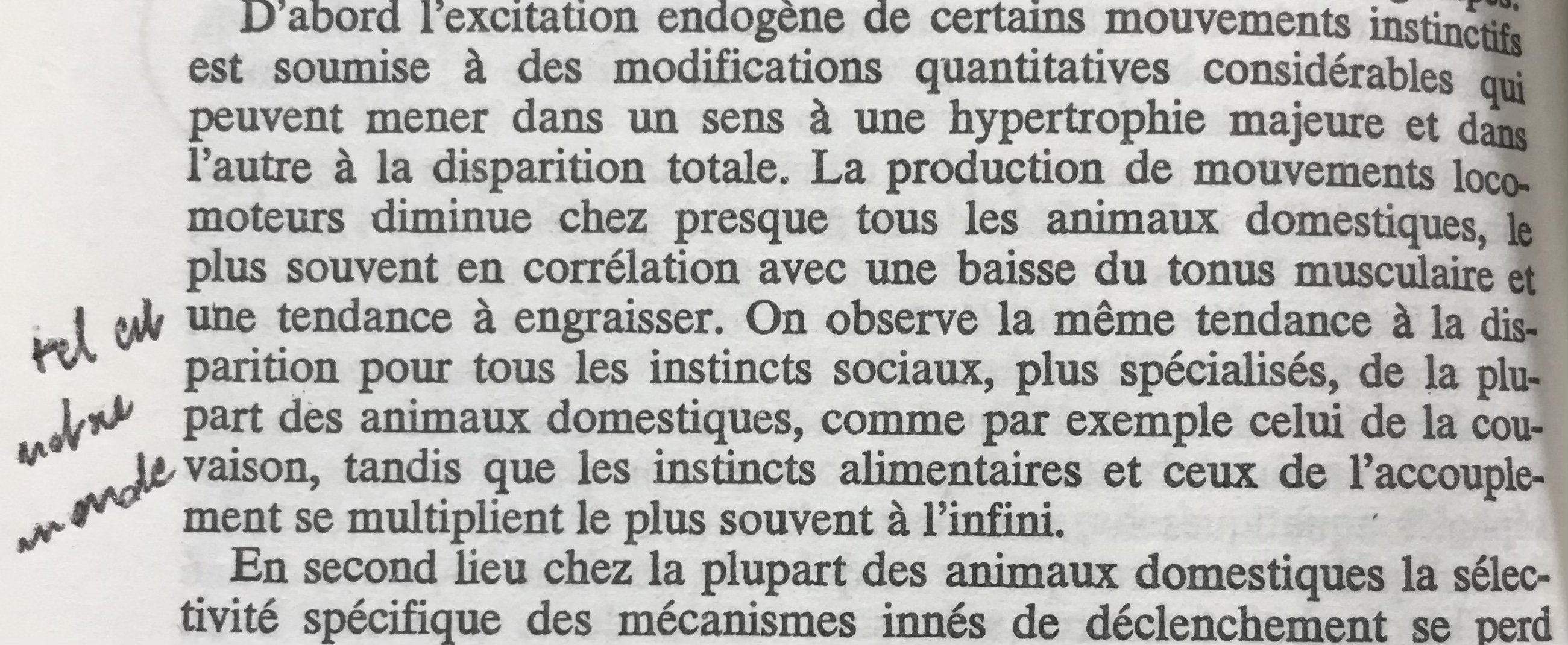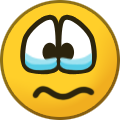-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
chaque jour je deviens un peu plus l’INTJ que je suis
-
Non je répondais à Mathieu sur Barres
-
Les généraux romains, le jour de leur triomphe, étaient accompagnés tout du long par un jeune garçon qui leur chuchotait à l’oreille, pour vaincre leur orgueil: souviens-toi que tu vas mourir. Moi c’est souviens-toi que tu vas écrire un article sur le Roman de l’énergie nationale. En vrai depuis tout ce temps j’ai lu un peu Leurs figures et c’est intéressant historiquement et tout et aussi Mes Cahiers (ennui mortel) mais je vois vraiment rien à commenter dans ce monde peuplé de stéréotypes (les femmes qui vont de la sainte vierge Bérénice à l’orientale mystérieuse Astiné d’Aravian je crois qu’à mon âge je peux m’autoriser d’autres fantasmes). La colline inspirée j’en ai un souvenir horrible. Tu peux toujours lire les articles de cet illuminé de Juan Asencio sur son blog il adore Barrès mais moi non malheureusement. Ce style de bourgeois qui écrit le petit doigt en l’air me met en fuite https://www.juanasensio.com/archive/2019/06/26/maurice-barres-dans-la-zone.html Mais je vais arrêter de promettre des trucs en termes d’articles je crois. La le prochain truc que je ferai ce sera sur le Covid et la dépression (l’Australie je ne trouve rien de spécifique à dire sur: pourquoi dans ce pays précisément? Et j’ai peur de partir dans une caricature de: c’est une île de xénophobes ils ont le fantasme de vivre dans une bulle autosuffisante; mais j’ai bien l’impression que la réponse est plus du type de ce que je disais ailleurs sur la culture et la violence que du type d’une analyse institutionnelle ou politique) mais je peux pas me forcer à lire des trucs. J’ai passé ma prépa à faire ça maintenant non. Même pour un cours d’anglais je devais lire un roman post colonial sur un pauvre homo indien immigre j’ai jeté le livre à travers ma chambre au bout de quarante pages (Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia) et je me suis fait dispenser du cours. edit J’ai aussi appris dans mes recherches infructueuses le nom du spécialiste fr de Barres, Vital Rambaud. Pierre Glaudes connaît bien aussi
-
C’est de l’édification chrétienne comme tous les volumes des Signature Classics. Celui-ci est essentiellement consacré à la nécessité d’une borne transcendante à l’amour humain sous peine de dégénérescence en idolâtrie et en passion pour le plus grand mal de son objet. Il distingue 4 formes d’amour (affection, qu’il analyse très finement, amitié, et le rôle qu’elle joue dans le renforcement de la personnalité individuelle pour le meilleur ou le pire, d’où la méfiance qu’éprouve le pouvoir à son égard, car elle isole les hommes entre eux, amour et charité), à partir de deux tendances que sont l’amour comme besoin et l’amour comme appréciation. C’est inégal, moins bon par exemple que The Problem of Pain ou Miracles parce que parfois trop proche de la psychologie et pas assez de la théologie. Mais CS Lewis est un écrivain remarquable donc c’est toujours extrêmement plaisant à lire. Vers la fin il y a de très belles pages sur la nécessité de ne pas prendre l’amour (humain) trop au sérieux, de ne surtout pas en faire le substitut de la divinité, et sur le fait que la passion la plus apparemment spirituelle, en tant qu’elle est indissolublement liée aux mouvements les plus triviaux du corps, est un signe de l’ironie de notre condition: les plus grands élans d’amour nous rappellent toujours notre état déchu. Je pense lire bientôt Love and Friendship de Allan Bloom pour compléter mon éducation morale.
-

Présidentielles 2022
Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société
Comme le kantisme Moi aussi j'ai envie de voter Le Pen mais pourquoi? Pour voir Macron perdre. Donc c'est purement affectif, pas politique. Si le libéralisme pratique légitime mes passions les plus basses, c'est plutôt le libéralisme pratique qui devrait s'inquiéter. -

Présidentielles 2022
Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société
Il a une conception complètement youkaidi-youkaida de la démocratie mais je suis d'accord avec lui sur probablement autant de points qu'avec Pécresse et plus qu'avec Zemmour et Macron réunis (i.e. 100% de son programme sécurité, 100% de son programme police, pas mal de son programme immigration, famille, drogues). Donc bon. C'est à moitié de la provoc mais en même temps c'est hors de question que je vote, donc si je peux souligner qu'on est aussi socialement éloignés de la droite qu'on est proches économiquement de la gauche, c'est pas plus mal. Et je sais qu'un programme est censé être cohérent et qu'on vote pour le projet d'ensemble mais dans les faits on privilégie toujours un aspect sur un autre si on accepte l'humiliation d'aller voter (e.g. la gauche qui a voté Macron parce que finalement pour elle l'économie est moins importante que le programme social en l'occurrence la politique migratoire). Donc si vous voulez voter à droite très bien, mais c'est pas par libéralisme, c'est juste parce que vous êtes de droite. Si vous voulez voter à gauche, très bien, mais alors vous êtes de gauche. Pour pasticher @Brock, c'est un problème personnel, pas un problème libéral. -
Burke m'ennuie. On peut se sentir chez soi chez les conservateurs, mais ils n'ont pas d'arguments. Leur philosophie est plus proche d'une forme de sagesse, et la sagesse, c'est le contraire de la philosophie (le philosophe n'aimerait pas la sagesse s'il était déjà sage; le sage, en comparaison, me paraît toujours prétentieux). Je sais son importance historique et l'influence de son naturalisme sur le destin du conservatisme, j'ai lu ce qu'en disent Arendt et Strauss. Mais le lire dans le texte n'ajoute ni surprise ni finesse à la version vulgarisée que j'en avais. Soit on est déjà convaincu et on rentre le nez dans les Reflections comme les pieds dans ses pantoufles, soit on ne l'est pas au départ et on continue. Il n'a aucune heuristique générale, aucune idée frappante qui me fait poser le livre et regarder autour de moi comme si le monde était renouvelé par la lecture. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pertinent sur rien ou qu'il ne m'est pas sympathique (au contraire), mais par exemple, quand Strauss écrit que, sous prétexte qu'il dit qu'on ne peut pas implanter des idées abstraction faites de l'histoire de la société à laquelle on veut les appliquer, il ressuscite Aristote, je trouve que c'est un peu poussé. Dans mon histoire anachronique du conservatisme politique, c'est seulement du sous-Hegel (dont la critique de la révolution n'a pas besoin d'un appel au développement organique des peuples, ce qui est aussi bien). Maistre je l'adore pour plein de raisons. C'est un écrivain génial, je l'ai lu jeune et ignorant de toute culture religieuse et il m'a appris la signification du péché et de la grâce (j'ai lu Bloy avant de lire la Bible). Contrairement aux conservateurs il a un système, et même une théodicée. Et c'est un extrémiste, un défenseur de l'inquisition, des croisades, de la guerre comme hygiène des civilisations, donc je me sens davantage sollicité intellectuellement quand je le lis que quand je lis Burke. D'ailleurs si un jour je faisais la liste des livres qui ont changé ma vie quand je les ai lus, Les Soirées de Saint-Pétersbourg seraient bien haut dans le classement. Ce soir je finis The Four Loves de CS Lewis et je reprends les Reflections je vais voir ce que ça donne, même d'un point de vue littéraire comment ça se lit. Si je m'endors habillé je considère que j'avais raison, si je passe la nuit avec Burke je reviendrai faire amende honorable. Dans mon souvenir c'est aussi plein de détails historiques faux très spécifiques et très pas intéressants du tout mais bon on va voir.
-

Présidentielles 2022
Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société
Tiens alors comme ça le nouveau parti anticapitaliste n’est pas capitaliste? ou plutôt est encore moins libéral qu’on croyait? Grande nouvelle -
En tout cas, entre Maistre et Burke, je choisis Maistre every time
-
Oui enfin Burke critique les philosophes français (ou “parisiens”, parmi lesquels il met Rousseau, qui n’est certainement pas parisien et même pas français). Il oppose la spéculation métaphysique sur les modèles de gouvernement (on peut voir dans les premiers chapitres des Considerations on Representative Government de Mill une réponse empiriste à cette attaque) à la pratique politique et à la sagesse de l’histoire (tradition “aristotélicienne” qu’il réintroduit en philosophie politique comme le souligne Strauss). Ce n’est qu’une tradition fort récente en philo analytique qui pratique les expériences de pensée debiles. Wittgenstein ou Quine diraient qu’une expérience de pensée ou le recours à la science fiction ne peuvent pas nous aider à clarifier les concepts que nous utilisons, puisque leur signification dérive de l’usage actuel et passé que nous en avons fait. Et Wilkes ouvre son Real People par un petit rant contre le recours aux expériences de pensée en éthique. C’est donc surtout une manie américaine, héritée du style que Putnam a introduit dans l’écriture de la philosophie, mais c’est vraiment éloigné de l’esprit de Burke. Du reste, la critique de la métaphysique n’est pas exactement étrangère à la philo analytique non plus (historiquement, plutôt Le contraire). Tout cela mis à part, Burke, c’est chouette par moments mais très ennuyeux à lire en entier.
-
Balade ethnologique dans Paris. Tous les parisiens sont masqués. Je vais m’acheter des clopes.
-
Même s’ils sont vaccinés?
-
Elle me rappelle https://en.m.wikipedia.org/wiki/I_Care_a_Lot
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Non décidément je vois pas la blague -
Tiens le masque est à nouveau obligatoire à Paris. Avec le passage plus que probable de mes cours en zoom, je verrai donc des visages humains une fois par semaine le week-end. Et bonne année en avance.
-
on dirait du Céline
-
The way I see it, cet été la grande idée c'était qu'on se vaccine tous et qu'on ne se fasse surtout pas tester, en punissant ceux qui avaient la mauvaise idée de le faire (tests payants). Résultat y avait moins de cas, alors qu'on nous disait aussi depuis le début que le vaccin empêchait pas la transmission. Mais c'est pas grave on s'en fout. Ok. Maintenant on redécouvre la Lune (ie que le vaccin empêche toujours pas la transmission). C'est ridicule mais quand ce gouvernement (ou tout gouvernement) va dans une direction, il faut qu'il y aille tête baissée.
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
— les gens sont cons — mais encore? — les gens sont cons — mais enfin… — les gens sont cons — de grâce expliquez-vous — les gens sont cons En attendant @Wayto, acte I, scène 1 -
We can rest contentedly in our sins and in our stupidities; and anyone who has watched gluttons shoveling down the most exquisite foods as if they did not know what they were eating, will admit that we can ignore even pleasure. But pain insists upon being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain: it is His megaphone to rouse a deaf world. (CS Lewis, The Problem of Pain, Harper Collins, p. 91)
-
-
Quand t'es assis le virus te passe au-dessus des cheveux, connu
-
Ben oui quand même. Les maîtres n'ont pas envie d'être maîtres, à supposer qu'il y en ait. Les philosophes non plus n'ont pas envie de diriger la cité dans Platon. C'est le propre du maître de ne pas vouloir être le maître. Seul l'esclave veut être le maître.
-
Le libéralisme classique (et même la philosophie politique classique) se demandait comment faire pour que les hommes consentent à la loi. Ensuite, dans quels circonstances la désobéissance (prise comme un risque devant continuellement être évité) pouvait être légitime. La nouvelle question du libéralisme: comment faire désobéir les gens?