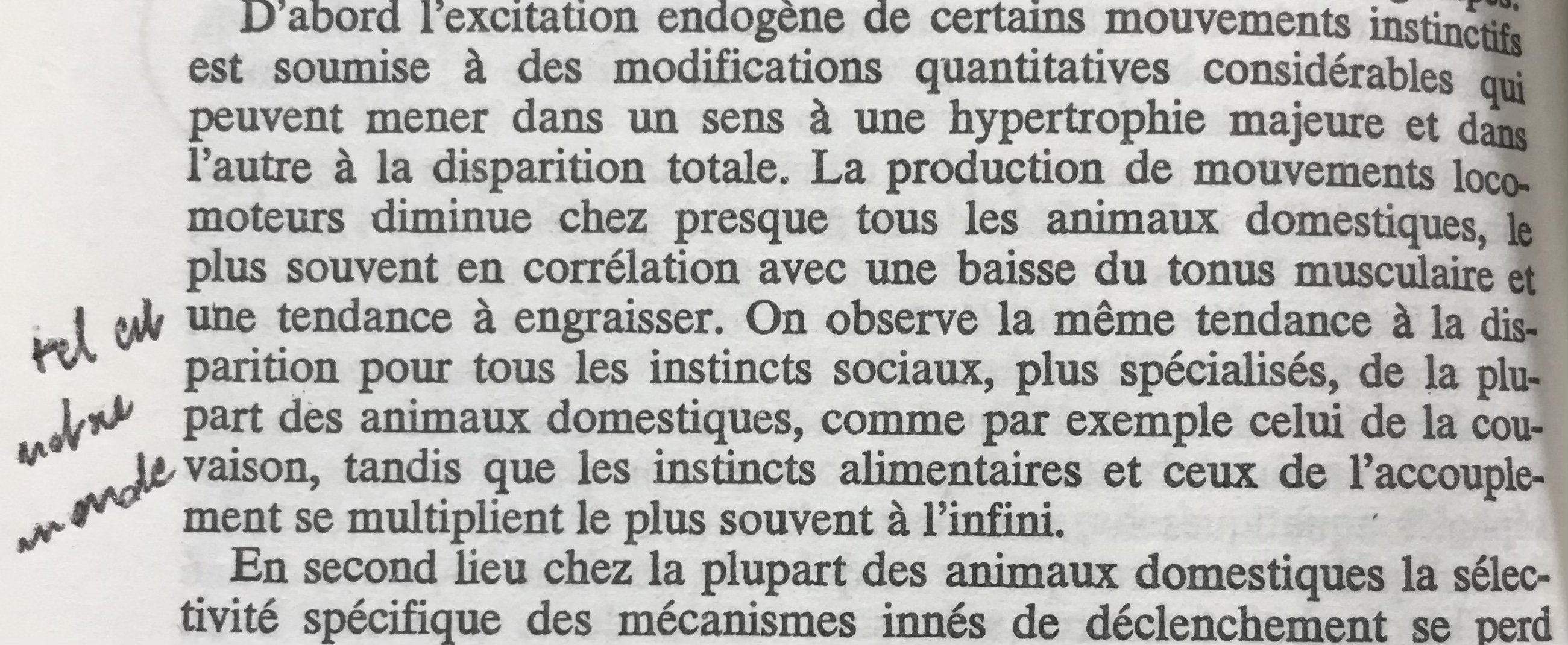-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
Pour le coup c'est l'argument de Nagel contre le physicalisme: l'expérience est vécue d'une certaine façon, et prendre une expérience subjective en lui ôtant la façon dont elle est vécue (ie consciemment), c'est déjà ne plus étudier la même chose. C'est pour ça que Nagel dit qu'on a une conscience à partir du moment où ça a du sens de se poser la question: qu'est-ce que ça fait d'être Vilfredo ou une chauve-souris (vu l'heure qu'il est, peu de différence)? On peut aussi dire que je ne suis pas conscient de toutes les causes infra-conscientes des mouvements de mes membres, mais ces causes ne font pas partie de mon expérience. Hume attaque l’idée de connexion nécessaire à la fois dans les événements mais aussi, on l'oublie, dans les actions. Par exemple, ce à quoi ma volonté, quand je bouge, s’applique immédiatement, n’est pas mes membres, mais les tissus et les esprits animaux de mon corps, dont je ne suis pas conscient. L’esprit veut donc une certaine action, mais ne veut pas les actions intermédiaires qui en permettent la réalisation. Mais, remarque Hume, nous ne pouvons être conscient de l’un sans être conscient de l’autre, puisqu’ils s’enchaînent ! Que le mouvement suive la volonté est donc, comme toutes les autres observations causales, une affaire d’induction (ou un miracle pour Wittgenstein; mais Hume écrit que the fall of a pebble might extinguish the sun, donc il laisse toujours ouverte la possibilité d'une transgression radicale des régularités observées, c'est la base de la riddle of induction). Le "pouvoir" de bouger n’est pas connaissable. Anscombe dirait peut-être que décrire l’action comme "je bouge mon bras" ou "j’entraîne des esprits animaux, des nerfs et des tissus dans un mouvement qui aboutit à ce que mon bras bouge" ne sont que deux descriptions coréférentielles, mais aux valeurs épistémiques différentes, de la même expression d’intention (de même que "Il coupe du bois" et "Il coupe le bois de Harry": je peux reconnaître mon action sous une description et pas sous une autre, et ça fait partie de mon expérience de l'action et donc de la manière dont j'agis.)
-
Oui tu m'avais conseillé de lire Le Code de la conscience. Je vais peut-être créer comme toi un fil genre "neurosciences et phénoménologie - réservé aux philosopheux" pour éviter qu'on vienne ronchonner, j'ai quelques lectures à faire, il y a aussi de nombreux neurobiologistes qui passent leur carrière à faire ce lien (Pankseep apparemment). Non, plutôt comme tu le dis entre une perception optimale, càd économique, et une perception adéquate avec la réalité, sous forme de mapping. Je n'ai pas tes références en neurobio bien sûr mais je crois me souvenir d'un cours de Peterson où il explique que les chats ont des slit eyes parce qu'ils chassent des créatures qui se déplacent latéralement, et pas des kangourous. On peut se demander dans quelle mesure l'environnement social influence aussi le phénotype (les théories de la domestication). Là-dessus Gehlen serait en désaccord avec Lorenz. Je ne sais pas, je me méfie de cette formule (pour vérifier mon intuition je l'ai tapée sur google et même Le Pen la cite) 1) parce que l'usage qui en est fait est parfois celui du réalisme naïf (il y a le sujet, la réalité, boum ils se cognent) 2) parce que Lacan l'emploie dans un sens bien différent, pour ne pas dire complètement opposé. Je viens de la philo analytique donc je tiens à préciser que j'ai autant de mal que tout le monde à comprendre cette littérature, mais je vais essayer d'expliquer ce que je comprends. Le réel, c'est tout ce dont la structure de relations que fait le psychotique ne fait pas sens, tout ce qu'elle rejette pour se maintenir en vie. Je crois que toute personne a pu expérimenter que le fantasme fait tout pour se maintenir en vie (un peu comme un parasite). C'est sur ce genre d'expériences que se base le b.a ba de la psychanalyse. Mais dans le cas où la satisfaction d'une pulsion risquerait de causer ma perte, elle peut aussi être refoulée. Dans le cas du refoulement cependant, les signifiants sont "refoulés" dans l'inconscient. Freud évoque même la possibilité que le mécanisme du refoulement soit à l'origine même de la constitution de cette partie entière du psychisme qu'est l'inconscient. Dans le cas du "rejet" toutefois (la "forclusion" dans le vocabulaire lacanien, qui traduit Verwerfung dans Freud), les signifiants ne sont pas "forclos" dans l'inconscient, "à l'intérieur" du sujet, mais "à l'extérieur", de façon hallucinatoire. Mais bien sûr, ils ne sont pas perçus comme hallucinatoire, car le propre de l'hallucination est de ne pas se laisser voir comme telle. Dans cette (et en fait toute) structure symbolique, il y a donc un point aveugle, un trou, éventuellement le traumatisme autour duquel la psychose s'est construite comme coping mechanism, et ce trou, c'est le réel (Lacan parle aussi de l'"impossible"), et c'est là-dessus que le travail de l'analyse doit permettre de mettre des mots. Au stade de mes lectures, je ne saurais pas répondre à la question: quelle est la différence entre le Réel et l'objet petit a (la cause du désir). Mais je sais que ce qui est rejeté, ce ne sont pas des objets de "la réalité", ce sont bien des signifiants. Lacan reprend la linguistique de Saussure, sauf qu'il ne pense pas que l'articulation signifiant/signifié soit arbitraire; le signifiant forclos par excellence, c'est la castration. Dans les Ecrits, Lacan pose le problème suivant: qu'est-ce qui est rejeté, quand l'enfant refuse la castration? On a beau dire que Lacan est obscur, il pose aussi des questions toutes bêtes de lecteur de Freud. Ça ne peut pas être le "manque" de pénis chez la femme, parce qu'on ne perçoit pas des absences ou des manques. Lacan répond en disant qu'en gros le problème n'est pas: qu'est-ce qui est rejeté, mais: qu'est-ce qui est symbolisé? L'enfant symbolise, càd assimile à son moi, tout sauf le signifiant qui devrait l'être, et il constitue le Réel en tant qu'il est le domaine qui subsiste hors de la symbolisation. "Ce qui a été forclos du symbolique réapparaît dans le réel." Le réel est constitué par l'oeuvre du sujet, même si Lacan ne le dirait pas comme ça. Il ne préexiste pas à la forclusion, qui le découpe d'une certaine manière. C'est ici qu'on voit en quoi Lacan est considéré comme structuraliste: la langue est un découpage synchronique à la fois sémantique et sonore (où les mots commencent et s’arrêtent). Certaines différences vont avoir du sens et pas d’autres. On peut voir ça comme une forme d'axiomatisation, et ramener tout ce que je viens de dire à des choses connues en épistémologie, sauf qu'ici ce qui nous intéresserait, si on veut faire cette analogie, ce n'est pas l'axiomatisation comme systématisation en maths, c'est l'occurrence d'un processus psychique apparemment sans aucun rapport avec l'axiomatisation, mais que Lacan décrit un peu comme tel, afin de pouvoir l'enseigner. Les maths, l'épistémologie, la logique servent à Lacan d'outils pour transmettre un savoir à des futurs psychanalystes. Comment autrement parler à des êtres de pulsions tels que les conçoit la psychanalyse de désir, de frustration, de castration et de psychose? L'approche lacanienne est une dépsychologisation radicale de la psychanalyse, si on veut. Tous les affects sont trompeurs: ils appartiennent soit au registre symbolique, soit à l'imaginaire. Autant je ne veux pas écrire un wot sur Lacan, surtout que j'ai l'impression que les questions de phéno/biologie t'intéressent plus, autant je suis un peu frustré de voir souvent (pas par toi du tout en particulier, mais en général) "le réel c'est quand on se cogne" cité hors contexte. Je vais avoir le temps de me consacrer à la psychanalyse pendant le semestre qui vient. Ce sur quoi je veux insister pour le moment du moins, c'est que, quand on se cogne, on se cogne la tête aux murs d'une structure qu'on a soi-même construite. Pas à un mur "réel" au sens naïf, et pas même au mur de l'intersubjectivité d'autrui, par exemple si j'emploie un mot dans un sens alors qu'il en a un autre. D'ailleurs, quittons Lacan, expérience de pensée: imaginez quelqu'un qui emploie correctement un terme, puis se met à l'employer de travers: est-ce qu'il a su employer ce terme, puis n'a plus su le faire, ou est-ce que le fait qu'il ait à un moment divergé de l'usage montre rétrospectivement qu'en fait, même auparavant, et en dépit des apparences, il n'avait jamais su ce que le mot voulait dire? La première option paraît arbitraire, la deuxième est inquiétante (c'est le risque du quiproquo permanent, un peu comme dans Hume il y a le risque permanent que le soleil ne se lève pas et que la chute d'un caillou détruise le soleil; on ne choisit pas vraiment de l'ignorer, on est "accoutumés" à l'ignorer). Quelque chose qui décrit de façon éclairante ce que l'univers du Réel est en tant que constitué par la forclusion, c'est l'hallucination. A mon tour de citer un (excellent, et très bel) article (ça a aussi l'avantage de raccourcir les messages): http://www.daseinsanalyse.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=60:dastur-f-2332013&catid=2:textes-des-communications&Itemid=16 (Françoise Dastur a aussi écrit quelques très bons livres sur Heidegger.) De même que les affects peuvent décevoir, mais ce sont tout de même des signifiants (un peu comme Descartes dit que, même si ma perception de daltonien peut produire un jugement faux, ma perception n'est pas fausse), de même les hallucinations ne sont pas de fausses perceptions. Maintenant que j'y pense il y aurait des tonnes de choses à écrire sur le type de relation intersubjective bien particulière qui s'établit entre analyste et analysé (les livres de Bruce Fink en parlent, je laisse un article ici aussi: https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2016/05/arcp8gomezcamarena.pdf (ne pas se laisser effrayer par le titre; je le linke aussi parce qu'y est expliqué de façon claire et no-bs l'usage que JL fait de la logique)). Je suis content que ça t'intéresse ("pauvre en instincts"). Gehlen parle aussi, visiblement inspiré par Nietzsche, d'"animal indéterminé" (<==> "pauvre en instincts"). La citation vient encore de Par-delà bien et mal, §62, où Nietzsche déplore que les religions soient utilisées comme fins et non comme moyens d’éducation, ce qu’une institution gehlenienne doit être. La "retardation" de l’homme engendre chez cette espèce un rapport particulièrement déréglé au temps, qui est comme la traduction consciente dans l’existence de l’individu du phénomène hétérochronique qui frappe l’espèce. Les impulsions sexuelles, par exemple, ne sont pas périodiques mais chroniques, et il n'est pas dit que l'environnement "social" nous préserve plus de la surstimulation (le Überraschungsfeld) que la nature. Il n'y a rien qui surstimule dans la nature comme une galerie marchande. Gehlen a déjà en 1940 des pages très dures contre cette ambiance "urbaine", que dirait-il aujourd'hui... C'est ce genre de trucs aussi que j'avais en tête en disant que j'étais pas sûr qu'on rendait le monde plus habitables. C'est aussi quelque chose que Peterson dit quand il se fait lyncher pour évoquer le fait que les femmes devraient peut-être revoir leur dressing code si elles veulent travailler avec des hommes. (J'avais intégré ici moi aussi un long extrait d'un travail que j'ai rendu sur Gehlen mais du coup le message était tellement long que ça devenait ridicule, mais ça portait plus en détails sur cette question justement de l'instinct, du comportement exploratoire, de la différence entre comportement finalisé et comportement "ouvert" (Lorenz parle d'action qui tourne "à vide"), le rôle du jeu, de la différence entre un Umwelt et un "monde d'objets" et en fait la manière dont se constituent collatéralement le corps-vécu (càd le corps non pas physique, mais tel qu'il est expérimenté (les Allemands ont deux mots)) et le monde autour de moi etc. Si ça t'intéresse ou si ça intéresse d'autres gens je peux toujours en parler quand même, mais autant lire Gehlen c'est vraiment bien.) Mais tu as tout à fait raison de parler de comportement stéréotypés, c'est exactement ce que l'homme n'a pas. Pour Gehlen, c'est la faute de la néoténie. Pour Lorenz, c'est la faute de la domestication. Cette deuxième interprétation explique des "vestiges" instinctifs dans le comportement humain, du type de ceux dont parle Darwin dans The Expression of Emotions. Ce qu'il y a de moins sympa dans Gehlen, c'est que cette flexibilité est perçue comme un danger évolutif, la néoténie comme une preuve contre le darwinisme (l'homme est pas adapté tavu) d'où le besoin d'institutions très fortes pour le canaliser. On peut malgré tout comprendre en lisant L'Homme, Urmensch und Spätkultur et Moral und Hypermoral comment le mec a pu apprécier le nazisme. Mais c'est tout de même une question très sérieuse: quel degré de flexibilité est dangereux, et comment s'auto-canaliser ou s'auto-équilibrer, si vraiment nous sommes aussi imbalanced que Gehlen le dit. J'ai cette théorie qu'à la fois les anthropologies ultraconservatrices comme celle de Gehlen, la psychanalyse freudienne (Jung je connais moins mais ça va aussi dans ce sens; je parle de Freud à cause du rôle que joue le Surmoi et la civilisation dans la répression nécessaire des pulsions (Malaise dans la civilisation) et le meurtre du père qui transforme la prohibition de force en loi (Totem et tabou)) et la phénoménologie sont des façons différentes de conjurer l'optimisme nietzschéen du surhomme, celui qui serait le maître et créateur de ses interprétations, par exemple en réduisant l'"homme" à l'esclave (Gehlen), en faisant appel aux structures profondes et intemporelles de la psyché (Freud) ou en montrant à quel point notre représentation du monde (et nous-mêmes) sommes vulnérables (la phénoménologie, cf l'article de Dastur). Les rapports entre Gehlen, Plessner, Scheler (ce qui s'est appelé l'"anthropologie philosophique") et la phénoménologie sont bien connus et étudiés en Allemagne (Scheler était proche de Husserl, et on peut aussi lire Gehlen comme une grande entreprise anti-heideggérienne de resubstantialisation de l'ontologie, avec une prise en considération du corps, très loin de la structure anthropologique désubjectivée du Dasein). Ce qui les intéresse désormais (et c'est anti-Heidegger, mais pas anti-phénoménologie du tout), c'est comment l'homme acquiert son corps (par l'action, répond Gehlen: j'agis, je me vois agir; je prononce un mot, et je l'entends aussitôt, et je peux le moduler, c'est une boucle de rétroaction, qui me fait émerger comme modificateur possible d'objets perçus aussitôt créés) (et on distingue le corps physique, Körper, du corps-vécu, Leib). De façon assez parlante, ce qui manque à ce courant, c'est une phénoménologie de l'amour et de l'expérience sexuelle. C'est venu très tard (Scruton, Marion sur l'érotisme, des trucs d'horizons très différents et rien qui approche une synthèse cohérente sur le sujet). What is it like to be a bat c'est déjà de la phénoménologie Peut-être plus ton genre de phénoménologie d'ailleurs! Il faudrait que je relise Mortal Questions pour vérifier si par le caractère subjectif de l'expérience, Nagel entend qu'elle est vécue d'un certain point de vue, depuis un certain corps, ou s'il fait appel à certaines caractéristiques de l'expérience (comme un certain type de vision, un certain type de perception, et, à un autre niveau, une certaine manière de processer les sense-data selon tel ou tel modèle e.g. le predictive coding pour le cerveau humain). Ah merci ça m'intéresse beaucoup, je vais lire ça demain! Là par contre il faut vraiment que je dorme. Je ne veux pas que mes neurorécepteurs commencent à perdre leur sensibilité à la norépinephrine et la sérotonine.
-

Présidentielles 2022
Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société
Zemmour qui explique avec a straight face à un intervieweur aux yeux bleus flamboyants qu'il n'accueillera pas une femme afghane parce qu'il n'est pas le père Noël de l'humanité après avoir passé une heure à parler sur bfm de son enfance et de la manière dont il a organisé l'anni de ses 50 ans en faisant risette aux journalistes, ça me scie. La manière obscène dont des sujets profondément graves sont abordés entre deux blagues à la télé, que ce soit les indécences de Zemmour ou des covidistes, c'est peut-être moi qui regardais jamais la télé, mais c'est nouveau pour moi. -

Présidentielles 2022
Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société
C’est vraiment un débat politique de haute volée: pour ou contre la bidoche -

Kœnig : Un libéral dans la course présidentielle (sisi)
Vilfredo a répondu à un sujet de F. mas dans Politique, droit et questions de société
Je me demande si l’appeal du RU n’est pas dans son côté futuriste plutôt qu’économique, genre on crée un nouveau mode de vie post-industriel. Un peu comme l’écologie en fait. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Dalrymple dans The Epoch Times Boom https://m.theepochtimes.com/a-mob-pulls-down-a-statue-and-a-jury-threatens-the-law_4197558.html?slsuccess=1 (lecture gratuite si on donne son mail; le reste de l’article est juste parfait) -
.
-
Je viens de me réveiller j’ai cru que ce topic avec un titre si mimi qu’on dirait un livre de Max et Lili allait parler de la vie de @Drake. En fait non mais du coup il va falloir que je fasse un effort supplémentaire pour me lever dans un monde où il y a des meufs prêtes à se vider une poubelle dans le vagin pour avoir un gosse avec quelqu’un et expliquer que le vrai problème la dedans c’est que ça pique.
-

Pécresse, candidate LR
Vilfredo a répondu à un sujet de Sekonda dans Politique, droit et questions de société
Ton cœur est trop blessé, et la cour et la ville Ne t’offrent rien qu’objets à t’échauffer la bile -
Me revoilà. J'ai mis du temps parce que l'article était long, mais ça valait largement le coup. Je m'attendais à un article technique et un peu rasoir, et j'ai fini par y passer mon après-midi avec bonheur. Je suis désolé si ma réponse est longue aussi, mais comme mes tentatives de concision antérieures ont entraîné un déficit en clarté explicative, j'ai préféré m'assurer que j'étais clair. L'article est passionnant, merci. Si je comprends bien, la perception n'est attentive qu'à la marge d'erreur entre la prédiction de ce qui va être perçu par le cerveau et la perception actuelle de la chose, d'où un affinement continû de la perception, une arms race de conjectures et de réfutations (Popper) ou une tension vers l'homéostasie (Damasio) (le "nirvana" de Mumford cité dans ton article). J'adore ce terme de "surprise" pour désigner la marge d'erreur, et on voit bien la connexion avec les analyses du processus d'apprentissage. On quitte le schéma dualiste simpliste de la correspondance entre mes états mentaux (subjectifs) et les états de choses (objectifs). Mais il y a une autre solution "économique" pour la perception qui va dans le sens contraire de cet affinement de la prédiction, et qui est qu'on imagine le maximum compatible avec la survie. La faculté de l'imagination joue le rôle de délestage par rapport à la sur-sollicitation des stimuli du monde extérieur, si on veut (et j'aime le terme de surprise parce que certains phénoménologues allemands parlent justement du monde comme un "champ de surprises" pour un animal aussi pauvre d'instincts qui permettraient de les canaliser tel que l'homme). J'ai déjà dû citer un passage de Par-delà bien et mal qui me laisse sans voix et qui est le §192 et pour répondre à JRR, c'est là que je vois les commencements de la phénoménologie dans Nietzsche, et plus précisément les bases d'une théorie de l'expérience du monde sans sujet. Mais c'est assez large, et on peut aussi y voir les bases de la psychanalyse (et on ne s'en est pas privé). Toutefois, mon assimilation de Nietzsche à la phénoménologie n'a rien du tout d'original, j'ai seulement lu les cours de Heidegger sur Nietzsche où il assimile la volonté de puissance, le devenir ininterrompu, à l'essence de l'étant. Pour en revenir aux questions de perception, même si je vois bien la parenté entre le predictive coding et certaines approches phénoménologiques qui se demandent comment, à partir de l'expérience du sujet, est constitué un modèle de l'objet (en gros comment on sort de soi), je crois seulement que la phénoménologie ferait intervenir beaucoup plus de motivations dans la constitution de l'objet que simplement le besoin évolutionnaire de précision, et même si le predictive coding a l'air de pouvoir rendre compte du dark side de la perception (delusion, schizophrénie etc) il me semble y arriver par un chemin très détourné. Un exemple de raison totalement extérieure à la machine bayésienne est: est-ce que ce modèle me plaît ou pas. L'imagination satisfait tous mes désirs (fantasmatiques) sur les objets, et il n'est pas dit que je sacrifie à la précision, même à mes risques et périls, la satisfaction esthétique de la contemplation d'un objet à moitié rêvé. Ce qui me plaît alors, ce n'est pas l'objet et ses caractéristiques, mais ma perception, mon activité de percevoir elle-même, que je trouve belle (en effet, elle est artistique puisqu'elle improvise librement sur le sense-datum; peut-être est-elle à la racine de la création artistique en général), et qui me lie à l'objet d'une façon paradoxale, puisqu'elle m'empêche aussi de le voir tel qu'il est; elle me donne même une forte motivation pour ignorer son apparence réelle, au lieu du modèle du predictive coding dans lequel, quand c'est mon comportement qui est en jeu, la prédiction détermine en partie la sensation ("Thinking of going to the next pattern in a sequence causes a cascading prediction of what you should experience next.") En d'autres termes, pour une certaine acception du "désir", je ne pense pas que l'objet désiré, ce vers quoi mon action tend, soit "perçu" comme a l'air de l'entendre l'article (p186). En gros dans ce modèle, il n'y a jamais vraiment de mismatch entre la perception et l'action, parce que les deux coévoluent de manière à ce que l'action corresponde toujours à la prédiction. C'est une façon de voir les choses: imaginez que vous voyez une femme de loin qui est belle parce que vous la voyez pas très bien, ou parce que vous venez de passer vite près d'elle en voiture et n'avez perçu que 10% de ses traits, et imaginé le reste. Soit on pense qu'en s'approchant, on garde en tête l'image fantasmée par rapport à laquelle la femme de près est décevante (et donc on aime la perception, pas l'objet), soit on pense qu'en s'approchant de la femme, on perçoit une femme-de-près alors qu'avant on voyait une femme-de-loin, et qu'on adapte ses standards en conséquence. C'est ce que Hume (désolé si la référence à Hume est un peu obsessionnelle chez moi) appelle le spectateur judicieux. Le spectateur judicieux est celui qui ajuste sa vue à son objet : contrairement au spectateur proustien qui s’approche des choses "belles et mystérieuses pour [se] rendre compte qu’elles sont sans mystère et sans beauté", le spectateur judicieux sait qu’il ne peut retirer le même plaisir de la contemplation d’un être particulièrement beau vu de loin et de près, et adapte en conséquence non seulement ses attentes, mais jusqu’à l’apparence de cet être, ou l’impression qu’il nous en donne, qui ne deviendra bientôt plus qu’une idée, en s’éloignant de nouveau dans le passé de sa mémoire. Je trouve la seconde idée "optimiste" très raisonnable, et bien justifiée dans l'article par le modèle économique de thermodynamique, selon lequel, en minimisant la marge d'erreur (maximisée par le spectateur proustien), on minimise aussi l'effort. Mais j'ai un peu de mal à réconcilier ça avec la tension vers une approximation précise de la réalité, ou alors il faut choisir entre la correspondance attentes/réalité "extérieure" et attentes/perceptions. Si les perceptions ne s'ajustent que marginalement à la réalité "extérieure" pour économiser de l'énergie, il va y avoir des problèmes darwiniens. Pour dire les choses clairement, j'ai du mal à voir comment ce modèle rend compte de l'apprentissage, de la douleur, de la frustration (si à chaque fois la perception est ajustée à l'attente, il n'y a jamais de déception des attentes: on porte des lunettes roses). Du reste, c'est le genre de problèmes que traite l'article (p191 sq: How can a neural imperative to minimize prediction error by enslaving perception, action, and attention accommodate the obvious fact that animals don’t simply seek a nice dark room and stay in it? Le problème c'est que je pense pas que le comportement "exploratoire" chez l'homme soit analogue au comportement exploratoire chez les animaux, enfin pas si on a une perspective phénoménologique sur l'expérience humaine du moins), notamment quand l'auteur aborde les (je ne sais pas ce que c'est en français) non-classical receptive field effects, où le signal d'erreur est d'autant plus fort que le stimulus est peu prédictible à partir des stimuli alentours (Rao et Sejnowski 2002 expliquent ça en disant que la réponse neurale est ici un signal d'erreur (négatif) et pas une représentation d'un quelconque contenu (positif), mais je me demande si c'est pas aussi comme ça que fonctionne la perception du danger). Bon c'est peut-être ma proclivité pour la psychanalyse qui me pousse à tout lire sous l'angle du désir, mais j'essaie de retourner un peu les choses en ajoutant, entre l'objet de la perception et l'activité de percevoir, le troisième élément du modèle qui me semble être la perception perçue, ou l'impossibilité de percevoir la perception comme on perçoit ce qu'on perçoit (l'oeil qui ne peut pas se voir comme tu dis). Il n'y a jamais de rapport simple, même sous la forme des boucles de rétroaction du predictive coding, qui montent soit vers l'homéostasie, soit descendent dans le dark side de la delusion, entre l'objet perçu et le "spectateur", dans cette optique (c'est le cas de le dire). Dans ma tête et dans la première perspective, un peu pessimiste, mon lien le plus fort avec l'objet est un obstacle entre lui et moi, et c'est en me heurtant, non pas à l'objet, mais à l'obstacle que j'ai moi-même créé en désirant assimiler l'objet, que je suis confronté au réel. Peut-être que je pense ici à "l'obstacle" comme à quelque chose de l'ordre de ce que Winnicott appelle l'objet transitionnel, ce tampon entre le sujet et la réalité qui joue un rôle si important dans le développement de la psychologie infantile, et qui est aussi un lien fantasmé entre l'enfant et la mère. C'est un peu différent de quelque chose comme la réalité sociale (dans les deux cas cependant un tampon entre le sujet et la nature, en fait une interprétation). Hume a une expression magnifique pour désigner cet espèce de comportement self-delusional: il parle de castle-building (“Plagiaries are delighted with praises, which they are conscious they do not deserve; but this is a kind of castle-building, where the imagination amuses itself with its own fictions, and strives to render them firm and stable by a sympathy with the sentiments of others.” Voilà un bon exemple de réalité sociale, càd une réalité à laquelle seule l'intersubjectivité, et non les motivations internes au sujet, donne une consistance. Mais une consistance qui résiste à la volonté du sujet existe bien dans les deux cas. Ce n'est pas juste du solipsisme et du rêve baroque. Bien sûr, on pourrait m'objecter que c'est une définition très libérale de la réalité, comme tout ce qui résiste à la volonté consciente, tout ce qui en fait connaît la négation; Freud écrit fameusement que l'inconscient ne connaît pas la négation, qu'il n'y a jamais de négation dans un rêve, parce que dès que tu penses: ~X, X apparaît dans le rêve aussi sûrement que si tu pensais à X.) Dans cet état parfaitement névrotique et narcissique où on aime sa propre créature, toute tension vers l'approximation d'une perception plus raccord avec les attentes est annihilée. L'esprit a déjà atteint le "nirvana" dont parle Mumford (cité dans l'article, p192). Il y a là sans doute une parenté entre le comportement sexuel et le comportement social en général, si par là on entend que l'homme façonne une réalité qui sied à sa perception plutôt que de faire l'effort d'adapter la perception à une réalité soi-disant "extérieure" et qui lui serait donnée immédiatement. Il y a un passage qui dit ça très bien dans ton article: "Using a variety of tricks, tools, notations, practices, and media, we structure our physical and social worlds so as to make them friendlier for brains like ours." (p195) (c'est très gehlenien comme truc) Ça me paraît valider l'approche "externaliste" qui consiste à analyser l'esprit avec les concepts du monde "extérieur" (conçu comme sa manifestation), mais j'ai quand même un peu de mal à penser que c'est aussi facile que ça de rendre l'environnement familier. J'ai l'impression que ça repose quand même sur le présupposé "objectif" que le monde est familiarisable, qu'il est propice à l'existence humaine. Pas forcément: mon existence n'est pas nécessaire, l'erreur pourrait être une condition de la vie etc. Je tiens à préciser que ce que j'écris là n'est pas supposé être une critique de l'article, puisque l'article explique précisément que le dark side du predictive coding c'est le biais de confirmation et la path dependence dans l'auto-satisfaction des attentes (delusion, schizophrénie etc). J'essaie juste de make phenomenological sense de certains trucs et parfois d'indiquer en quoi les approches me paraissent diverger, mais comme je le pensais en lisant Damasio, elles ne divergent pas tant que ça du tout. Il y a dans l'article sur le predictive coding des choses vraiment passionnantes sur le binocular rivalry et les perceptions multistables. Ça me fait penser à des points de théorie de l'identité personnelle sur la relation entre division du sujet et perception (et j'ai toujours pensé que l'unité du sujet était une mesure complexe de la santé mentale), et des problèmes de perception "grammaticaux" comme l'inquiétante étrangeté, mais peut-être on pourrait en parler ailleurs, si d'ailleurs ça t'intéresse at all, (à cause du titre je me suis senti concerné quand je suis tombé sur ce livre à la bibli donc je me suis assis entre les rayons et je l'ai lu d'une traite, c'est un excellent bouquin) j'ai déjà l'impression que les points de convergence entre phéno et neurobio sont assez tordus comme ça. J'en reviens donc aux questions de perception pour le moment. Une question qui me taraude est la formulation dans le langage naturel des processus de perception, quand par exemple les auteurs écrivent: "To suppress those prediction errors, the system needs to find another hypothesis." Je sais que c'est une vraie remarque de philosophe, mais ça me pose un problème que des processus subconscients (et la même question se poserait pour les systèmes de relation inconscients) soient exprimées comme les states and doings d'un agent conscient (the system needs etc)! Je sais bien que c'est une facilité du langage, et Dawkins s'en explique aussi dans The Selfish Gene sur cette anthropomorphisation (et, pour ce qui nous intéresse, cette intentionnalisation ou cette conscientisation (i.e. le fait d'attribuer une intention ou une conscience)), mais c'est un fait frappant en soi sur notre psychologie, sur notre expérience du monde, sur notre langage même, que nous ayons besoin d'avoir recours à ces raccourcis, qui sont très probablement impossibles à éliminer totalement du langage, comme on a besoin de métaphores, de figures of speech. C'est si profondément ancré que Feynman écrit dans The Character of Physical Law que ça aide pour les calculs de s'imaginer que le rayon de lumière choisit littéralement le chemin le plus court entre deux points. C'est une sorte d'intuition première qui permet un peu de bootstrapping dans les calculs. Rien de surprenant dans ce mismatch pour un lecteur de Wittgenstein, qui y verrait simplement un signe de plus de l'inadéquation entre un schéma scientifique causal appliqué à un phénomène, l'esprit, qui ne procède pas comme ça (il distingue les raisons et les causes; les raisons sont comme le motif, et en donnant le motif, nous ne donnons pas la cause, mais une sorte d'interprétation de notre comportement, qui lui donne une signification, càd une publicité (pas de langage privé, tout ça; mais Wittgenstein n'est pas behavioriste pour autant)). Vous connaissez la Grammaire philosophique de Wittgenstein? L'idée de la "grammaire" n'a rien à voir ici avec ce qu'on entend communément par ce terme: la grammaire d'un concept est une sorte de règle pour faire de la philosophie correctement, et qui consiste à associer à la catégorie de concepts à laquelle le terme appartient. Or, parfois, la langue naturelle nous trompe sur la grammaire réelle de l'expression qu'on emploie, comme quand justement on dit "the system needs" ou "untel a des pensées" (pour prendre un exemple de W), car une pensée n'est pas une chose que l'on peut avoir, mais un attribut de quelqu'un. Ça va assez loin parce que ça motive la critique wittgensteinienne de Freud: il reproche à Freud de ne pas voir les rêves, par exemple, comme des phénomènes esthétiques, qui demandent donc une approche herméneutique similaire à celle qu'on a pour les oeuvres d'art, et pas de réductionnisme (en gros l'explication doit donner les raisons, validées en tant que telles par l'assentiment du rêveur, et non les causes; je ne sais pas si la psychanalyse soignerait grand monde à ce régime mais enfin). D'où deux renversements: les explications psychologiques ne sont pas causales, elles sont téléologiques (elles projettent une intention, et une intention a toujours un but, elle ordonne le réel en conformité à elle-même), et les concepts de la psychologie ne sont pas des entités "internes" et privées, mais le monde extérieur et les notions du quotidien, auxquelles même la psychologie scientifique revient ("the system needs"), et qui peut inclure des choses comme la background knowledge de Searle ou même la notion générale de rationalité, qui fournissent une sorte de cadre herméneutique pour l'interprétation. J'y ai fait allusion plus haut mais une excellente application de l'approche grammaticale à la philo de la perception c'est l'uncaniness. Superficiellement, la perception d'un objet uncanny ressemble à une perception multistable, sauf qu'elle est indissociable d'une certaine réponse émotionnelle. Elle est exemplifiée par la perception d'objets qui ne sont pas vagues (du type de ce dont parle Williamson ou le paradoxe sorite: pas ça) mais qui ne se laissent pas classer par un concept, comme des robots qui ont l'air humain, ou une main apparemment humaine en fait en latex. Le problème que rencontre l'appareil perceptuel est d'un ordre grammatical (comment je classe ce truc?) et pas de l'ordre d'une correction (ceci est un tronc d'arbre; ah non c'est un crocodile). Ici on peut imaginer que le cerveau poppérien fait des conjectures et des réfutations comme un malade sans arriver à cerner ce qui se présente, mais sans non plus produire de concept à l'arrivée (c'est pas le jugement réfléchissant; mais de fait il y a un petit air de famille entre cette expérience et l'expérience du beau). Je passe à la suite de tes remarques. Oh je voulais surtout souligner la tension entre phénoménologie et psychanalyse sur la question de l'accès privilégié aux états mentaux. Sinon oui ça se recoupe pas mal. Je dois avouer que j'ai du mal à envelopper ma tête autour de ce concept, parce qu'une caractéristique centrale de l'analyse phénoménologique de la perception est qu'elle est consciente (je perçois des significations). Je vois bien ce que ça peut vouloir dire (la vision aveugle par exemple?) mais répondre au fait que je ne peux pas voir mon inscription dans le monde en disant que je peux la voir sans en être conscient c'est un peu renommer le problème. Comme j'essayais de répondre à "pourquoi ne peut-on pas voir son inscription dans le monde", je répondais en employant "voir" dans ce sens phénoménologique de "ce que ça fait de voir" (et pas dans celui d'un processus purement physique de vision dans lequel la conscience est dispensable). Oui ça rappelle un peu l'idéalisme de manière générale, sauf que dans Schopenhauer, voir la volonté à l'oeuvre dans la réalité suppose une sorte d'intuition accessible seulement à une élite (les artistes) alors que la phénoménologie place le pouvoir créatif de la perception au coeur de l'expérience commune, et même comme condition du rapport interpersonnel. Donc ne serait-ce que sur la théorie esthétique, il y a une divergence majeure.
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
On dirait du Nabe. C’est dégoûtant -
Tiens j’ai lu dans Première que Del Toro sortait un film noir. Je vais faire un saut dans une vidéothèque et m’acheter tous ses films me faire un petit binge. J’avais rate Crimson Peak et La Forme de l’eau mais j’ai pas non plus vu ses premiers (L’échine du diable) ni Hellboy 2 eg
-

Le fil des séries (dont beaucoup trop se bousémotivent)
Vilfredo a répondu à un sujet de Brock dans Sports et loisirs
Dieu me préserve de twitter même maintenant mais oui -

Le fil des séries (dont beaucoup trop se bousémotivent)
Vilfredo a répondu à un sujet de Brock dans Sports et loisirs
Je devrais imiter ta concision: Young Royals: comme Elite, mais cute. -
Ce qui est drôle, c'est que les gens s'imaginent sérieusement qu'il y a des nanas qui se baladent dans la rue avec un air songeur, leur ventre criant famine, en se demandant par un matin d'hiver qui au monde va bien pouvoir faire un peu de matérialisme historique pour le déjeuner.
-

Présidentielles 2022
Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société
Hein Si -

Éric Zemmour, chroniqueur puis politicien
Vilfredo a répondu à un sujet de L'affreux dans Politique, droit et questions de société
Pas mal. On se croirait un peu au 18ème (“ça c’est envoyé,Monsieur le marquis de Zemours!”) mais c’est pas mal -
Visiblement la vulgarité du meme de Macron se répand plus vite que le virus.
-
Elle est inoubliable dans Bad Lieutenant. Les scènes de shot sont vraiment insoutenables. Mais je ne connais pas les détails des coulisses, je sais juste que Zoe Lund devait être très jeune...?
-
Le rape and revenge avec une nonne? (Un peu l'inverse de Bad Lieutenant) Non! Ni n'ai-je vu Driller Killer, son film d'horreur où il tue des gens avec une perceuse! Parfois je me dis qu'il a fait les films que Scorsese n'a pas réussi à faire. Et c'est surtout dans ses derniers que j'ai pas vu grand chose. Et toi t'as aimé?
-
Meilleur rôle de Walken Il faut voir China Girl qui est trop bien, Bad Lieutenant, The Funeral (re-Walken) et Go Go Tales qui est un drôle de petit film quasiment en temps reel dans une boîte de nuit tenue par Willem Dafoe au bord de la faillite
-
Non, j'ai vu The Canyons (celui d'encore avant je crois) parce que mon avatar y a participé. C'était pas bien par contre. Ah merci de corriger, je suis nul pour me souvenir des histoires. Pas vu, je vais regarder si j'en ai l'occasion (comme il y a Nicolas Cage c'était pas prévu on va dire). Je l'ai revu récemment (Ferrara) et je me disais que je verrais bien tous les films de lui que je n'ai pas encore vus (en fait il y en a pas mal).
-
Quand on a vu The Social Network, on sait que les hauts QI ont du mal à dater
-
C'est pas mal The Card Counter, le dernier Schrader. C'est un petit film. Il y a souvent ces cadrages que je ne saurais pas nommer mais où les objets dépassent les bords du cadre, qui donnent un sentiment d'immersion accru. Oscar Isaac est tellement brillant, beau et classe que je pourrais le regarder enfiler des perles pendant deux heures. C'est un film un peu d'une autre époque, le genre de road movie un peu chrétien qu'on faisait dans les 70s, et le minimalisme y contribue beaucoup: une dizaine d'acteurs, peu de décors à part des casinos magifiques et ce parc enguirlandé qui ressemble lui aussi à un casino ou un terrain de flipper, pas beaucoup d'action en général d'ailleurs. Pour l'histoire c'est encore un truc de rédemption, qui ressemble beaucoup à Bad Lieutenant, en moins bien: on retrouve dans les deux films des personnages perdus dans l'ordre de la concupiscence, qui évitent la rédemption en s'abandonnant au hasard (les paris sportifs pour Harvey Keitel dans le film de Ferrara, le poker et le blackjack pour Oscar Isaac ici) avant de régler finalement leurs comptes avec Dieu. C'est un peu moins démonstratif dans Schrader (faire plus démonstratif que l'apparition du Christ dans Ferrara c'est pas gagné en même temps), mais la structure de la narration est à peu près identique, à ceci près que dans The Card Counter, je me suis laissé avoir aussi et jusqu'à la fin j'ai cru que le final serait autour du poker, alors que le vrai sujet est ailleurs. Donc la fin du film est très bien. J'aime beaucoup le fait que la séance de torture qui clôt le film soit hors-champ, avec des notes stridentes et répétées qui rythment le travelling arrière lent en anxiogène de la caméra: ça me rappelle le travelling mythique de Frenzy quand le tueur étrangle avec sa cravate la conseillère matrimoniale et que la caméra descend les escaliers (jamais compris comment Hitchcock avait fait ça presque dix ans avant la steadycam) et que les cris de la victime se dissolvent progressivement dans le bruit de la rue. L'autre jour sur Netflix j'ai aussi cliqué sur Boy Erased (Joel Edgerton, avec Russell Crowe (génial) et Nicole Kidman (excellente aussi)), le film sur les thérapies de conversion, en me disant que j'aller regarder vingt minutes pour voir de quoi ça avait l'air. En fait j'ai tout regardé. La fin gâche le film parce que c'est téléphoné mais le reste est plutôt pas mal, plus subtil que ce à quoi je m'attendais. Ça ne rentre pas dans la divinisation du gay angel, le petit être fragile et sans désir qu'il faut protéger du monde, l'idée même de la vertu pour Hollywood aujourd'hui. Enfin, un classique: j'avais jamais vu Hannah and Her Sisters de Woody Allen, qui m'a fait rire aux larmes.