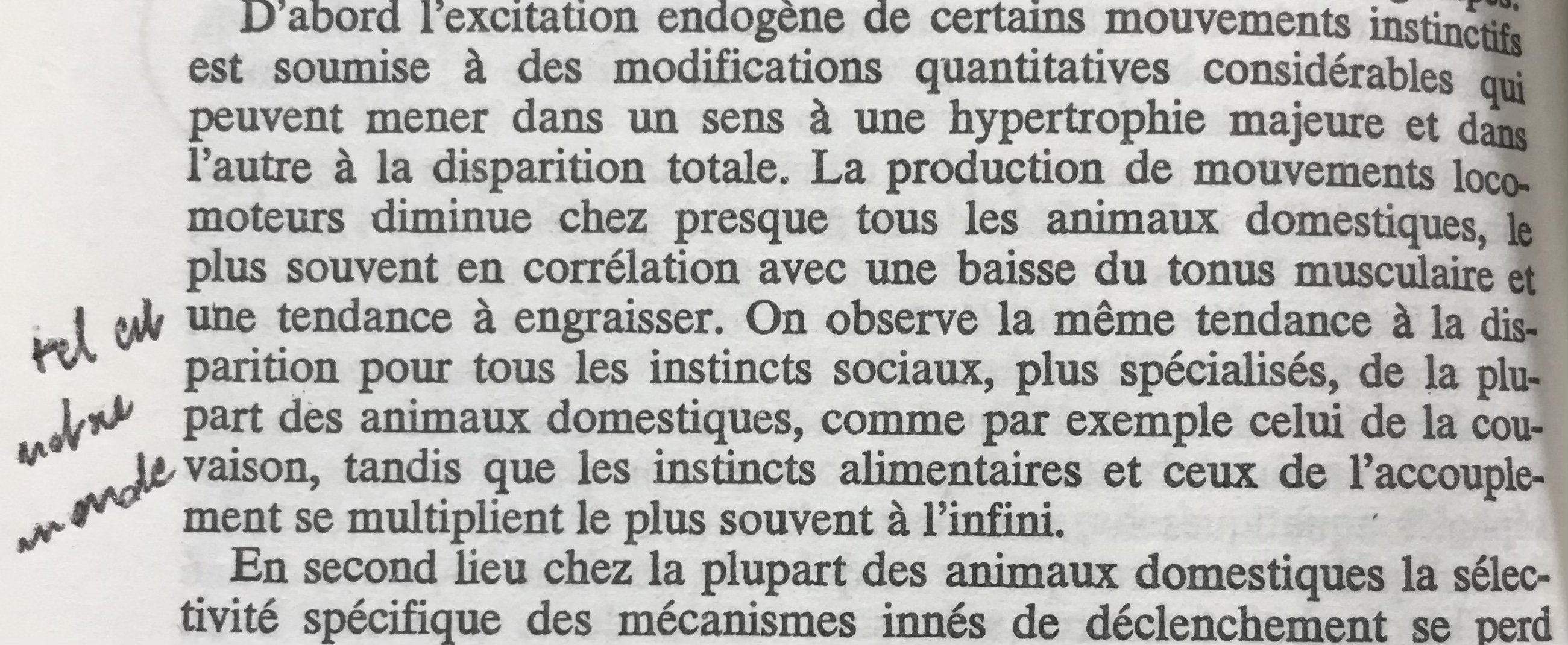-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
Aujourd'hui je suis passé dans une petite librairie du quartier de la République. Je me suis acheté La Possibilité d'une île, alors que je suis en train de lire En route de Huysmans (très bien mais j'ai quand même l'impression que l'oeuvre de Huysmans c'est all the way down après A rebours et qu'il répète le même genre de narration), comme préparation à Anéantir. Je suis rentré en commençant à le lire même en marchant et je n'ai décroché que pour le dîner, comme scotché. Je devrais de façon générale me dégager une ou deux heures par jour au moins pour lire un roman même quand je suis occupé (genre: pas comme en ce moment). Récemment, entre autres, j'ai aussi lu The Sickness unto Death de Kierkegaard. C'était sublime. Enfin, ce soir, je regarde The Pervert's Guide to Cinema de Zizek. La conclusion que j'en tire est qu'il est vraiment temps que mon directeur de mémoire me réponde.
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Si ils s’en expliquent dès la promotion de Please par exemple dans cette interview absolument fabuleuse Chris Lowe etait vraiment such an absolute babe -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Non, pass déjà que je comprends pas très bien d’où vient leur nom à eux (à part comme moquerie des autres Boys comme les Beach Boys). Et je pense aux lecteurs du forum qui se demanderont who the fuck are the Veal Shop Boys comme moi pendant des années avec Abu Ajar -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Hier dîner avec un de mes meilleurs amis dans un restaurant basque du quartier latin. Je demande de l’axoa de veau en prononçant le x “ks” et la serveuse me corrige; ça se prononce “ch”. Alors je commande de l’achoa de veau mais je lui fais remarquer que j’ai un peu l’impression de demander l’extermination des veaux d’Europe. Ça ne l’a pas fait beaucoup rire (mon ami beaucoup plus), mais elle a tendu le bâton pour se faire battre parce que, comme de coutume, elle est venue me demander un peu plus tard si ca “se passait bien” avec l’axoa… Nempeche j’y retournerai c’est bien comme endroit -

Kœnig : Un libéral dans la course présidentielle (sisi)
Vilfredo a répondu à un sujet de F. mas dans Politique, droit et questions de société
oui mais de l’autre côté il y a une volonté bizarre de trouver un mot comme si les mots avaient des pouvoirs magiques et une fois qu’on aura joué au naming game on se sentira mieux -

Kœnig : Un libéral dans la course présidentielle (sisi)
Vilfredo a répondu à un sujet de F. mas dans Politique, droit et questions de société
C’est marrant comment à chaque fois qu’on discute d’idées on finit par se battre sur les mots ou est mon Larousse -

Kœnig : Un libéral dans la course présidentielle (sisi)
Vilfredo a répondu à un sujet de F. mas dans Politique, droit et questions de société
C’est une erreur de mettre le totalitarisme sur le même plan que ce qui se passe. On n’a pas exproprié les koulaks pour leur bien -
Vite avant que Dardanus vienne râler: c’est une référence à un livre de Peyrefitte https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Quand_la_Chine_s'éveillera…_le_monde_tremblera
-
Les vieux se disent que c’est pas à eux de lever le petit doigt ils ont assez donné que fait la jeunesse la jeunesse n’a aucune culture politique du coup les décisions de l’état sont vécues comme une fatalité (oui je crois que c’est plutôt comme ça que ça se traduit en général l’apolitisme: ça ne fournit pas une motivation suffisante contre la pression sociale) et chaque génération se renvoie la balle (“we didn’t start the fire!” Vs “Les jeunes d’aujourd’hui…”) classique no u
-
C’est un peu comme si vous pensiez que tout ce qui est individuel c’est bien et tout ce qui est communautaire c’est mal. Ça ne va peut-être pas vous plaire mais une manifestation même contre le pass sanitaire c’est une communauté. Un groupe fb, non. On peut avoir un pouvoir très néfaste en empêchant toute communauté de se former, en montant les gens les uns contre les autres… l’état fait ça depuis deux ans, et ses thuriféraires aussi. Mais si l’interdiction des manifs, des regroupements de jeunes (l’activité politique vient rarement des seniors) et jusqu’à celle des meetings ne sert pas la dissolution de toute communauté possible (avec derrière l’argument qu’on est seuls face à la mort et que c’est d’abord ça qu’il faut prendre en compte), je ne sais pas à quoi elle sert.
-
La misanthropie est une forme de haine. Haïr un objet et vouloir laisser cet objet tranquille, good luck with that. D’ailleurs dans Molière il dit qu’il veut laisser les gens tranquilles m’enfin en fait il fait chier tout le monde. C’est très facile de renverser la charge de qui embête qui. Le misanthrope maintient pour les hommes des standards inhumains, et comme les hommes ne satisfont pas sa très haute idée de l’humanité, son altesse nous fait tout un discours sur se retirer dans sa tour d’ivoire. Mais c’est le pire intrus qui dit “oh moi je ne veux pas qu’on prête attention à moi je vais me mettre dans un coin c’est pas grave si je crève”. Quand on est indifférent aux hommes, détaché, on leur fout la paix. Quand on les hait, on poursuit leurs défauts, leurs failles et leurs travers de sa hargne déguisée en vertu (Je hais tous les hommes… les uns pour être méchants et malfaisants / et les autres pour être aux méchants complaisants/ et n’avoir pas pour eux la haine vigoureuse/ que doit donner le vice aux âmes vertueuses”). On hait les hommes mais on s’aime bien soi quand même. Ça pour s’aimer très fort les misanthropes savent faire. Alceste, Céline, Luchini: tous des énormes Narcisse.
-
Bah non justement ils fuient toute communauté ils vont s’enfermer chez eux. Une communauté c’est pas juste l’avis des gens abstraitement ce sont des gens concrets
-
J’ai vraiment un rapport ambivalent à la misanthropie. Ça peut me prendre dans un emportement comme la colère et parfois j’ai ce délire Fight Club/Glamorama dans un bus ou un avion d’imaginer ou de souhaiter un accident mais je me méprise d’être comme ça. Le vrai misanthrope dans cette crise c’est surtout celui qui peste quand il voit des (jeunes) gens s’amuser dans les bars, peste contre le plaisir et rappelle qu’on va tous mourir, et qu’il faut s’y préparer chaque jour en ne touchant plus personne (ça me rappelle la réplique de la mauvaise reine dans Le Roi se meurt; quand l’autre reine dit du roi mourant: “c’est terrible, il n’est pas préparé!” Elle répond: “il aurait du s’y préparer depuis le début. Cinq minutes chaque jour. Ce n’est pas grand chose cinq minutes. Puis dix minutes un quart d’heure etc. C’est ainsi que l’on s’entraîne.” Je cite de mémoire.) Je méprise la misanthropie chez moi et je déteste la voir chez les autres parce que j’ai l’impression qu’elle dérive de cette réponse primaire, une sorte de cheap nihilisme face aux problèmes dans la vie. Qui empêche le contact entre les êtres travaille à l’apocalypse.
-

Présidentielles 2022
Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société
S’il est mignon et qu’il descend les poubelles -

Éric Zemmour, chroniqueur puis politicien
Vilfredo a répondu à un sujet de L'affreux dans Politique, droit et questions de société
Oui je ne tenais pas à contredire quelqu'un en particulier sur le forum, mais écrire me permet de mettre les choses au clair dans mes idées, et ensuite le forum se charge de les processer et de me renvoyer ce qu'elles ont de vrai et de faux, et chacun fait un peu ça. J'aime bien cette dynamique. Bon mes dix derniers posts étaient sur Zemmour je vais arrêter de m'y intéresser maintenant. -

Mélenchon, le Tout Petit Père des Peuples
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Politique, droit et questions de société
Les dix premières minutes suffisent. Tous les dégâts de l'humanisme et du socialisme concentrés en un discours. Et puis il n'y a pas que lui qui parle, on est à l'Assemblée, la ministre répond après. Evidemment elle lui parle du Venezuela, c'était facile, mais globalement sa réponse est assez nulle (très macronienne: réglementer les prix empêche l'activité économique, mais on peut quand même les réguler parfois). -

Mélenchon, le Tout Petit Père des Peuples
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Politique, droit et questions de société
Grand délire. C'est marrant que comme précédent illustre de blocage des prix, il se réfère au blocage des prix des masques et gel de Macron en 2020. C'est vrai que ça avait très bien marché. Et ensuite il dit : "évidemment on bloquerait les prix jusqu'à ce qu'on pense que c'est plus nécessaire" Tous ceux qui avaient l'intention même fugace de voter Mélenchon doivent regarder ce truc. C'est hallucinant. -

Éric Zemmour, chroniqueur puis politicien
Vilfredo a répondu à un sujet de L'affreux dans Politique, droit et questions de société
Aucun. Mais Zemmour encore moins que tout le monde. Même Mélenchon ne ramène pas tout à sa marotte (les inégalités sociales). Il peut faire un discours pour le blocage des prix, aussi lunaire que ça puisse paraître, mais il ne va pas aller t'expliquer que les agressions d'élus, c'est la faute à <son facteur omni-explicatif>. Zemmour, il a ça: l'explication one size fits all. Hier soir, il a réussi à faire un lien pour le moins acrobatique entre les agressions d'élus et l'ensauvagement de la société par l'immigration. Les bras t'en tombent. Et quand on lui dit écoutez c'est quand même pas pareil, il répond que c'est évident, et sans doute qu'il cite Péguy ("vous ne voyez pas ce que vous voyez"). Au bout d'un moment si tes seuls arguments c'est "c'est évident, je le vois", je ne peux pas ne pas prendre un air "un peu dédaigneux qu’on a devant un malade — eût-il été jusque là un homme remarquable et votre ami — mais qui n’est plus rien de tout cela car, frappé de folie furieuse, il vous parle d’un être céleste qui lui est apparu et continue à le voir à l’endroit où vous, homme sain, vous n’apercevez qu’un édredon." -

Éric Zemmour, chroniqueur puis politicien
Vilfredo a répondu à un sujet de L'affreux dans Politique, droit et questions de société
D'ailleurs vous dites vous-mêmes qu'il a l'air sincère parce qu'il change jamais d'avis. Donc pick one. Soit il est sincère et il change jamais d'avis, mais alors ne dites pas qu'il est ouvert au débat. Soit il est ouvert au débat, et il faut revoir vos critères de sincérité. Je l'ai déjà écrit mais cette fascination pour les Nostradamus qui ont tout prévu depuis 50 ans ne me touche absolument pas, mais je vois bien à quel point ça impressionne les Français. Ce n'est même plus l'homme providentiel qu'on attend, c'est le prophète. -

Éric Zemmour, chroniqueur puis politicien
Vilfredo a répondu à un sujet de L'affreux dans Politique, droit et questions de société
Ce ne sont pas des débats pour moi. On envoie des boulets sur Zemmour (j'ai encore en tête l'échange avec Caron chez Hanouna), Zemmour renvoie les boulets, personne n'échange d'idées avec personne. Il ne peut pas y avoir de débat. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui te parle de psychologie des peuples? Et quand tu lui donnes des statistiques (des "chiffres" comme il dit) il te dit: allez dans la rue. A cette étape généralement les journalistes se disent bon on va lui demander comment il va mettre en place son programme en pratique, et quand on émet des doutes sur l'application, il dit: avec moi, ça marchera. Quand on lui demande si c'est légitime, il dit: on fait ça depuis 1000 ans. Le débat suppose un objet constitué, une intersubjectivité comme qui dirait. Avec Zemmour non, il n'y a rien de tel. C'est un mélange de sentiments (cette histoire romancée de la France), d'arguments d'autorité ("comme le disaient Aron, Talleyrand, De Gaulle, Constant, Rousseau, Voltaire, Camus, Innocent III et Madame de Lafayette...") et de pure idéologie ("vous avez tel argument, mais en fait cet argument montre que vous êtes un bourgeois éloigné de la réalité, donc vous avez tort"). -

Éric Zemmour, chroniqueur puis politicien
Vilfredo a répondu à un sujet de L'affreux dans Politique, droit et questions de société
Moui non moi ça me le rend pas sympathique. Il est sincère comme un fanatique est sincère. Ce n'est pas une opinion qu'il a comme ça quand il dit que les Maghrébins ont (tous) un inconscient collectif qui est de prendre leur revanche sur la France. Ce n'est pas susceptible de révision. Sur la forme il est hargneux et agressif (hier soir sur l'immigration: "le regroupement familial, c'est terminé; ramener sa copine du bled, c'est terminé!" Il aurait pu ajouter "les jeux vidéos et les sorties cinéma c'est terminé"). Renaud Camus est "sincère" aussi, et il pourrait m'être sympathique parce que, contrairement à Z, je trouve que c'est un bon écrivain, mais quand il parle de politique c'est un illuminé complet (sa transformation physique de gay moustachu chill en gourou gaulois barbu n'aide pas). Je préfère quelqu'un de normal avec qui on peut discuter. Et avec Zemmour on peut pas discuter. Et j'ai des papiers et je suis français de naissance; je n'imagine même pas à quel point on ne pourrait pas discuter si je ne l'étais pas. Zemmour ne m'adresserait pas d'arguments, il m'enverrait la police. Il ne peut pas y avoir de discussion entre deux individus si le sujet de la discussion c'est la violence qu'on va exercer sur un des participants. Regardez ce que vous pensez des agressions d'élus. Comme d'autres ici, je ne jette pas la pierre aux "agresseurs". Il ne peut pas y avoir de débat "démocratique" avec ce que ça suppose de distinguo entre l'homme et les idées et d'éthique de l'argumentation sur la politique de Zemmour ou le harcèlement sanitaire des citoyens français. Vous faites la part des choses entre le mec et les idées parce que c'est ce que nous vend la télé, qui en fait des tartines sur son enfance dans le 18ème et nous fait pleurer sur son père le bon Algérien assimilé qui apprenait Talleyrand par coeur sur son lit de mort et Naulleau, cette nouille sur le gâteau, qui vous jure qu'il est adorable personnellement. Moi, je ne fais aucune différence. Puisqu'on peut pas discuter, on va faire un duel. -
J'ai lu: voir les résultats du vaccin.
-

Pécresse, candidate LR
Vilfredo a répondu à un sujet de Sekonda dans Politique, droit et questions de société
Bouzou et ses amis Je ferais bien un montage avec Bouzou en Oui-oui (ils se ressemblent un peu) mais je ne veux pas que Bouzou me fasse un procès, il paraît qu'il est très susceptible -

Pécresse, candidate LR
Vilfredo a répondu à un sujet de Sekonda dans Politique, droit et questions de société
That's a no from me dawg La guillotine et la colonisation, c'est aussi l'héritage des Lumières (Bouzou protip: à condition d'être fortement régulées lol). Ben ça m'a pas donné envie de m'abonner pour tout lire. Les arguments de Pécresse sont au mieux débiles, mais le plus souvent seulement pur wishful thinking: il y a une littérature massive qui montre que la prohibition encourage le trafic de drogues, et qu'en pense Valérie Pécresse? Elle ne le "croit pas". Comment réconcilie-t-elle sa défense du modèle représentatif avec son programme de référendum? Eh bien elle pense que la démocratie représentative, c'est bien, mais qu'il faut faire des référendums, parce qu'il faut faire un référendum sur la sécurité et sur l'immigration, et pour faire ça, on a besoin de faire des référendums. Enfin, si vous vous demandez si elle respecte l'Etat de droit, la réponse est oui, c'est pour ça qu'elle veut le "compléter" pour qu'il soit encore plus beau qu'avant. Bouzou fait le clown libéral ("je vais vous choquer, je vais parler d'économie") et Pécresse fait déjà du Macron: on peut rigoler deux minutes avec les théories libérales, mais dans la vraie vie politique, on défend les référendums et la représentation, la liberté et l'interdiction, on protège les plus jeunes en les mettant en prison et on respecte l'Etat de droit en changeant les lois, si possible régulièrement. -

Kœnig : Un libéral dans la course présidentielle (sisi)
Vilfredo a répondu à un sujet de F. mas dans Politique, droit et questions de société
Il vaut mieux entendre Gauchet que d'être sourd. Ça me rappelle la blague juive de rabbi Altmann/du liborgien Vilfredo qui déprime quand il lit les journaux juifs/liborg parce que ça ne parle que des pogroms/du déclin du libéralisme, alors il regarde les journaux nazis/les media français et il apprend qu'en fait le judaïsme domine le monde/la France est libérale, et il se sent beaucoup mieux. Bref- 333 réponses
-
- 11
-

-