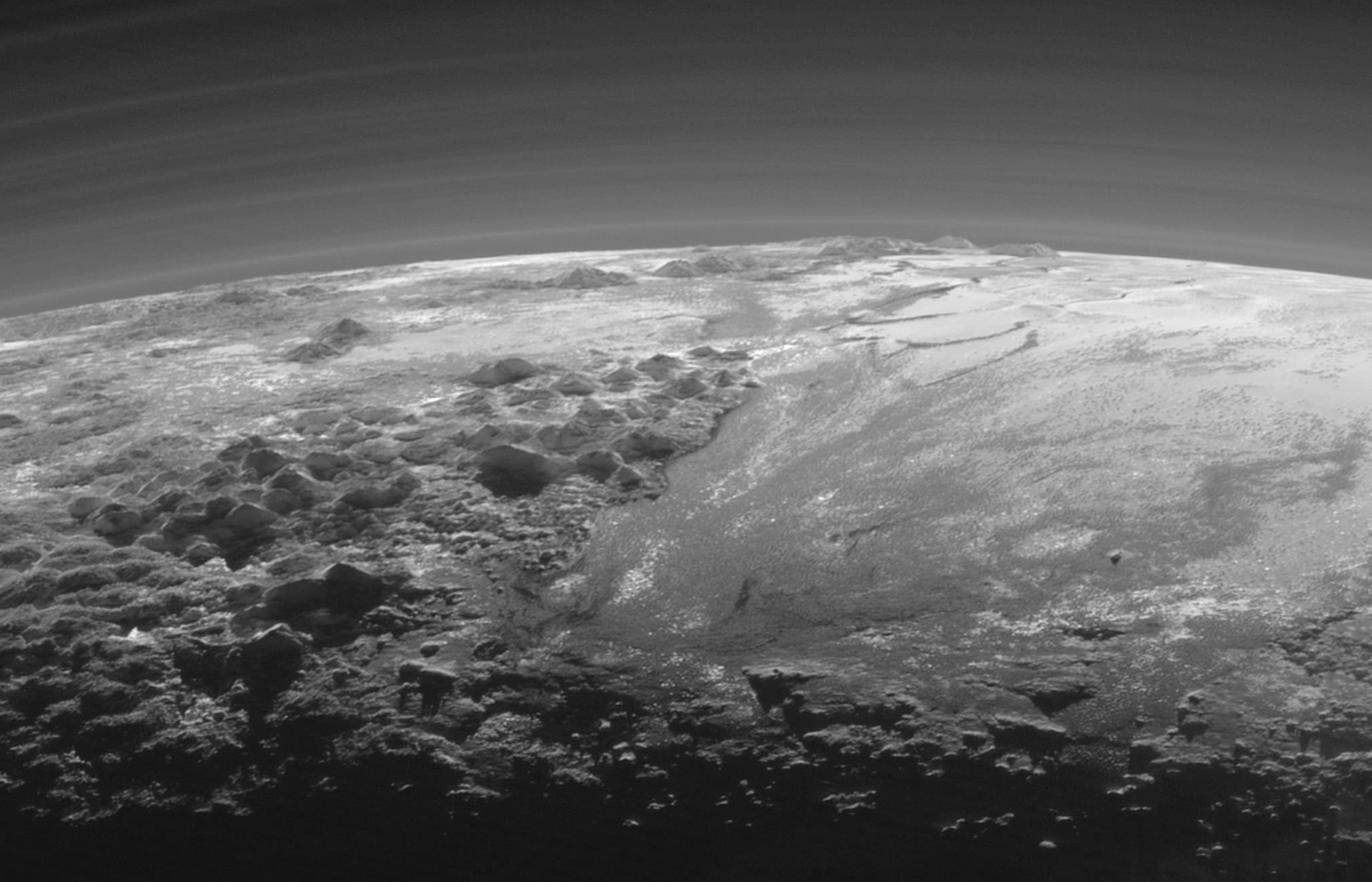-
Compteur de contenus
6 075 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
22
Tout ce qui a été posté par Anton_K
-
C'est peut-être un lapalissade mais pourquoi penses-tu que ce soit une mauvaise idée ?
-
Les tombes et les cimetières c'est trve.
-
je savais que t'étais qu'un poseur
-
C’est vrai, je schématise excessivement.
-
Il faudra voir si son background comprend de la délinquance ou petite criminalité. Pour Breivik je crois pas que ça ait été le cas et ce mec à l’air similaire. Ça me semble être une différence avec l’islamisme dans lequel le terroriste a un passé violent. Ceux là, on dirait qu’ils auraient pu rester longtemps à ne faire qu’écrire. Par ailleurs, alors qu’il y a très peu de vrais lone wolves islamistes, celui-ci pourrait en être un, comme Breivik d’ailleurs.
-
Bon je vais arrêter avant la fin car ça commence à être de l’élucubration et en effet du buzzword incantatoire vers la page 60. En gros le mec s'inquiète pour la natalité, revendique une stratégie de polarisation des conflits par des actes symétriques au terrorisme islamique, il redécouvre de fascisme et se paie le luxe d’un tour écologiste qui reste très superficiel. Quelques incohérences relativement à l’aspect institutionnel de sa lutte, à l’anti-impérialisme qui doit n’être aussi évoqué que pour la geste. Je dirais que ce n’est pas psychotique, ni totalement incantatoire, mais en même temps ce n’est idéologique que superficiellement. Finalement ça donne une bonne idée du vernis conceptuel que les types d’alt right niveau bac et pas cinglés en viennent à se donner, et en effet l’isolement y est sûrement pour beaucoup.
-
Je suis à la moitié du machin, ça commence par des trucs un peu trollesques mais par la suite ça prend la forme de paragraphes plus structurés.
-

Méta l'hurlant (mais aussi plus calme)
Anton_K a répondu à un sujet de Hidalgo dans Sports et loisirs
Mouth of Madness <3 -
Je suis allé voir Les Eternels de Jia Zhangke. Le film raconte 18 ans de l'histoire d'une fille (Qiao) de Datong dans le nord de la Chine qui, petite amie du chef (Bin) d'un groupe de petits caïds, fait des années de prison dans le sud pour avoir tiré en l'air avec une arme et l'avoir sauvé d'une bagarre qui tournait mal. Avoir fait de la prison pour ce Bin et avoir du traverser le pays sans un rond fait finalement d'elle la seule à rester fidèle à son compagnon et son ancienne mentalité, et c'est peut-être ce qui lui permet de rester égale à elle même dans une société où rien ni surtout personne n'est plus fiable. Le film est extrêmement beau et est déjà un voyage à travers la Chine. Les deux acteurs principaux sont remarquables et réussissent à retranscrire sans caricature le vieillissement de personnages qui changement beaucoup au long du film, en faisant resurgir à propos des traits et des expressions, si bien que l'impression du temps qui passe et d'assister "à des vies" est donnée avec succès. L'humour est assez présent, pour partie dans des scènes où Qiao roule plusieurs personnages dans la farine, et pour une autre partie de par la manière un peu ridicule et attendrissante dont la culture chinoise se modernise en assimilant des aspects de culture occidentale (la musique des années fin 70-80 "cool" dans les années 2000, les spectacles de "danse de salon" pour faire chic ou pour honorer un mort à ses funérailles, et plusieurs autres remarques sur l'occidentalisation...), mais la superposition de ces aspects avec les ruines accablantes du soviétisme à la chinoise supporte la gravité du propos (notamment une scène où le père de Qiao déclame bourré un discours prolétarien dans les réseau de mégaphone d'une cité minière en décrépitude). Le film est beaucoup moins politique que A Touch of Sin, mais il croque notamment un personnage d'ex-mafieux bien obséquieux reconverti en fonctionnaire oisif après des études de droit en prison. De manière générale le film dépeint la société chinoise comme une sorte de chaos géant de forces qui peuvent totalement emporter quelqu'un qui aurait perdu ses repères, un amas croûlant sous le poids de son histoire, où se côtoient toutes les époques et aucun cadre de référence ne domine. On peut être la copine sexy d'un mafieux adorant une idôle de dieu guerrier un jour, une prisonnière dans une insitution pénitentiaire inchangée depuis les années 30 un autre, passer à deux doigts de refaire sa vie avec un chasseur d'OVNI, et seul un instant de survie farouche permet retrouver la route de chez soi. Je le recommande.
-
-

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
It’s a landslide ! -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Assez d’acord. Oooh non. L’axiomatique c’est très utile : ça permet de résumer une infinité d’informations sur des objets mathématiques avant même de les connaître, en particulier de garantir des propriétés de systèmes techniques critiques, pour autant qu’ils soient formalisables. Et là je me ferai kassadien : c’est de se servir de l’axiomatique pour chercher des vérités absolues et universelles qui est un peu douteux. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Je trouve que j’ai déjà pas mal développé la question, non ? Je peux circonstancier quant au principe d’existence de l’existence mais ça ne changera pas grand chose. @Johnathan R. Razorback tu peux citer et demander des clarifications s’il en faut. Pour vous donner du pop corn à moudre je résumerai grossièrement la position « déconcertante » comme suit (là encore, je l’ai déjà fait dans mon paragraphe précédent sur le rapport entre coût de l’engagement ontologique et richesse de la théorie métaphysique) : le problème de la tradition intellectuelle occidentale c’est de préférer dire que l’on a vu la vierge, plutôt que de dire que l’on estime simplement faire les choses mieux que les autres. Et ça ne nous rend même pas plus tolérants pour autant ! -

Jordan B. Peterson
Anton_K a répondu à un sujet de Eltourist dans Politique, droit et questions de société
-

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Oui, mille fois oui. Vous êtes plus lyotardien que vous en avez l'air au premier coup d'oeil, l'ami. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Aaaaah la théorie de la correspondance preuve-programme... neuronal ! J'aime beaucoup (no irony) -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Oui, au sens où notre théorie de la vérité définit la norme d'une bonne théorie, de la bonne manière de la construire et de la tester. Mais notre théorie de la vérité elle même ne tombe pas du ciel. Subjectivement c'est la pierre de touche de l'entreprise scientifique, objectivement c'est un ensemble de contraintes sur le discours et la pratique scientifique, et cet ensemble de contraintes évolue lui même selon les besoins si c'est un changement conscient, et dans ce cas là il faut chercher une autre norme à laquelle cet ajustement se plie, ou par sélection dans beaucoup de cas où le changement n'est pas conscient. On peut oublier le fait qu'elle a évolué, en considérant toujours que l'on est commis à tenir sa version actuelle comme absolue (et en un sens on l'est, en tout cas on est commis à utiliser ce qu'on pense en être la meilleure version), mais notre théorie métaphysique n'est pas obligée d'être aveugle quant à cette évolution. Je ne suis pas en train de dire que ces dernières observations valent comme épistémologie normative qui serait "anything goes", mais je pense qu'elles participent à une métaphysique un peu moins naïve (notamment relativement à ce qu'est effectivement le travail scientifique et le travail logique) que celle que tu sembles défendre. Faire de la théorie de la vérité courante un absolu, en un sens c'est occulter l'aspect de jugement de valeur qu'il y a dans l'engagement dans le paradigme considéré comme le meilleur. Alors que finalement, mon avis est que ce n'est pas un engagement ontologique beaucoup plus coûteux parce qu'il serait plus explicitement normatif que la simple affirmation qui est la tienne et que j'ai cité. Si tu ne vois pas ce que je veux dire, dis le moi, je peux reprendre et j'ai même un papier à ce sujet. TL; DR : Au lieu d'affirmer "la norme A est nécessaire absolument" sans preuve, tu affirmerais "la norme A n'est pas nécessaire absolument mais est la meilleure option", sans plus, ni moins de preuve. Tu gardes le même degré d'engagement dans l'entreprise scientifique, mais ta théorie métaphysique est enrichie. Qu'en dis-tu? J'ai aussi une approche de la raison que je considère comme fonctionnelle (la raison comme faculté de réaliser des enchaînements contrôlés et réguliers de représentations formattées, ce qui permet la réplication et l'objectivité - ou au moins l'intersubjectivité), mais je trouve le concept d'efficacité qui est une sorte de finalisme implicite un peu mal venu. Trop finaliste pour être de l'évolutionnisme, pas assez finaliste pour ne pas être une sorte du pragmatisme naïf. Enfin ça comme vous savez c'est une marotte que je traîne depuis mongtemps, et je n'irai pas jusqu'à dire que je suis prêt à donner une solution satisfisante. D'accord avec ça. Si c'est à dire qu'il n'y a que l'erreur qui permette de faire l'expérience de l'universel, je suis bien évidemment d'accord avec cela. Mais l'erreur ne se donne pas dans un langage. Là je ne suis pas du tout d'accord mais je ne sais pas si c'est le lieu pour une discussion technique. Alors là pour le coup j'aimerais bien être sûr de ce que tu veux dire exactement. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
L'objectivité c'est encore une autre affaire, dont on n'a pas tellement parlé. Promis je réponds demain, mais remarque pour l'instant que la proposition que j'esquisse (sans grande certitude, n'est-ce pas...) sur la primauté de la préférence et ses opportunités fondationnelles est probablement très très opposé à ce que pensait Kant, qui aurait eu tendance à rechercher la cause de la préférence et, l'ayant trouvée, à disqualifier la préférence comme ne produisant presque toujours que des impératifs hypothétiques. Je dis ça juste au cas où un malentendu guetterait. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Si tu permets je vais digresser un peu. Les problèmes du fondement de la connaissance dans des axiomes qui seraient fondés en pure raison, sont à mon avis, d'une part, (i) que le fait qu'ils soient choisis comme axiomes a beaucoup moins à voir avec la nature de notre rapport à ce qu'il décrivent ou leur degré d' "évidence" que ce que l'on croit, et d'autre part, (ii) que nous avons tendance à penser que, sont nécessitées par le simple exercice de la raison, des observations qui ont beaucoup plus à avoir avec l'usage que l'on veut faire de la raison. Ici par raison j’entendrai la capacité à imposer à sa propre pensée un ensemble de règles de formatage et d’enchaînement de représentations (à manipuler des symboles de manière réglementée si tu veux). Relativement à (i) je dirais que le fait d'être un axiome est une considération propre à la construction d'une théorie. Un axiome est la formulation la plus compacte, étant donnée une logique, de l'ensemble maximal de choses que l'on veut voir prédites par la théorie. Cela n'a pas vraiment de rapport avec la propension de ces axiomes à être des fondements universels et incontestables. Une manière de chercher un axiome incontestable bien explorées dans la philosophie occidentale, c'est de le chercher parmi ce qui à trait aux conditions du discours, ou au conditions de toute argumentation ou de toute énonciation, ou au moins de toute énonciation à propos d'un domaine très général auquel il semble invévitable d'avoir à faire. On pourrait appeler ces axiomes des "principes formels" pour parler comme Kant. C'est exactement ce qu'est l'axiome de non-contradiction (d'ailleurs le fait, rappelé par l'article wiki, que dans la logique propositionnelle classique, ce principe n'en soit pas un mais soit un théorème qui découle des propriétés d'autres connecteurs logiques illustre bien ma première remarque), et c'est aussi, mais à moindre raison, le cas de l'impératif catégorique Kant ou de l'axiome de l'action chez Mises. Entre être un "fait de logique" et être un axiome il n'y a à mon avis aucun rapport de nécessité, c'est seulement dans la quête d'un fondement de la connaissance dans la raison pure que l'on a cherché des axiomes qui seraient aussi des "faits de logique" ou des "principes formels". Les exemples de Mises et de Kant sont importants, parce que je vais prétendre que le principe de non contradiction n'est pas non plus un "fait de logique" impliqué par l'usage de la raison déductive, mais plutôt un fait que l'on doit reconnaître si cette logique doit être vue comme l'étude d'un domaine bien particulier : une certaine conception de la vérité. Ce qui nous amène au point (ii). Souvent on essaie de faire passer certains axiomes pour des "faits de logique" (Leibniz s'y est aussi essayé d'ailleurs), à mon avis c'est une erreur parce qu'il n'y a pas de purs faits de logiques - et c'est pour ça que j'emploie le terme "formel" dans un sens qui ne veut pas dire "syntaxique" ou "logique" ici, mais qui veut plutôt dire "impliqués par le sujet dont on veut parler"... En quelque sorte, ce sont plutôt des énoncés analytiques d'un concept qui serait "caché" dans la forme constituée par le système de règles. Ceux qui connaissent la logique modale (@Kassad, si tu es là, ces élucubrations pourraient t'intéresser) verront peut-être ce que je veux dire : un connecteur se met à jouer par ses règles d'introduction et d'élimination le même rôle qu'un prédicat dont on aurait pu faire la théorie au premier ordre. Dans la logique déductive, ce concept analytique ce serait la "vérité", au sens de propriétés très particulières de l'expérience sensible, que nous avons apris ou été amenés à considérer comme importantes. Bref pour revenir à la question de JRR : ce que je suis en train de dire, en somme, c'est qu'il n'y a pas de logique qui soit totalement indépendante de ce dont on veut parler, et que cela, ce n'est peut-être pas si universel que l'on voudrait le croire. En effet le principe de non-contradiction est à peu près incontestable, parce que tous les énoncés qui auraient une forme violant ce principe sont, pour nous, dépourvus de sens. C'est là son caractère "formel". Si toute notion de vérité commensurable à celle qui existe dans l'épistémologie scientifique moderne implique un tel usage du langage, alors il est plausible, en effet que l'acceptation du principe de non-contradiction soit commandée à tous les participants à cette communauté linguistique, pour parler comme Mises. J'insiste, non pas en tant qu'il est un axiome, mais en tant qu'il est un énoncé "formel", et ici, le "domaine" sur lequel porte cet énoncé, c'est ce que nous appelons "la vérité". Maintenant, la question difficile : peut-on raisonner SANS principe de non-contradiction ? Oui, tout à fait, si par raisonner on entend établir un système régulier de génération et de vérification d'énoncés. Pour traiter le cas de la déduction à partir d'un ensemble contradictoire d'hypothèses, qui peut apparaître instrumentalement dans des preuves mathématiques, tout en restant cohérent avec l'interdiction de la contradiction les logiques habituelles on recours à un outil médiéval : le "ex falso quodlibet". On interdit la contradiction en introduisant la règle qui dit que si l'on accepte une contradiction, l'on accepte tout, ce qui rend trivial l'effort de déduction. D'une part l'usage d'un tel stratagème de bricoleur pour donner une substance au principe de non-contradiction est très important, car il montre que ce n'est pas en tant que pure méthode de construction régulière d'énoncés que la logique demande la non-contradiction, dont je dirais que ce n'est pas la raison en tant que telle elle même qui exige ce principe, seulement en tant qu'on veut en faire un usage particulier. D'autre part, cela invite à imaginer de modifier un peu cette règle pour concevoir des logique très similaires aux logiques habituelles mais qui génèrent à partir de la contradiction des ensembles d'énoncés un peu différents. Dans le détail, la pertinence épistémologique de telles logiques se discute et montre qu'une alternative qui semble aussi binaire que la non contradiction admet en fait des nuances. Une logique sans principe de non contradiction a l'air inutile pour produire un discours qui recherche la vérité au sens où nous l'entendons, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne permettrait pas une régularité de raisonnement à l'aide d'autres règles, ces régularité pouvant avoir leur intérêt propre. Cela ne veut donc pas dire qu'une logique dans laquelle le principe de non contradiction est toujours vrai constitue le seul mode de fonctionnement de la raison, si par raison on entend la faculté humaine à susciter des représentations de manière régulière. Cela ne veut pas non plus dire que tu puisses faire accepter le principe de non-contradiction à un raisonneur dont la logique ne serait pas adapté de la même manière que la logique classique à la recherche de ce que nous appelons "la vérité". TL; DR : Tout cela pour dire que, quand bien même je suis très attaché aux logiques dans lesquelles le principe de non-contradiction est vrai, je ne suis pas prêt à dire que ce principe est une vérité universelle. Je dirais que c'est un énoncé analytique d'un certain concept de vérité caché dans la forme (c'est-à-dire dans les règles d'usage des connecteurs) des logiques les plus habituelles (classique, intuitionniste entre autres), et je ne mettrais pas ma main à couper que dans certains cas, non pas l'abandon total du principe de non-contradiction, mais une certaine alteration de ce principe, par exemple en contraignant un peu le ex falso quod libert, ne pourrait pas avoir son intérêt. Pas certain que le problème des fondements axiomatiques soit nécessairement ou si souvent un problème de gap is-ought. On peut imaginer un axiome acceptable qui ait un contenu normatif. Oh, tiens, comme l'énoncé d'une préférence? En fait ce qu'il faudrait ce serait trouver un ensemble d'axiomes "formels" qui aient un contenu normatif, et une fois de plus c'est peu ou prou comme ça que Kant présente son problème dans Les Fondements de la Métaphysique des Moeurs. Aaaah, ça fait longtemps que j'avais pas liborgué de la sorte, je suis bien content (demain je vais passer ma journée à l'éditer). -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Remarque que je parlais plus d’universalisation de ses propres préférences que d’universalisation de la licence. Mais tu as raison de remarquer que peu de traditions intellectuelles ne tentent l’universalisation sans faire appel à un système de justification a minima intersubjectif. Edit : par contre la règle d’or ne correspondrait-elle pas à une universalisation d’au moins une partie des préférences arbitraires ? (Celles relatives à la manière d’être traité par les autres). -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Ou à considérer que l’on ne peut souhaiter pour autrui mieux que ce que l’on souhaite pour soi. Mais là nous allons avoir un problème quant à ce sur quoi porte le jugement : un état du monde concernant soi même et les autres, ou un principe de conduite personnel qui serait suivi par les autres. C’est exact, je parlais de réalisme moral et j’ai généralisé abusivement l’exemple que je donnais. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
J’ai oublié un cas d’universaliste non relativiste ET non platonicien : celui qui considère que sa préférence EST l’unique vérité morale et qui juge de tout relativement à cette préférence. Ce n’est d’ailleurs pas la position la moins solide étant donné l’acces privilégié que l’on a à ses propres préférences. C’est la position « droit dans ses bottes ». Le fait de savoir que l’on ne se fonde son jugement que sur sa propre préférence n’empêche pas de le considérer comme universalisable n’induit ici aucune considération quant au rapport entre le jugement d’autrui et la validité du sien propre, ni au rapport avec un éventuel objet ou fait moral objectif extérieur à cette préférence. Ce qui est à la limite plus douteux c’est que cette préférence se donne comme un énoncé que l’on pourrait dire vrai ou faux. Avec suffisamment d’introspsection et de travail conceptuel c’est peut-être possible. C’est aussi un cas de figure très solitaire où l’on est à la fois très sûr de soi et où l’on n’a pas spécialement le support d’une culture à identifier à ses propres préférences. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Dans les jugements moraux au sens large j’inclus toutes les préférences quant aux moeurs, voire les préférences esthétiques qui se manifestent dans les cultures. Si c’est ça qui n’était pas clair la suite du message est sûrement vaine. La distinction n’est pas extrêmement franche et peut être dissoute par des manipulations linguistiques (préférer le mariage à l’église ~ s’interdire de se marier ailleurs qu’à l’église). Si on va au trivial comme le choix du repas de midi, on aura du mal à faire valoir de telles reformulations. D’aucuns dirait que c’est parce que pour ces choix triviaux, la formulation d’un principe directeur n’est pas souhaitable ou pas possible. Peut être que dès qu’il y a principe, il y a une formulation négative... Mais même si l’on se restreint aux choix qui peuvent être guidés par des principes et si on évite un peu le problème de la reformulation, mon intuition assez banale est que, descriptivement pour commencer, il y a une corrélation entre la spontanéité d’une formulation négative et l’universalité (interdit du meurtre, du vol, de l’inceste, etc). D’ailleurs il est même plausible que ce soit la gravité d’une situation qui suscite une conceptualisation de l’acte propice à une formulation négative d’une norme, de sorte à bien identifier ce qui est à éviter. edit : les choix vestimentaires sont un bon cas intermédiaire : la mode peut être identifiée, des principes peuvent être formulés, la divergence de la prescription peut être sanctionnée très légèrement ou implicitement, mais on ne ferait pas d’une faute de goût un délit, donc formuler négativement ne semble pas très pertinent. Dans tous les cas, il est possible qu’une séparation entre deux types de normes, préférentielles et d’interdiction, soit facilement déconstructible et difficile à conceptualiser relativement aux actes eux même. Par contre dans le langage et les représentations j’ai l’impression que la distinction est bien établie, et cela peut peut-être informer une théorie morale. D’ailleurs dans le context libéral qui connaît la notion de droit négatif à distinguer des moeurs qui sont un espace de tolérance, cela ne devrait pas surprendre. J’ai l’impression que cela fait beaucoup de mots pour pas grand chose, j’espère que je ne m’engouffre pas dans un malentendu. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Pour kant lui même sûrement, mais ce qu’est un humain dans l’a priorisme kantien a été sujet à apres débats... J’irai voir, merci. C’est pire que ça, il y a des relativistes qui sont aussi des universalistes (non platoniciens)... les problèmes kantiens évoqués nous amènent rapidement vers ce genre de considérations. Autant dire (enfin c’est mon avis) que si on ne prend pas le platonisme au sérieux cette histoire d’opposition entre universalisme et relativisme peut soit se dissoudre, soit devenir une question empirique : étant donné que ce qui est bon serait ce que tout le monde pense être bon, allons chercher ces universaux. Le contenu strictement normatif de la réflexion est un peu évincé. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
J’hésitais à voter, tu m’as convaincu. Plus sérieusement, de toute façon le problème est qu’en fait, relativisme et universalisme ne traduisent que très mal les niveaux de confiance (justifiée) dans des énoncés scientifiques... surtout chez les scientifiques eux-mêmes et à plus forte raison les mathématiciens, voire pire, les informaticiens, ces pirates de l’ontologie. Le problème peut être illustré comme ça : le relativiste étant celui qui, quand on dit « A est vrai », ou « A est bon » (ou « il est vrai que A est bon » - raccourci aussi tentant que douteux, mais faisons le pour l’instant), demande « mais pour qui ? ». Ce « qui » peut être restreint aux individus, ou à des critères particuliers, mais on peut aussi imaginer voir plus large : des groupes, voire des institutions, voire Dieu... Dès lors il y a plusieurs universalistes assez différents. Celui qui ne comprend pas pourquoi la question « pour qui? » est posée, parce que la vérité n’a rien à voir avec un « qui » (le platonicien, disons) celui qui répond « pour tout le monde, a priori » (le kantien, disons) et celui qui répond « pour tout le monde, a posteriori » (l’anthropologue optimiste, disons).