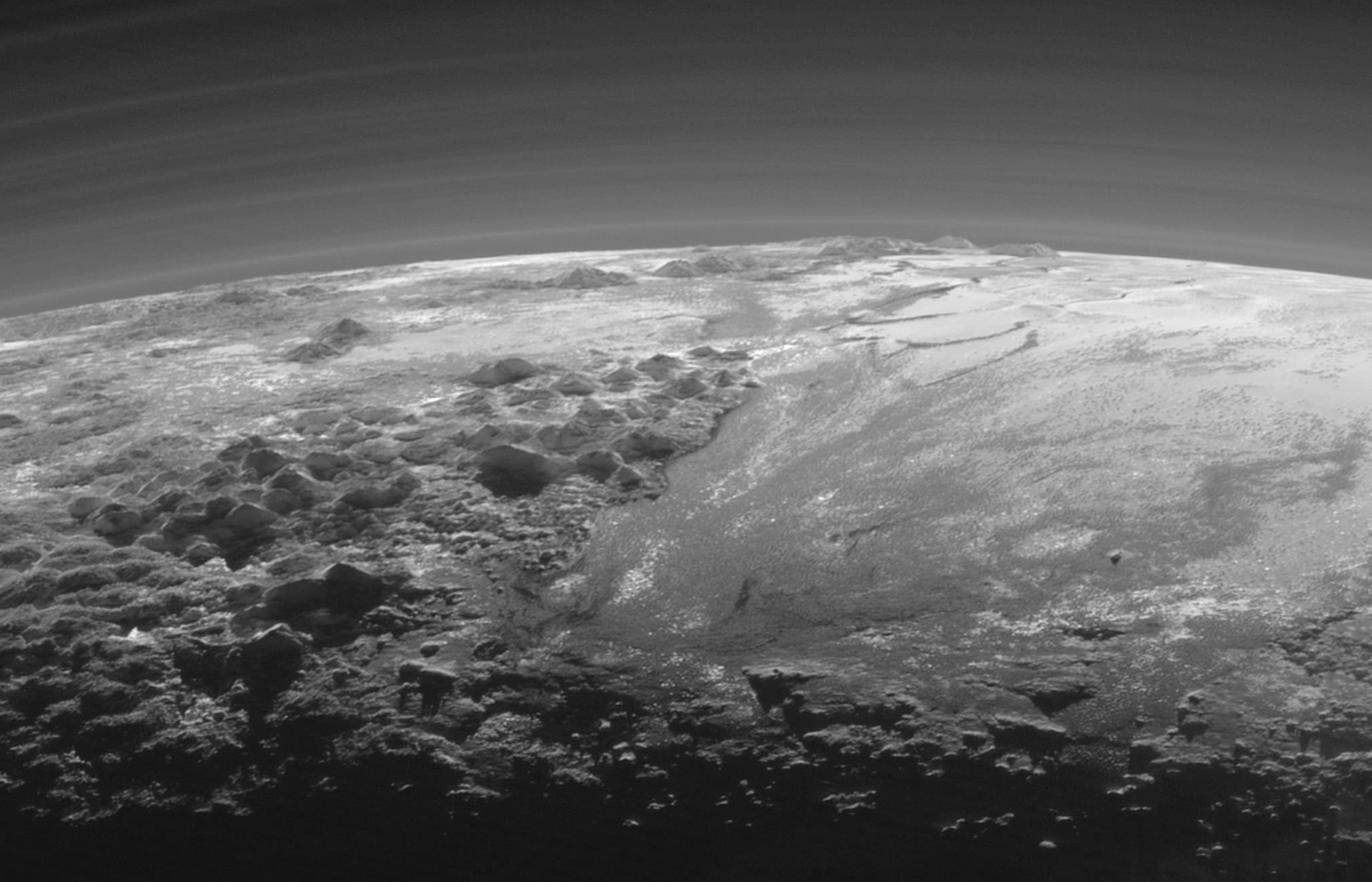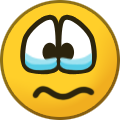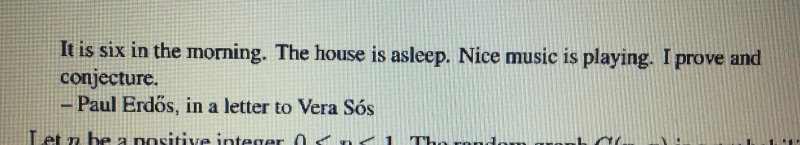-
Compteur de contenus
6 075 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
22
Tout ce qui a été posté par Anton_K
-
Plusieurs, et même morts avant la seconde guerre (famille de rouges brestois, instituteurs, cheminots, anarchistes - la totale). Tiens d'ailleurs cultiver la mémoire de ces ancêtres là c'est bourgeois ou pas ?
-
Au temps pour moi, j'y suis allé un peu fort dans une captatio benevolentiae qui en plus de ne pas me ressembler était plutôt contre-productive ici. Je sais que la sociologie et l'anthropologie ne se donnent pas de critères de rigueur popperiens, et malgré mes lectures variées et fréquentes en la matière (j'ai pu mettre la main numérique sur le premier bouquin conseillé par @poney, auquel je vais jeter un oeil), au delà de la production de distinctions ontologiques, de rappels sur les différences d'avec les sciences naturelles, des rappels historiques sur le structuralisme - seul vrai grand rival à mes yeux à la méthode empiriste-logique, les professions de foi de rigueur, ne se dessine pas très clairement dans ma tête une image de comment ça devrait marcher. Donc ce que je disais n'était qu'une manière paresseuse de passer aux PC leur dénuement méthodologique flagrant, et je t'en demande pardon. Dans l'interview il y a quelques points que je trouvais intéressant : le fait que le revenu ne soit pas un critère suffisant pour définir cette classe, le fait qu'elle possède une conscience de classe qui ne dépend pas de la connaissance sociologique de sa constitution... Mais tout cela n'était que la deuxième partie de la captatio introduisant la suite de mon propos : je pense qu'en tant que discours critique et politique en plus ils sont totalement à côté de la plaque et que ce qu'ils disent peut tout à fait être interprété comme une reconnaissance du bien fondé et du succès des stratégies de reproduction sociale, qui ne mène finalement pas à la décadence mais à la prospérité. Si bien qu'il faut invoquer le changement climatique pour pouvoir dire que tout cela est nuisible. Maintenant, si en effet la grande bourgeoisie dont ils parlent n'est pas réellement la classe dominante, comme le fait bien remarquer @F. mas, et quand plus ce qu'ils en disent est faux ou anecdotique, ça aussi ça tombe à l'eau. D'ailleurs @F. mas a raison de faire remarquer que leur compréhension des rapports de forces et du partage du "vrai" pouvoir est pauvre, et à chaque fois que MPC parle de sujets qui touchent de près ou de loin à la politique économique ou aux évènements financiers on voit qu'elle n'y comprend strictement rien. Quant aux anecdotes de @poney , quand ça confirme ce qui se laisse voir en cinq minutes d'interview, on se prend à penser que finalement, la psychologie naïve et ses biais stéréotypiques permettent peut-être bien une forme de connaissance. Sur ce, je me mets à l'auto-ethnologie.
-
J'ai écouté distraitement l'interview de Monique Pinçon-Charlot faite par Thinkerview récemment. Evidemment ces chercheurs n'ont pas une démarche scientifique en un sens fort puisque leurs travaux ne contiennent que des témoignages et pas des mesures, et des témoignages obtenus dans des situations absolument pas contrôlées, et limitées manières qui leur est d'ailleurs apparente. Maintenant, ça rentre quand même dans les canons de l'anthropologie et la sociologie de terrain et de toute façon, une classe sociale comme la grande bourgeoisie ne peut probablement pas être étudiée d'une autre manière. Donc ce qu'il racontent est toujours de l'information et n'est souvent pas inintéressant. Ce qui m'amuse quand même c'est la nature de leur discours critique, qui finalement ne consiste pas du tout à présenter, comme c'est souvent le cas à gauche et à l'extrême droite, la classe dominante comme décadente, corrompue ou autrement usurpatrice de la légitimité de ses pouvoirs. Il consiste à camper une position métaphysique triviale : affirmer l'arbitraire de l'héritage par les membres de cette classe des qualités de leurs parents. Souvent en confirmant qu'ils les possèdent bien (ils sont cultivés, beaux, intéressants, propres, ils arrivent à produire les talents nécessaires à la poursuite des affaires...). Tout en échouant à montrer, et j'ai l'impression que c'est la conséquence d'un choix, que ces qualités sont bien des privilèges au sens ancien régime et légal du terme, ils appellent ces qualités des privilèges. Et ne manquent pas de développer une forme de misérabilisme ("on se sentait moche à côté d'eux" - c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle parle de violence du pouvoir, je pense qu'à l'extrême gauche ça doit grincer). Finalement tout cela fleure bon l'existentialisme : "les bourgeois ne méritent pas d'être beaux et riches parce qu'ils auraient pu naître ni beaux ni riches..." Finalement la portée critique de leur discours n'est pas politique, c'est une révolte contre la vie même et sa direction la plus spontanée : l'accumulation et la transmission . A la limite la traduction politique de leur critique serait la prise en charge des richesses familiales et de l'éducation des enfants par une puissance égalisatrice.
-
Je suis allé voir The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Plutôt cool jusqu'à la moitié je dirais, avec un rythme lent un peu trollesque et un jeu entre la parodie et la "parodie de parodie" qui rappelle d'ailleurs pas mal Twin Peaks. Sauf qu'à un moment c'en est trop. C'est même sûrement voulu d'ailleurs, mais à un moment donné il faut quand même essayer de faire, autour de pirouettes qui finalement ne coûtent rien, un film devant lequel on a envie de rester. Enfin ça n'est que mon avis.
-

Élections européennes de 2019
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Europe et international
Je ne sais pas exactement ce que l’intensité de couleur mesure, mais ça donne l’impression que les soutiens de Macron étaient dans les quartiers « bobos », et les soutiens de LREM aux européennes étaient dans les quartiers les plus riches. -

Ces phrases qui vous ont fait littéralement hérisser le poil 2
Anton_K a répondu à un sujet de Mathieu_D dans La Taverne
Certainement, par contre le fait de n’avoir jamais fait de recherche et de ne pas avoir idée de comment ça marche génère aussi certainement le problème dont il parle. -

Pubs du gouvernement chinois sur Youtube
Anton_K a répondu à un sujet de Riffraff dans Europe et international
J’ouvre une petite parenthèse : je connais aussi et apprécie plutôt cette chaîne, et récemment au détour d’une vidéo d’une journaliste du Monde j’ai entendu dire qu’elle était financée par le Falun Gong, une organisation sportive et spiritualiste très anticommuniste (biais quand même assez évident dans China Uncensored au delà l'interêt factuel du contenu de la chaîne). La vidéo du Monde a l´air elle plutôt impartiale, avec peut-être un léger biais contre cette organisation. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, mais c’est plutôt intéressant cette guerre de l’information. Pour l’anecdote j’habite en face des anciens bureaux parisiens de Epoch Times. -
"Wow", combien d'années de réflexion pour prendre une position si courageuse d'un côté si imprévisible d'une distinction si fine. Bravo vraiment, mes félicitations au Dr. Némo. Et cette image stock, c'est exquis. edit : sur le fond, la première partie est bien, dans le premier paragraphe de la deuxième partie on perd un peu le point, dans le deuxième paragraphe, zou, en vrille dans le décor.
-
Pas mal de clips de k-pop sont bluffants (beaucoup plus que le dernier posté), en général les prods sont impecs, les mélodies catchy, les pop-star plastiquement irréprochables. C’est ultra lisse mais en général c’est flawless dans les standards pop. Je trouve que l’un des seuls défauts « objectifs » de la k-pop actuelle c’est qu’elle bouffe à tous les râteliers, souvent au sein même d’un morceau on a tous les genres commerciaux populaires juxtaposés, pas toujours avec finesse ou originalité. Notons que la k-pop a donné les très rares instances de succès commerciaux entièrement produits dans un ministère de la culture, j’ai cru comprendre que ça faisait partie d’une véritable stratégie de conquête mondiale. Je n’en écoute jamais de moi même mais mon frère joue dans un groupe très inspiré de la k-pop, il m’a fait voir pas mal de clips et expliqué de quoi il retournait. Et ça m´a fait évoqué la même chose qu'à Mobius : forme ultime de l’entertainment de masse.
-
Non pas vraiment. Bienvenue !
-

[Sérieux] Grand remplacement et petite frite
Anton_K a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
? -

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron
Anton_K a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société
C’est pourtant simple : vous pouvez payer moins d’impôts, mais on veut en récolter autant. -

Méta l'hurlant (mais aussi plus calme)
Anton_K a répondu à un sujet de Hidalgo dans Sports et loisirs
On a rarement fait un bon album qui ressemble autant à du Iron Maiden : -
Dans Paterson de Jim Jarmush aussi il est très bon.
-

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron
Anton_K a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société
Damn. Sinon (je sais, je passe vite, mais que dire de plus...), pourquoi ce relooking à la con? -

Les grands chefs d'oeuvre de la peinture occidentale
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Lectures et culture
It also sounds like it. « OOOODAAAA ». Je blague, tout le monde sait qu’il n’y a jamais eu de Renaissance outre-manche. -
Non, lui. Sa page pointe directement vers celle de Stéphan Tomassé (et ils sont co-auteurs), cela dit.
-
Haha oui le prof pour le cours duquel je lis le bouquin que j’ai pris en photo nous a raconté celle là quand on a parlé de ce problème.
-
-

Comprendre et vaincre l'anticapitalisme
Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
My two cents : que ce soit à l’université, chez certains artistes, ou d’autres gens qui écartent a priori l’éventualité d’une carrière dans « le privé », j’ai souvent vu, parfois exprimée explicitement, la peur de la compétition (ça recoupe donc l’option 1). Je ne sais pas exactement à quel point cela explique des préférences politiques anticapitalistes, mais ça amène ces personnes à faire des choix qui les rendent dépendantes du système étatique, et on mord rarement la main qui nourrit. (Dans le cas des universitaires, le réveil est difficile après la thèse, quand l'université devient tout aussi, voire plus compétitive que le privé, j'en vois des exemples chaque jour). -

Méta l'hurlant (mais aussi plus calme)
Anton_K a répondu à un sujet de Hidalgo dans Sports et loisirs
Le morceau laisse à désirer, mais putain ce clip : -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Anton_K a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Cela dit cela nous permet de tester la résistance des universités française à ce genre de stresses, et dans le cas présent on est agréablement surpris. -

ecrivain77 : Quelle Philosophie pour moi?
Anton_K a répondu à un sujet de ecrivain77 dans Forum des nouveaux
Ça fait un moment qu’un livre de philo ne m’a pas vrillé la tête. Je n’en suis pas fier d’ailleurs, mais c’est comme ça. -

Élection POTUS 2016 : Gary Johnson
Anton_K a répondu à un sujet de Librekom dans Europe et international
Le terme « se présenter » n’est pas assez précis dans ce contexte. Il y a une différence entre s’inscrire (to file), ce qui est accessible à tous les membres, et être nommé par le parti. Les nominations n’ont pas encore eu lieu. « As of January 2019, seventeen individuals have filed with the Federal Election Commission to run for President in 2020 as a Libertarian. However, only candidates recognized by the Libertarian National Committee will be eligible for the nomination at the national convention. For a candidate to be recognized by the Libertarian Party, they must: have a campaign website; be a dues-paying member of the party; meet all U.S. Constitutional requirements to serve as President; and not simultaneously be a candidate for another political party. The Libertarian National Committee has not yet recognized any candidate for President in 2020. However, the following notable individuals have announced their intention to seek the Libertarian Party nomination and have established a formal campaign. » https://en.m.wikipedia.org/wiki/2020_Libertarian_Party_presidential_primaries -

Élection POTUS 2016 : Gary Johnson
Anton_K a répondu à un sujet de Librekom dans Europe et international
Comme le chroniqueur l’indique presque clairement, cette candidature ne fait pas l’objet d’une validation par le parti, le type a revendiqué d’autres affiliation dans le passé. Ce qui craint c’est que la chronique s’attarde sur ce type à l’occasion d’un sujet sur les libertariens. Ça ressemble quand même pas mal à une tentative de décrédibiliser les libertariens en créant cette association... comme souvent (late shows, John Oliver, Quotidien, etc) l’info-tainment fait le sale boulot sous couvert de lolz.