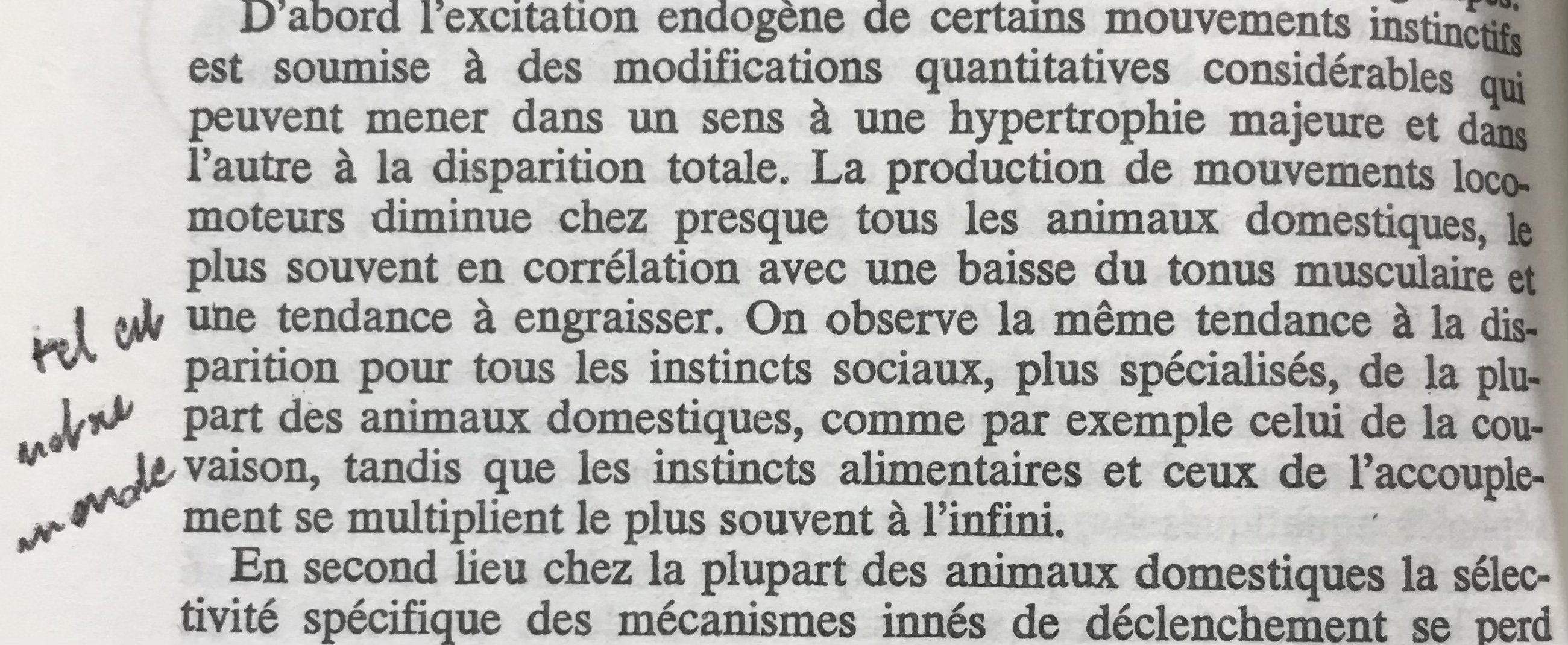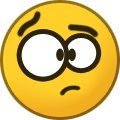-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
Mais... c’est pas John Gray qui fait la préface penguin ?
-
il y a les prefaces qui épargnent la lecture du bouquin. Perso: Aron pour Le Savant et le politique, Starobinski pour l’Esthetique de la réception de Jauss Sinon oui je saute souvent les prefaces meme si après je me sens coupable et je la lis à la fin
-
Oh dear en effet Merci
-
Ses critiques sont parfois valables. Cf. sa review (beaucoup plus courte d'ailleurs) d'Antifragile de NNT edit c'est aussi la culture lesswrong qui veut ça. les gens dans les commentaires pondent des pavés absolument hallucinants
-
En fait si c'est utile parce qu'il critique aussi le bouquin. Peut-être que c'est encore plus profitable si tu as déjà lu le bouquin cela dit.
-
Je pensais aux nazis mais pourquoi pas
-
Pour remédier à ça on pourrait en faire un joli logo vaccinal et le porter en brassard
-
Demander aux gens s’ils sont vaccinés avant de leur vendre des trucs c’est pas libéral ou non libéral, c’est indiscret. Le libéralisme se prononce en premier lieu sur l’action de l’état mais il y en a ici comme moi qui pensent que seules certaines sociétés peuvent être libérales ou prospères selon qu’elles adoptent certaines vertus. La société française n’en fait pas partie. La solution qui consiste à dire que c’est tout simple l’état a qu’à venir régler ça ne me satisfait pas plus que la position thin Je sais pas pour les progressistes mais je vois pas ce qu’il y avait de particulièrement prog dans mon post. certaines personnes peuvent accepter des coûts sociaux même quand c’est pas optimal économiquement je ne défends pas l’interdiction du pass mais juste c’est pas neutre moralement/socialement
-
Le problème c’est que la gestion de crise de l’Etat n’a pas peu contribué à rendre les gens suffisamment paranos pour accepter l’idée d’un pass sanitaire, avec toute la vie privée que ça fout par la fenêtre et toutes les dérives possibles parce que mine de rien il y a des États que le pass sanitaire intéresse aussi On peut toujours raisonner du point de vue strict de l’entreprise mais l’entreprise qui fait ça en France accompagne l’Etat dans l’hysterisation de la société En liberalie peut-être que le pass sanitaire serait contre productif d’un point de vue commercial mais s’il l’était pas (et il ne le serait peut-être pas effectivement dans certaines régions) ça ne changerait rien au fait que la vie dans ces régions serait sinistre Toujours en liberalie les habitants mécontents de ces régions pourraient bouger dans des régions sans restrictions, mais il n’est pas dit qu’ils pourraient se déplacer facilement dans les autres régions où le pass sanitaire serait rentable vu l’âge/le degré de flippette de la population Il serait d’ailleurs étonnant que ça soit aussi clear cut entre régions distinctes. Mon pessimisme me fait penser que ça serait plus des famosa tyrannies de minorité de David Goodenough alias Jean-Michel Vounavépaconulaguerre et leurs copains. Il suffit qu’une entreprise ait cette idée pour créer la pression sociale pour que les autres entreprises s’y mettent aussi Ce n’est pas juste l’entreprise dans son coin qui fait une décision et le marché dans son coin qui décide s’il achète ou pas. Si Flippette et ses amies font circuler une pétition pour que la supérette demande le pass sanitaire et convainquent tout le monde de boycotter la supérette en allant au village d’à côté, c’est pas difficile d’imaginer comment une coutume aussi chiante peut finir par se diffuser sans qu’il y ait de refuge garanti Et tout ça c’est dans l’hypothèse liberalie et on est en France sous Macron
-
Il y a eu mieux comme prestation télévisée aussi j’en conviens En même temps si c’était Andrew Neil qui présentait BFM ça aurait tout de suite une autre gueule
-
En l’occurrence c’est pareil Les vices privés font le bien public Et je n’ai pas entendu Larcher dire de bêtises depuis le début de ce cauchemar donc je suis pas sûr qu’il mérite cette moquerie Ce qu’il dit sur le Sénat est plutôt juste. Pensez aussi à Philippe Bas
-
Ce qui n’était surtout pas malin c’était de dire que Ludovic Moro (oui le taré violent à lunettes) était dans un état “pathologique”. Ça le discrédite tout de suite et après tout le monde le regarde la gueule enfarinée en souriant Cest la qu’on voit que c’est pas Ben Shapiro non plus
-
Cette brochette sur le plateau... on dirait des infirmières et des médecins d’hôpital psychiatrique en URSS Il faut vraiment être un politicien aguerri pour garder son sang froid Enfin bon ça confirme juste le fait qu’il faut arrêter de considérer ces khmers blancs comme dignes qu’on débatte avec eux
-
Non mais c'est vraiment super duper long Ça m'intéresse vraiment parce que cette histoire de close-knit groups qui adoptent des welfare-maximizing norms est une idée très hayékienne (dans la mesure où même une grande société peut avoir plein de close-knit groups qui coexistent) et qu'elle s'inscrit, cette fois explicitement, contre la vision webérienne et aussi contre la vision coasienne de la production de la loi par l'Etat seulement (du moins c'est l'interprétation que Ellickson fait du théorème de Coase). Mais je sais qu'il faut encore que je lise Benson à ce sujet (mais je peux pas tout lire à la fois surtout pas en ce moment, d'ailleurs ma pause est finie et il faut retourner à Sénèque/)
-
Il y a là un article passionnant de Scott Alexander sur Order Without Law, le bouquin d'Ellickson (qu'on trouve en pdf en ligne). Ça intéressera tous les thick libertarians, les lecteurs de James Scott, de Coase, de Hoppe et de Leeson, les anarcaps, et les anthropologues/sociologues du forum. Par contre, c'est super long https://astralcodexten.substack.com/p/your-book-review-order-without-law
-
C'est @Rincevent qui ne va pas apprécier la comparaison
-
Jusqu’à récemment je ne savais pas qui c’était et quelqu’un m’avait dit “mais si c’est l’homme à l’écharpe rouge!” Qu’un “intellectuel” (si pseudo intellectuel soit-il) soit principalement reconnaissable à ça en dit long: le mec n’a jamais écrit le moindre article, éditorial, livre digne de rester dans la mémoire collective. C’est un peu comme si quelqu’un disait pour Sartre: “mais si c’est l’homme avec un strabisme!”
-

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Café des sciences? -

[Sérieux] Ethno-différencialisme, race-realism, génétique et courbe en cloche
Vilfredo a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
Oui là c'est plutôt un TPE -

[Sérieux] Ethno-différencialisme, race-realism, génétique et courbe en cloche
Vilfredo a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
Intéressante démonstration que l'intégralité des ancêtres qui ont vécu entre 2020 et 1789 (1024 apparemment) pour l'intégralité de la population française actuelle (67M) ne vivaient pas tous en même temps en France en 1789. Il devrait faire une vidéo pour montrer que mon arrière-grand-père ne peut pas vivre à la même époque que mon futur petit-fils. This just in: les gens meurent. -
Je savais pas qui c’était mais il est prof a Paris I et écrit des articles sur la bio l’épistémologie et la théorie des jeux. Il en a même écrit un avec K Binmore. Les gens intelligents qui écrivent des trucs cons c’est toujours impressionnant Jai l’impression que c’est juste un cas de plus de mec incompétent hors de son domaine de spécialité mais qui l’ouvre quand même
-
Comte sponville: la santé est un bien, la liberté une valeur Twitter: so you’re saying que la liberté est une valeur supérieure à la santé ?
-

Selon Libération, le mouvement libertarien français sabote la transition écologique
Vilfredo a répondu à un sujet de Adrian dans Actualités
À la limite oui Les autres en effet sont libertarians comme je suis concis -

Selon Libération, le mouvement libertarien français sabote la transition écologique
Vilfredo a répondu à un sujet de Adrian dans Actualités
Alors qu’en fait tout le monde sait mtn que c’était les juifs