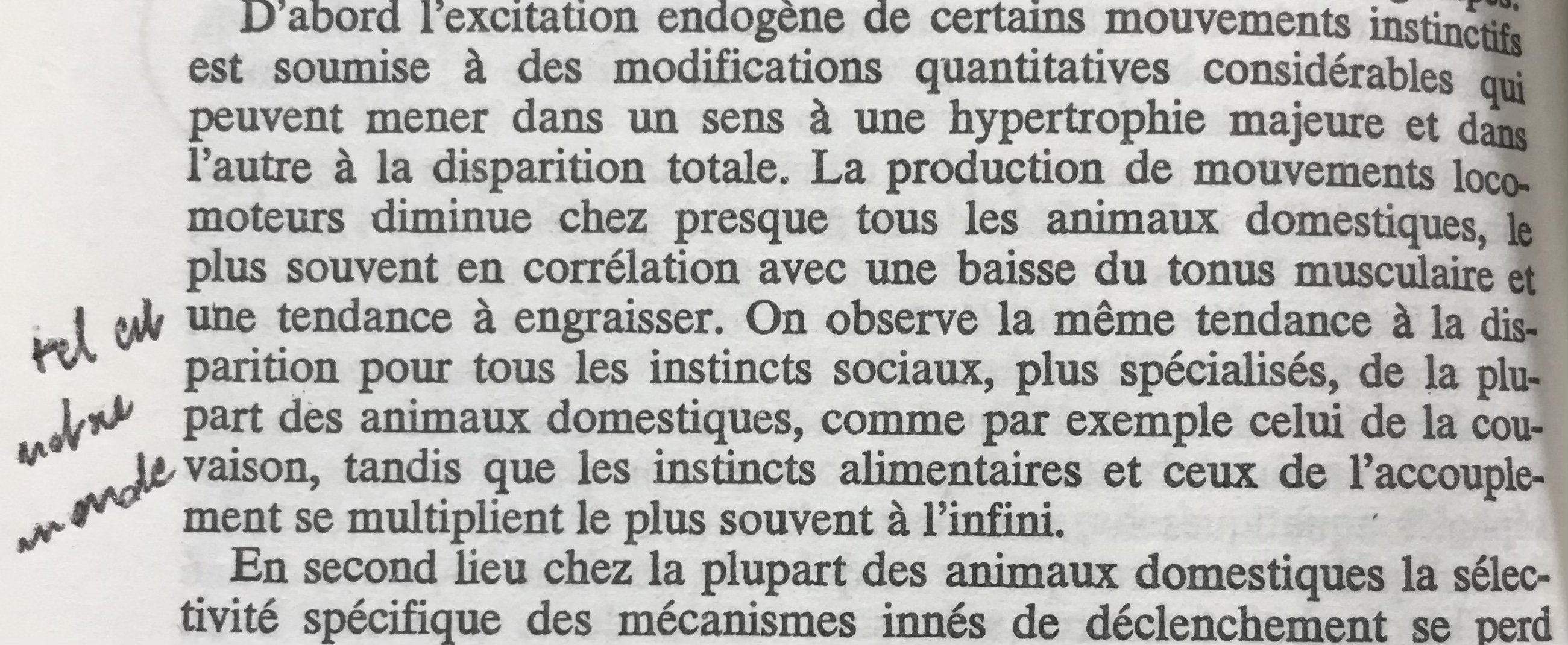-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-

Libéralisme, Conservatisme et la question du pluralisme
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Et c'est comment pour quelqu'un qui n'a jamais lu Hoppe (sauf quelques articles en pdf sur le Mises Institute ?) ? -

Libéralisme, Conservatisme et la question du pluralisme
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Oui clairement mais je n'ai pas été clair : je ne voulais pas savoir si tu voulais y vivre mais comment tu comprenais leur persistance depuis des décennies alors même que ce sont des communautés socialistes libres qui ne se sont pas autodétruites pour autant que je sache. On dit que Democracy : the God that failed c'est bien... Et je voulais voir si l'article allait atteindre le niveau de Nolte et de la querelle des historiens (sur Hitler qui luttait avant tout contre le communisme) mais même pas. -

Libéralisme, Conservatisme et la question du pluralisme
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
+1 J'imagine que c'est pour ça que les hoppéens sont peu appréciés sur le forum. Dans le genre anti-pluraliste, ça se pose là. D'ailleurs j'allais le poster sur "les phrases qui m'ont fait hérisser le poil" mais cette défense "libertarienne" (so to speak comme dirait HHH) du nazisme est à sa place dans un fil sur le pluralisme et le conservatisme : /!\ https://radicalcapitalist.org/2018/04/10/fascism-is-a-step-towards-liberty/?fbclid=IwAR14TpAa0qCxK9cQA1rfehLNMB4ppKWcvndXOIQKv7Nd8ZCTd0szRVS3eVQ /!\ Moui je connais mal les kibboutz mais je me demande ce que tu en penses quand je te lis. -

Libéralisme, Conservatisme et la question du pluralisme
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
Hâte de lire ça. En attendant merci pour Macpherson En dehors de tout ça, il reste marxiste... On n'entend pas la même chose par coercition. Well, si ce sont des "property owning elites", c'est qu'elles ont du capital et leur nombre laisse penser que leur apparition s'explique par... l'economic freedom justement. Les économistes soviétiques goulagisés l'entendent. Mais je trolle Macpherson pour le plaisir parce que c'est très bien sur Hobbes et Locke, évidemment. -

Libéralisme, Conservatisme et la question du pluralisme
Vilfredo a répondu à un sujet de Rincevent dans Philosophie, éthique et histoire
C'est triste pour le marxisme parce que son livre sur le libéralisme et la justice sociale contient des passages sur Nozick et Hayek qui m'avaient paru complètement idiots. Une resucée des arguments de Cohen sur la propriété qui produit des inégalités mortelles quand elle s'applique aux ressources vitales (monopole sur l'eau et autres exemples contenant des tonnes d'hypothèses totalement irréalistes qu'on te demande d'accepter pour que monsieur puisse continuer sa démonstration wtfquesque) : n'est pas juste ce qui résulte d'un échange juste entre personnes consentantes (Nozick) parce que les personnes consentantes sont trop bêtes et ne mesurent pas les conséquences de leurs actes : donc n'est juste que ce qui résulte du processus d'échange consentant nozickien et dont le résultat est/serait accepté par les contractants s'ils le connaissaient à l'avance. Et pour Hayek, Collin, dans mon souvenir, faisait un cherry-picking décourageant de mauvaise foi avec pour seule source la Route de la servitude. Faudra que je retrouve quel était son argument (sa réfutation pâlotte de Nozick m'avait plus frappé) mais ça ne pissait pas loin. Et sinon, Macpherson, ça marche comme marxiste le moins bête de l'histoire ? Parce que, comparé à Collin, La Théorie politique de l'individualisme possessif (qu'il faudrait que je termine ) me paraît plus robuste. Qu'en penses-tu @F. mas ? -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
En effet mea culpa. Merci beaucoup et je n'ai pas lu Feyerabend, mais on m'en a dit le plus grand bien. Je ne connais que de seconde main. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Je me souviens pas de passages sur Kuhn dans La Logique de la découverte scientifique... Et c'est tout ce que j'ai lu de Popper Tu aurais un bouquin à me conseiller sur les divergences Popper/Kuhn s'il te plaît ? Popper traite-t-il directement de la structure des révolutions scientifiques, de la conception de Kuhn des paradigmes ? Je vois bien où doit se situer la mésentente mais je suis curieux. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Merci je vais lire ça. Auto-orienté alors. En fait c'est une catallaxie ! OMG. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Je définirais optimisatrice ici comme l'idée que l'évolution culturelle part du bas et va vers le haut, se dirige vers une amélioration. Je n'ai pas été suffisamment rigoureux : si l'augmentation inévitable de capital cognitif au cours de l'évolution recoupe l'idée d'une optimisation, la proposition "l'évolution culturelle est optimisatrice" pose quand même deux problèmes : (en dehors même du fait que dans la théorie synthétique de l'évolution, je crois qu'on admet volontiers qu'il y a plein de phénomènes annexes comme les trompes qui ne sont pas liés à l'adaptation) 1) c'est comme dire que la concurrence est optimisatrice : c'est une proposition que seule la concurrence elle-même peut vérifier a posteriori et qu'elle vérifie constamment (on peut donc seulement dire que la non-compétition c'est nul mais pas à quel point la compétition est avantageuse, puisqu'elle enrichit notre capital cognitif d'informations et de connaissances dont nous ne disposons pas encore). C'est un peu le même problème que posent beaucoup d'énoncés positivistes en économie (et c'est la raison pour laquelle Hayek se méfiait de Friedman) : on ne peut pas dire de combien une augmentation de la masse monétaire va augmenter les prix ; on peut seulement dire qu'en présence d'une augmentation de la masse monétaire, les prix seront plus élevés (relativement) que s'il n'y avait pas eu cette augmentation. La hausse des prix sera plus élevée. Pas de corrélation nécessaire entre les agrégats économiques. 2) L'évolution culturelle s'applique chez Hayek aux institutions de même qu'elle sert l'adaptation des organismes au milieu. Il ne faut donc pas entendre optimal dans son sens étymologique (en latin, optimus est le superlatif de bonus, bon) mais au contraire de façon relative : l'évolution est mieux comprise si l'on se rapproche à mon avis du schéma de Toynbee challenges/responses. Est-ce que le stade évolutif d'un coquillage fossile vivant est optimal ? Si l'on entend optimal dans un sens absolu, non : ce coquillage est complètement attardé. Mais raisonner ainsi n'a pas de sens, car ce coquillage est parfaitement adapté à son milieu. Personne n'ira dire que ce coquillage est inférieur à une espèce de requin particulièrement prédatrice et évoluée : tout est une question d'adaptation et comme le dit Lorenz, si l'on prend l'analogie d'un immeuble, dans l'évolution, les étages du bas sont tous remplis, et l'évolution consiste à créer des étages supérieurs. De ce point de vue, je vois mal comment dans une certaine mesure, l'évolution n'irait pas forcément vers le haut, vu qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place au 1er étage L'idée que l'évolution serait optimisatrice me dérange quand on donne un sens absolu à "optimal" parce que ça suppose que l'évolution est orientée hors on n'en sait rien (personne n'a le savoir absolu contrairement à ce que Dupuy suppose dans la thèse de Hayek, puisque pour lui, afin que la thèse de Hayek se vérifie, il faudrait supposer une transcendance omnisciente qui justifie la nature optimisatrice de la fonction d'évolution, hors il comprend mal ce qu'"optimisateur" veut dire amha). A l'aune d'une vue optimisatrice de l'évolution, on pourrait regarder où en sont les civilisations dans la "course" vers le Mieux, celles qui sont à la traîne et celles qui ont une longueur d'avance. Sauf que toutes les civilisations ne courent pas dans le même stade ^^ Again, challenges/responses. Et donc on ne compare pas les civilisations -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
+1. Par contre je ne te suis pas sur le human flourishing. Disons que ça me paraît un peu vague (les Chinois sont supérieurs aux Abbassides parce que ce sont eux qui ont découvert le papier les premiers ? A l'évidence la découverte du papier participe à fond au human flourishing !). L'avantage de reprendre un peu Toynbee est que, comme tu le dis, ça ne mène pas à la république des civilisations (au sens où Lorenz parle d'une république des instincts) où nous jugerions et attribuerions les bons et les mauvais points : les challenges sont aussi spécifiques à chaque civilisation, il n'y a pas de challenges qui seraient des big boss et que les civilisations affrontent en rang d'oignon et on voit qui finit KO. La famine en Judée au Ier siècle et la façon dont les Juifs y résistèrent plus ou moins bien (en se révoltant contre les Romains et les Grecs) n'a rien à voir avec une famine à une autre époque, dans une autre civilisation. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Oui en effet c'est pour ça que comparer des civilisations, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je parle d'adaptation dans mon post. On peut juger un individu car il appartient à une civilisation, mais quelle instance va nous permettre de comparer les civilisations (puisqu'il ne s'agit même pas seulement de juger)? La valeur d'un individu dépend aussi d'une question d'adaptation : en théorie des jeux, dans une population dominée par la stratégie "defect" (dilemme du prisonnier), toute autre stratégie est suboptimale. Donc libre à toi de te faire arnaquer en coopérant alors que tout le monde trahit, mais ton comportement disparaîtra soon enough : comment valoriser un comportement qui va à rebours de l'autoconservation (qui, après tout, est une loi naturelle) ? Mais c'est seulement parce que cette stratégie ("defect") a émergé d'abord et a éliminé par sélection naturelle les "tit for tat". Si la stratégie coopérative "tit for tat" avait émergé avant, elle serait dominante. Et ces stratégies déterminent jusqu'à un certain point le comportement des individus. Tu seras plus ou moins coopératif selon que tu vis dans une population à dominante plus ou moins coopérative. Après je ne dis pas que ce modèle darwinien pour aller vite est le mètre-étalon du jugement de valeur (ce serait absurde) mais puisqu'on parle de juger des civilisations, ça devient intéressant de poser le problème en ces termes me semble-t-il. Si quelqu'un est un mordu d'Axelrod, il est le bienvenu ^^ Donc si je pense qu'on peut juger des civilisations (selon des principes moraux, selon le DN, selon l'efficacité de leur développement etc.) je pense pas qu'on puisse les comparer. -

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Mais ça touche un problème passionnant : celui de l'évolution culturelle. Peut-on dire : "si l'URSS avait duré 150 000 ans, cela veut-il dire que ç'aurait été un bon régime ?" Toutes les critiques de Hayek et de l'évolution culturelle se ramènent peu ou prou à ça (en particulier du côté praxéologiste, avec des choses variées à la place de "URSS" (qu'on peut remplacer par n'importe quelle tradition/coutume pas cool en prenant un air goguenard)). Si on accepte l'idée de concurrence des civilisations, je dirais qu'on peut tranquillement suspendre son jugement sur la supériorité de telle civilisation sur une autre. Cela vaut vraiment la peine de lire Hayek attentivement sur le sujet : Hayek explique que l'évolution culturelle sélectionne les règles comportementales les plus "bénéfiques", càd : qui respectent le critère d'utilité (chance pour un individu random d'accomplir son plan individuel, critère minimisé par les régimes socialistes, cf. la Route) et qui maximisent le nombre d'hommes qu'elle peut faire vivre. JP Dupuy, dans son article à ce sujet dans l'Histoire du libéralisme en Europe de Nemo & Petitot (l'article en question s'intitule "Friedrich Hayek ou la morale de l'économie, p. 1151 sq.) critique la thèse de Hayek d'un point de vue qui me paraît peu pertinent mais intéressant pour notre thread : si ce que Hayek nous chante est vrai, l'émergence des institutions résulte d'un processus d'imitation à large échelle (que Dupuy a tort de lire avec des lunettes keynésiennes) qui ressemble à un évolutionnisme dans lequel les caractères acquis sont héréditaires. Dupuy pense ici trouver un point faible dans Hayek : si tout repose sur l'imitation, rien ne nous dit qu'on va vers un mieux (on va peut-être vers un pire) : "si la chance favorise une certaine technique au départ, celle-ci bénéficie d'un "avantage sélectif" qu'elle va entretenir et amplifier à mesure que les usagers affluent" (p. 1180) ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure : on en a peut-être laissé passer une. Question : l'évolution culturelle est-elle optimisatrice ? Empiriquement, et Hayek le souligne, les seules religions qui ont survécu sont celles qui soutiennent la propriété et la famille. Si le critère est la survie comme le dit @Rincevent, alors l'évolution culturelle a une parenté avec l'évolution biologique, une parenté formelle qui est celle des processus auto-organisateurs : l'adaptation est la marque d'une meilleure appréhension de l'environnement et elle est un processus cognitif essentiel, car toute adaptation correspond à un supplément de connaissance, qui augmente donc spontanément le capital ou le package de la civilisation. Il y a rétroaction positive entre l'augmentation de capital et l'augmentation de savoir (je reprends une formulation que je trouve excellente de Konrad Lorenz dans L'Homme dans le fleuve du vivant). Je pense donc qu'un type comme Monod formule très bien le problème en parlant de processus téléonomique (une sorte de jeu où rien n'est fixe sauf les règles donne l'impression d'être designed alors que non, d'où l'intérêt des jeux évolutionnistes). Il ne faut pas confondre degré d'adaptation d'un organisme/d'une civilisation avec son degré d'évolution. On peut être tout à fait adapté sans être très évolué. Je me risquerais, au risque de me faire taper sur les doigts, à faire une analogie entre le challenge de l'adaptation au milieu et la conception de Toynbee des civilisation, par challenges/responses. Les fossiles vivants n'ont pas de challenge, donc ils n'ont pas de response à fournir et leur "capital" cognitif n'évolue pas, ni, en gros, leur morphologie. Cela nous évite de hiérarchiser les civilisations, ce qui poserait trop de problèmes (comparer des époques différentes, une masse considérable de critères etc.). D'un point de vue hayékien, pour clore l'affaire, je ne pense pas que l'évolution culturelle soit optimisatrice. De même que la concurrence n'est pas optimisatrice : elle est génératrice de découvertes et d'enrichissement du "capital" cognitif ("competition as a discovery procedure"). On ne peut donc pas dire si la compétition ou la concurrence est bénéfique ou optimisatrice car seule la concurrence nous l'apprendra. Idem pour l'évolution culturelle. Bon je laisse la plume à ce cher Friedrich parce que j'aurais pas fait mieux : Et le Wikibéral rejoint cette perspective en distinguant l'optimalité de l'efficacité (déterminée en adéquation avec les critères de population et d'utilité présidant à la concurrence des règles comportementales) : Ce maintien de la possibilité d'expérimenter et d'accroître ce que Lorenz appelle le capital cognitif correspond au maintien de la compétition, càd la règle même de l'évolution. En ce sens, le socialisme est une régression civilisationnelle. -
ça me fait penser à ce cher Peterson : https://www.youtube.com/watch?v=OHLSv-tdR7w#t=2m00s Sinon pas lu L'Evolution créatrice, j'ai seulement parcouru et j'ai vu qu'il disait du mal de Spencer ce qui m'a donné un prétexte pour fermer le bouquin de façon sectaire et bête ("si c'est pas libéral, je lis pas"). Mais j'ai lu le très malthusien Les Deux Sources de la morale et de la religion, inégal, avec une division "société statique"/"société dynamique" franchement pas utile, des passages toupourris sur le bouddhisme et les religions orientales (il faut voir comment Guénon se marre en lisant ça), sans parler des développements sur l'élan, qui n'est pas une impulsion et qui progresse par sauts sans pour autant être aléatoire (dafuq) ; si je me souviens bien il prend l'exemple d'une main qui plonge dans la limaille de fer et réorganise tout n'importe comment. Et puis il a aussi cette idée de la croissance en gerbe propre à la tendance vitale : tu as l'émergence de deux tendances façonnées par le temps, et le progrès consiste en ceci que les hommes se lancent à fond d'un côté ou de l'autre (il appelle ça la "double frénésie"). Ce qui nous avance bien. Après il y a aussi des passages pas mal dedans, sur le machinisme à la toute fin du bouquin, quand il explique que l'outil est un organe artificiel, que la mécanique continue le corps humain (on croirait presque lire du Gehlen ; apparemment je suis pas le seul à faire le lien...). Dans l'ensemble j'avais préféré La Pensée et le mouvant, où certains textes sont vraiment stimulants ("Le Possible et le réel") et surtout où il arrête de causer biologie. L'Energie spirituelle est le plus caricatural que j'aie lu (une conférence où il explique que la télékinésie c'est très intéressant...) mais le chapitre sur la "fausse reconnaissance" aide beaucoup à comprendre Proust, donc...
-
Ah ok. Bah c'est pas ce qu'on m'a dit en cours mais mon prof n'est pas évangéliste non plus ^^ Cela dit J'aime bien l'anecdote sur "bergsonien attardé" Et Worms n'est pas une lumière mais je crois qu'effectivement il a beaucoup joué dans cette opération de relecture de Bergson (lui et Camille Riquier, qui a dirigé le volume collectif consacré à Bergson aux éditions du Cerf). Il a édité Durée et simultanéité (le livre de Bergson sur Einstein, jamais lu j'y comprends rien).
-
whah trop bien merci (je ne connaissais pas du tout) ! Traduit par Henri Thomas Oui c'était à la mode à l'époque quand même. Bergson était considéré soit comme un irrationaliste spiritualiste un peu barré et peu rigoureux, soit carrément comme un fasciste. Les choses ont un peu changé depuis (il y a eu Deleuze ^^). Et au sujet de l'évolution, Bergson est resté un lamarckien obtus !
-
Quelle est cette merveille (j'adore Jünger) ??? Rivarol et autres essais ? Fucking masterpiece. Celui-là, En rade et En route sont des romans à tomber à la renverse. Je te conseille vivement. Surtout si, comme j'ai cru le comprendre, tu n'aimes pas Houellebecq
-
Je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu dis sur ceux que Heidegger appelait les "cracheurs d'aphorismes" et sur Cioran, je serai de l'avis de George Steiner, qui est aussi un peu le tien. Mais Caraco est un niveau au-dessus de Cioran : d'abord il écrit mieux et ensuite il a une certaine vigueur stylistique qui manque à Cioran, qui évoque le déclin de la civilisation occidentale du même ton qu'un mec qui se plaint de l'inconvénient de laver ses chaussettes. Et il y a des livres de Caraco qui n'ont pas grand-chose à voir avec du Cioran : je pense à son livre sur sa mère, Post-Mortem qui est assez loin de l'aphorisme : c'est une succession de portraits ou de souvenirs sans lien entre eux rattachés à sa mère et à son deuil. Mais je suis d'accord que ce n'est pas "nourrissant pour la réflexion" (cela dit, Huysmans non plus, mais c'est pas pour ça que je le lis). Il reconnaît à Cioran le mérite d'un bon essai sur Maistre (effectivement plutôt bon). Mais les livres de Caraco ne sont pas des "jérémiades". Certains sont faciles (le Bréviaire du chaos) mais le ton est différent, me semble-t-il, de celui de Cioran.
-
Je vois que je ne suis pas le seul aficionado de Caraco Tu as lu Le Galant homme ?
-
Oui, c'est pour ça que j'aurais aimé que l'auteur de l'article et Wilson précisent quel est le "gene associated with homosexuality" dont ils parlent. On est d'accord là-dessus. Tom of Finland ? Connais pas. En revanche je vais voir si j'arrive à capter Gaddam et Ogas Merci pour la réponse.
-
I see. Merci beaucoup pour ta réponse mais dans ton premier message tu écrivais que et ta réponse explique en effet pour l'éphébophilie hétérosexuelle. Mais l'homosexualité et plus précisément l'homosexualité éphébophile, si elle n'entrave pas le processus évolutif (puisque les homosexuels ont des enfants quand ils se marient avec une femme, genre Gide ou Wilde), est plus difficile à expliquer en termes évolutifs, et donc le comportement d'un éphébophile homosexuel (ce qui est plus proche du sujet du thread). J'ai lu dans Wilson une justification par la kin selection (1) (l'homosexuel en question participe à l'éducation des enfants, ce qui est tout à fait cohérent dans une société orientée K) mais j'avais pas été emballé et puis j'ai découvert que de nombreux tests/expériences allaient à l'encontre de cette hypothèse. L'article que j'ai mis là propose une solution que je ne connaissais pas (j'ai surfé en attendant ta réponse) et qui est intrigante et que je te soumets parce qu'en sociobiologie ou en psychologie évolutionniste, je suis juste autodidacte (grâce à Dawkins, Wilson, Hamilton et alii) : Ici, l'hypothèse est séduisante (c'est le cas de le dire) mais l'auteur ne spécifie pas ce qu'il entend par "genes associated with homosexuality". J'ai l'impression que ça regroupe l'ensemble des traits qui correspondent à la féminité. Mais il n'est pas du tout sûr que la féminité, l'allure féminine, garantisse le succès auprès des femelles. Contre-exemple chez les macaques. Si ce truc ne marche pas donc, la dernière hypothèse pourrait être que ce genre de comportement (l'éphébophilie homosexuelle) permet de relâcher la compétition des mâles pour la conquête des femelles en faisant apparaître d'autres ressources sexuelles que les femmes (les hommes, puis les hommes plus jeunes) pour assouvir le désir des hommes, et ces nouvelles ressources seraient des hommes féminins (hétéros ou homos) qui attireraient la préférence des femelles, ce qui sécurise le futur de l'espèce et réduit la compétition puisque les compétiteurs pourraient devenir partenaires sexuels (émergence, si l'on veut, de l'homosexualité). Là, je te renvoie au livre de Prum et à sa review dans Forbes (1). (1) C'est aussi l'hypothèse de Richard O. Prum Je fais comme toi un TLDR ^^ : 1) On a éclairci l'éphébophilie avec les jeunes filles (-> reproduction) mais pas avec les jeunes garçons. Plusieurs hypothèses en débat : 2) La kin selection et l'hypothèse de Wilson, c'est-à-dire que les homosexuels contribuent à l'éducation des enfants, améliorant donc la postérité génétique. 3) L'idée selon laquelle les homosexuels possèdent des gènes de l'homosexualité qui les rendent plus féminins et donc plus attractifs auprès des femmes ce qui maximise leurs chances de réussite dans la compétition sexuelle. 4) Reste une possibilité intermédiaire : les hommes féminins mais non nécessairement homos, ie : en-çà du tipping point mentionné par les auteurs de l'article du Psychology Today (ce qui nous évite la contradiction de l'hypothèse 3 selon laquelle les homos feront des enfants avec des femmes attirées par leur féminité génétique...) attirent les femmes et les hommes.
-
Question candide : pourquoi l'éphébophilie est-elle attendue dans une espèce à stratégie K ? Parce que les espèces à stratégie K ont peu d'enfants et que les frustrés se reportent sur les éphèbes ? Et quel but reproductif sert-elle ?
-
+1 Et les scandales pédophiles touchent aussi les protestants, dont les pasteurs ne sont pas contraints au célibat : https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/13/au-etats-unis-la-principale-eglise-protestante-rattrapee-par-le-scandale-des-abus-sexuels_5422680_3210.html Et il y a un autre bon article du Monde sur la question (réservé aux abonnés) : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/28/pretres-pedophiles-le-celibat-aux-racines-du-mal_5361297_3232.html Le début est déjà intéressant et est en accès libre.
-

Droit Naturel et Politique
Vilfredo a répondu à un sujet de POE dans Philosophie, éthique et histoire
C'est de l'histoire contrefactuelle. C'est très chouette (et particulièrement liberhalal). J'ai dû mal me faire comprendre : selon les critères d'évaluation retenus (l'architecture que tu évoques après par exemple), on aura une comparaison qui favorisera telle civilisation sur telle autre parce qu'elle est supérieure au regard des critères retenus. Mais on pourrait en choisir d'autres pour montrer l'inverse. La philosophie grecque > philosophie romaine, mais l'armée romaine > l'armée grecque mais la religion grecque > à la religion romaine (pleine de cultes étrangers interprétés, soi-disant moi pure), etc. Donc la somme n'aura aucune valeur objective. Là tu ajoutes un critère subjectif (moi je préférerais la Rome impériale du IIe siècle, belle époque conquérante et prospère même si Trajan ruine les caisses de l'Etat, mais bon, ça n'engage que moi) dans une analyse à visée objective. Pourquoi pas le voile d'ignorance de Rawls aussi ^^ Ce critère utilitariste est un parfait exemple de subjectivisme : pourquoi ne pas considérer plutôt que les sociétés qui produisent des pyramides qui sont parvenues jusqu'à nous des dizaines de siècles plus tard et qui demandent des prouesses techniques absolument ahurissantes (je rappelle que les Egyptiens n'avaient pas la roue) ne sont pas supérieures, ne serait-ce qu'au regard de leur avancée technologique dont les pyramides témoignent ? Et pourquoi ne pas juger les sociétés en fonction de leurs réalisations artistiques (la poésie grecque de Pindare contre l'art poétique d'Horace), par définition inutiles matériellement ? (Et je croyais que l'utilité commune était une illusion constructiviste… ) -
Mais merci pour cet article très instructif.
-

Droit Naturel et Politique
Vilfredo a répondu à un sujet de POE dans Philosophie, éthique et histoire
En effet, et à ce sujet, quelqu'un a-t-il lu Le Secret du droit naturel ou Après Villey de Pierre-Yves Quiviger (Classiques Garnier, 2012) ? Je ne l'ai pas lu mais l'auteur se présente comme un fidèle de Villey. Je vois ce que tu veux dire et je crois savoir d'où ça vient mais comment calcule-t-on ces sommes ? Le choix des facteurs lui-même est un parti-pris. Selon ton modus operandi, la civilisation ou la société romaine est-elle supérieure ou inférieure à la société grecque ? Pour répondre à cette question en plus, il faut faire une somme pondérée des facteurs entrant en ligne de compte parce qu'on va comparer des civilisations particulièrement durables (on pourrait même faire des comparaisons au sein de l'histoire de chaque société, entre la Rome royale, républicaine, impériale et au sein du principat, l'époque augustéenne, le IIIe siècle, l'ère constantinienne et j'en passe) et donc d'autant moins homogènes. Je suis perplexe. Et les réalisations matérielles on compare les thermes de Caracalla au Parthénon ? Même problème.