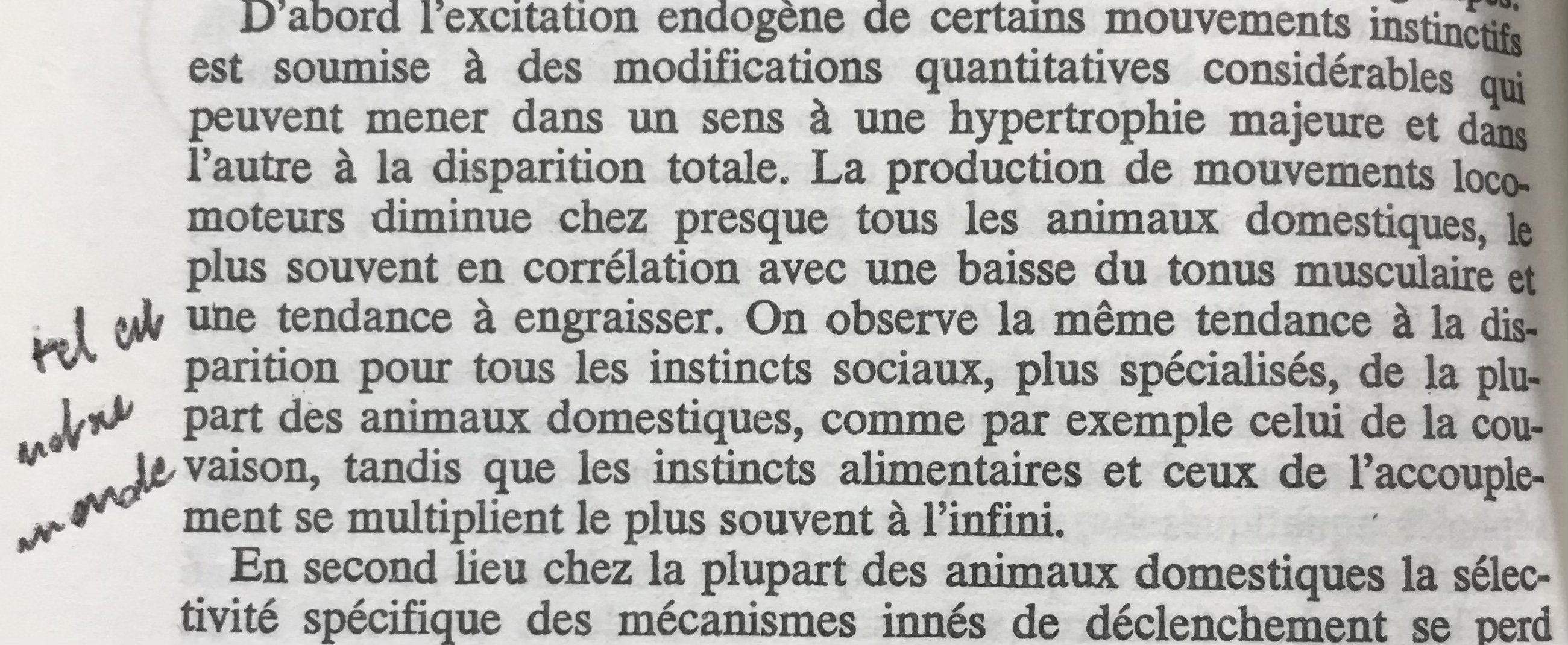-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
Non, seulement que le meurtre n'est pas légitime dans cette situation. Tous les autres coups sont permis. On pourrait dire qu'il est préférable d'avoir une situation où une vie sans viol est préservée au prix d'une vie de violeur prise à une situation avec une vie marquée par un viol et un violeur satisfait, même en prison. C'est un argument que je peux soutenir en effet. Du reste, même s'il y avait un procès pour une femme qui a tué quelqu'un qui tentait de la violer, je doute qu'on trouve un jury pour l'emprisonner. Il faut pouvoir établir que l'intention poursuivie par le meurtre n'était pas de tuer mais d'empêcher le viol. On pourrait dire que oui, parce qu'asservi on perd (au moins une partie de) notre capacité de se défendre. On ne peut pas être sûr qu'il ne nous tuera pas quand on lui aura donné ce qu'il veut. Oui c'est vrai mais comme on parait de tuer pour un iPhone, je trouve quand même ça trop libéral. Je te tue si tu casses mon collier de nouilles. Les maternelles en pelerindumontie ça va déménager. Leur nunucherie n'est pas un argument éthique. Réponse B
-
Il peut être légitime de tuer son tortionnaire pour lui échapper, mais il ne peut pas être légitime de le faire avant si c'est dans l'optique d'éviter la souffrance, parce que ce n'est pas un motif moral. Ce qui est un motif moral, c'est la préservation de sa vie, ce qui est différent. Il y a un passage dans le léviathan où Hobbes explique que si quelqu'un vient m'agresser, je ne peux pas savoir à l'avance si je vais en sortir vivant, donc je peux faire tout ce qui est en mon pouvoir (y compris le tuer) pour m'assurer de rester vivant. Evidemment, ça s'applique encore plus face à un tortionnaire. Certes, dans le cas du tortionnaire, que je le tue pour éviter de souffrir ou que je le tue pour survivre, la différence des critères ne change rien. Mais du coup, ça change dans le cas du SDF (sauf s'il fait 0° et que sa vie dépend de cette couverture, parce qu'alors on retombe dans un scénario du type hobbesien). Le problème du utility monster se repose sinon à l'envers, sous la forme de: à partir de quel niveau de souffrance peut-on tuer? et comme la souffrance est pas objectivable etc. problème. Le problème du critère d'évitement de la souffrance, c'est qu'il légitime trop de trucs (trop libéral). C'est pourquoi je préfère le truc de hobbes.
-
Je crois qu'on se pose une question de légitimité donc c'est la même question pour le coup
-
Interesting. Je suppose que oui. En tout cas ça me paraît plus justifié que pour tous les autres exemples. La perte pour l'humanité serait trop grande. Mais c'est très discutable, parce que c'est un trait tout à fait occidental de vénérer les "originaux", d'admirer les ruines etc. Dans Le Culte moderne des monuments, Riegl parle des temples japonais qui sont reconstruits régulièrement, alors qu'on visite toujours l'Acropole. Il existe des reproductions magnifiques. Certains artistes font des sculptures dans le seul but de les photographier (et exposer seulement les photos). Donc je dirais quand même non, car il n'y a pas de "reproductions" d'un être humain.
-
J'ai l'idée sans doute un peu neuneu que les choses sont remplaçables et pas les gens. Il y a des assurances pour les objets précieux et il y a des moyens de sauvegarder son travail de thèse. Ça pose le même problème que les comparaisons interpersonnelles d'utilité et l'éthique de Singer. https://en.wikipedia.org/wiki/Utility_monster Imagine a "pain monster"
-
"Mais s'il a violé ton chien et qu'il a volé ta femme et qu'il a marché sur ton gosse parce qu'il n'a plus que quelques minutes à vivre et qu'en criant le gosse a déclenché un mécanisme d'autodestruction de ta maison qui marche par reconnaissance vocale et que tu es myope et qu'il a aussi volé tes lunettes dans lesquelles il y a des microfilms avec le code génétique d'un virus qui fait muter les rats et qui va tuer toute l'humanité et que tu tires et que tu rates la jambe et que tu le tues?" Si la conclusion du raisonnement c'est qu'on peut buter les voleurs d'iPhones, c'est qu'il y a un problème quelque part.
-
Comme quoi quand on définit tout on se comprend mieux.
-

Psychologie évolutionniste : Vraie science ou propagande "de droite" ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Nigel dans Science et technologie
WELL! that bloody depends on what you mean by... non ok j'arrête. -

Psychologie évolutionniste : Vraie science ou propagande "de droite" ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Nigel dans Science et technologie
Je ne suis pas sûr. Si on interprète le chuchotage fort comme de la pensée extravertie (Te), c'est une caractéristique des INTJs, qui ne sont pas très actifs dans la cohésion sociale (en dehors de leur cercle de 3 amis + famille proche). Ça serait rigolo que je lui demande de chuchoter en chuchotant. Il ne comprendrait pas et je me retrouverais à lui hurler à la figure "chuchote bordel!" -
-

Images fun et leurs interminables commentaires
Vilfredo a répondu à un sujet de Librekom dans La Taverne
-

Éric Zemmour, chroniqueur puis politicien
Vilfredo a répondu à un sujet de L'affreux dans Politique, droit et questions de société
Il voit la France à moitié pleine -

Psychologie évolutionniste : Vraie science ou propagande "de droite" ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Nigel dans Science et technologie
Ça fait depuis une heure que j'entends une brochette de perruches glousser dans le couloir. Il est trois heures du matin. Je m'en fous partiellement parce que je ne dors pas mais mes bonnes dispositions évolutives à l'égard des voix de femmes ont très vite atteint leurs limites. Ce qui m'intrigue davantage (par association d'idées), c'est comment il semble se faire que certaines personnes soient juste incapables de chuchoter. Pas que ce soit le cas des nanas du couloir du tout. En fait, si ça peut vous faire quelque chose, je pense, et je suis très sérieux, à un Allemand. Mais après avoir passé les 15 minutes les plus utiles de ma vie à fouiller google scholar à la recherche d'un whisper handicap ou d'une inability to whisper sans aucun résultat, je pense qu'il est juste un peu socialement retardé (l'Allemand). Et comme dirait Hugues, je sais de quoi je parle. -
Avoir eu cette chanson dans la tête toute la journée m'a rendu nerveux. Mais j'aime beaucoup Three Days Grace donc ce n'était pas désagréable.
-

Éric Zemmour, chroniqueur puis politicien
Vilfredo a répondu à un sujet de L'affreux dans Politique, droit et questions de société
C'est un débat pour savoir si Zemmour est raciste? C'est un sujet passionnant que j'ai beaucoup étudié. La réponse est oui. De rien. -

Mélenchon, le Tout Petit Père des Peuples
Vilfredo a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Politique, droit et questions de société
Il faut rétablir les poor laws aussi. Ah et vous avez entendu Quatennens? La "nouvelle garde" pourrait être mobilisée en cas de force majeure. "Crise écologique" par exemple! -
Je fais deux lectures très lancelotiennes en ce moment: Second Philosophy de Maddy, qui explique comment on peut résoudre empiriquement les questions transcendentales, et Freud Biologist of the Mind de Frank J Sulloway qui présente une interprétation empirique biologique de la théorie freudienne; une sorte de biographie intellectuelle. C’est un peu ancien bien sûr mais c’est un bel ouvrage. I’ll be back
-
J’entends un groupe de jeunes dire pendant une discussion “oui je sais: toujours tout remettre en question, tout remettre en question…” et je me dis que, meme si dans un sens superficiel, Hayek a vu plutôt juste sur les désastres du cartésianisme politique. Le nouveau doute radical: suis-je sur que cet homme est un homme. Maintenant on en est à “fuck la domination, fuck les bourgeois (plus fort) en même temps!”
-
Tiens justement il y a Fukuyama et Gray qui parlent ensemble de la Russie ici. J'ai trouvé ça barbant mais du coup c'est peut-être intéressant quand même. Pas pu trouver la vidéo complète. Peut-être dans les prochains jours puisque c'était hier.
-
Merci bon je peux aller me taper la cloche alors parce que j'aimerais bien prendre un peu de poids. Mais j'ai découvert que j'étais ectomorphe grâce à vous donc j'imagine que c'est peine perdue.
-
Vu l'heure je travaille encore une heure et je vais dîner, donc je suis curieux de savoir pourquoi
-
Tiens. Les dix premières minutes muettes, l’accent de DDL, “I drink your milkshake”, le son coupé quand le gosse est assourdi, le meurtre à la fin avec le bowling… ce film m’a quasiment donné des maux d’estomac de malaise intense. Tout tient certes beaucoup à DDL, mais c’est mon tour préféré de PTA (Boogie Nights juste après).
-
Oui le maquereau au potiron a un effet contraceptif
-
-

Présidentielles 2022
Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société
(♪Jingle♫) Macron l'a déjà fait