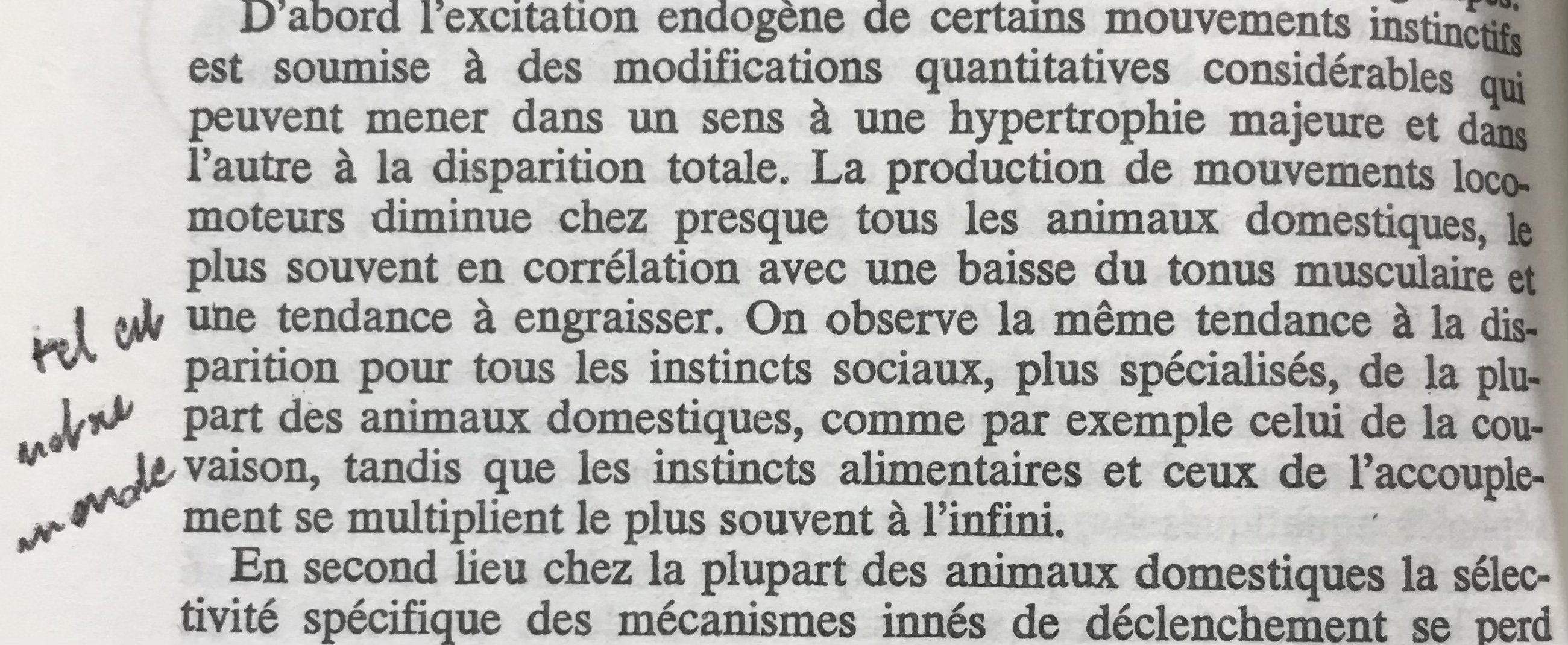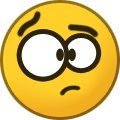-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-
Ah d'accord, je regarderai le 3 alors
-

Les articles que vous voulez faire buzzer
Vilfredo a répondu à un sujet de Nick de Cusa dans Action !
Il y a aussi celui-ci sur Quillette qui complète bien -

Les articles que vous voulez faire buzzer
Vilfredo a répondu à un sujet de Nick de Cusa dans Action !
La théorie du complot qu'est le racisme systémique: un excellent article dans Spiked! ‘Systemic racism’ is a conspiracy theory Morceaux choisis/meilleurs arguments: -
c'est marrant ces débats vrounzais où le journaliste débat s'engueule avec ses propres invités
-
Ça serait une question qu’elle serait bonne à poser comme question
-

Le droit de propriété à la francaise
Vilfredo a répondu à un sujet de Rusty dans Politique, droit et questions de société
le moins qu'on puize dire, z'est que tu ne vas pas attendre que ça se taze -
Le prochain (et dernier) film de Kitano devrait être un film de samouraïs avec Ken Watanabe. J'avais vu Outrages et j'avais trouvé ça bof. Ça ressemblait à un manga, et en ça c'était réussi, mais j'avais pas accroché. C'était très violent, très bien filmé, très bien joué, mais complètement vain (contrairement à Brothers, par exemple, qui explosait de style). Je ne sais même plus si j'avais vu Outrages 2: si c'est dans celui-là qu'un mec se fait tuer en se faisant envoyer un nombre incalculable de balles de tennis dans la gueule très très fort pendant longtemps, alors oui. Comme Zatoichi était plutôt très bon, j'en attends beaucoup
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'Empire_éclaté la question nationale en urss, du sultan galiev à la dissolution et aux pogroms d'arméniens en passant par les déportations des caucasiens, c'est un gros sujet quand même -
Je relance d'un article du Daily Mail
-
J'ai commandé il y a 10 jours Beyond Politics de Randy T. Simmons mais il n'est toujours pas expédié sur Amazon. J'ai déjà connu des délais d'acheminement, surtout de l'étranger bien sûr, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un long délai d'expédition (ça m'était arrivé il y a quelques mois et le colis avait finalement pas été expédié tout simlement), et ça me les brise parce que je voulais le lire pendant les vacances. C'est normal, ça vous arrive aussi en ce moment? Il y a un moyen de savoir où qu'il est le problème? (Commandé le Murray en revanche, il arrive.) Sinon j'ai lu/suis en train de lire pas mal de bouquins libéraux ou related (Sandel, Jasay, Buchanan, Jaume, Kinsella, Thaler, ...) je compte faire un petit compte-rendu quand j'aurai fini tout ça.
-

Jordan B. Peterson
Vilfredo a répondu à un sujet de Eltourist dans Politique, droit et questions de société
on en parle ici aussi: Crucifying Jordan Peterson The Times of London does a hit job. -

École & éducation : Le temps des secrets
Vilfredo a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
ça dépend de leur type mbti -

École & éducation : Le temps des secrets
Vilfredo a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Sous prétexte que ce sont des enfants on doit les faire écrire un français de crétins, ce qui n'est pas la même chose qu'un français simple, de même que les parents parlent à leurs enfants comme à des semi-déficients. Pathetic. -

École & éducation : Le temps des secrets
Vilfredo a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Oui c'est vrai que la barre d'entrée sur Twitter est cognitivement assez haute, je suis scandalisé par ce laissez-aller. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Deux éditorialistes au Figaro qui circlejerkent. Le débit de Charles Gave me rappelle une vanne de La Classe américaine ("respirez bien"). Celui de MBC c'est un autre niveau, c'est un peu comme si Ben Shapiro parlait allemand. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
non mais "slur", c'est le mot anglais pour dire "insulte". ça n'est pas une insulte -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
@Zagor exactement -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Il dit qu'en 2019, quelqu'un au Pérou lui a demandé ce qu'il pensait du fait qu'une meuf ait été virée pour avoir dit un gros mot raciste quand elle avait 12 ans. Le mec a répondu en demandant: "ah, et elle a dit <gros mot raciste> à qui/dans quel contexte?" Mais c'était trop tard: il avait déjà dit <gros mot raciste>. Le fait que ça soit dans un contexte où <gros mot raciste> ait été employé à titre métalinguistique ne change rien. C'est insultant. Le fait qu'il ait pu même penser que le contexte ait pu faire penser à certaines personnes que ce n'était peut-être pas insultant est plus scandaleux que la Shoah. Du coup, il s'excuse auprès de la Terre entière pour avoir dit <le gros mot raciste>. edit: il aurait dû écrire <le gros mot raciste> dans sa lettre puis mettre: "oops I did it again" et envoyer une autre lettre d'excuses débile où il aurait employé encore le gros mot raciste etc. etc. juste pour faire rièche le Times. Moi j'aurais fait ça. -

François Asselineau, le candidat de l'UPR
Vilfredo a répondu à un sujet de Nonaud dans Politique, droit et questions de société
Mais non -

François Asselineau, le candidat de l'UPR
Vilfredo a répondu à un sujet de Nonaud dans Politique, droit et questions de société
Bah Jean-Marie le pen quand même (vous avez une image déplaisante en tête? Ne me remerciez pas) -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
D’accord merci je jetterai un œil mais Strauss va déjà bien m’occuper -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
waaah merci -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
et ça vaut mon excitation? (des cours de Strauss, j'ai lu seulement celui sur le Banquet, et ça valait vraiment la peine) -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Vilfredo a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Omg les enfants je viens de tomber sur les cours de Leo Strauss en audio et en écrit donnés à St. John’s College en 1971/72 sur Par-delà bien et mal de Nietzsche! @F. mas @Lancelot @Mégille vous connaissiez?