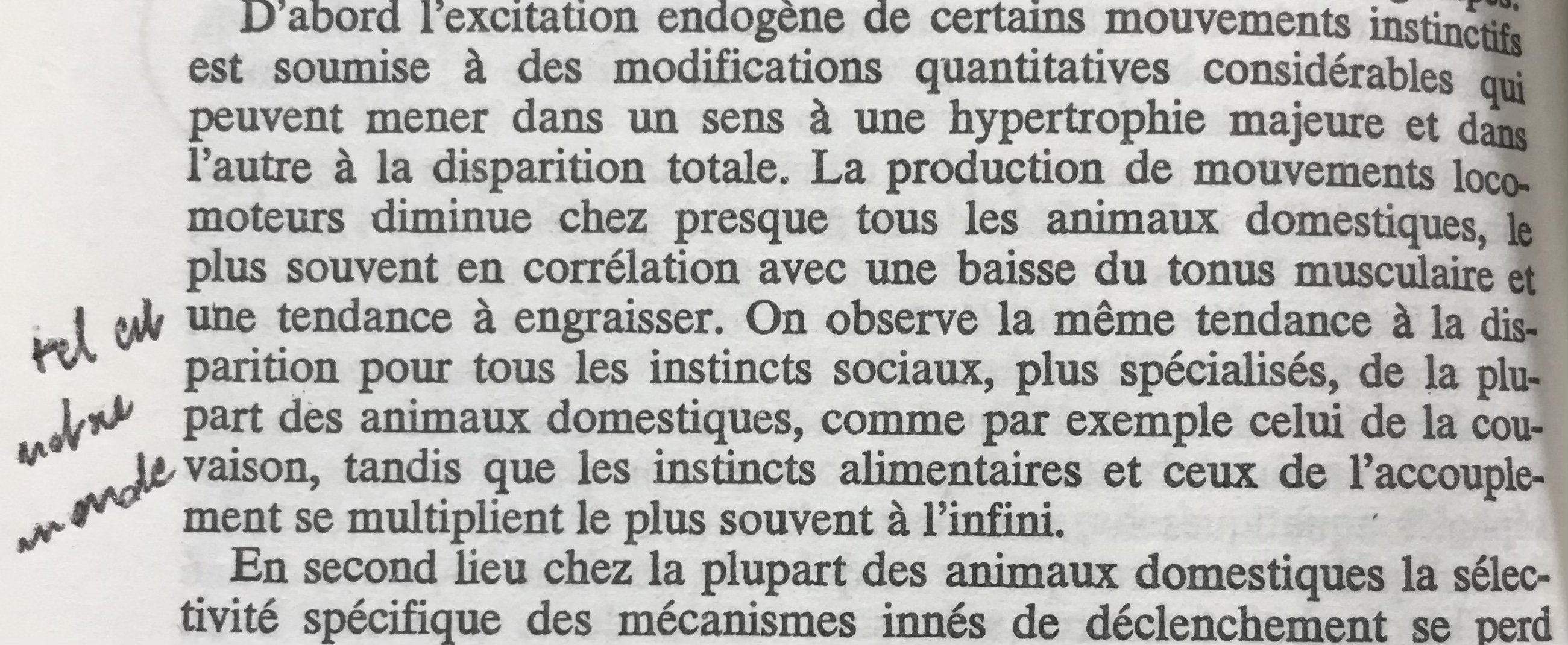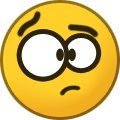-
Compteur de contenus
6 931 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Vilfredo
-

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Je suis désolé mais je ne peux répondre qu'en déplaçant légèrement l'enjeu du débat. J'ai toujours du mal avec cette notion de propriété relationnelle. Je dis ça parce que tu commences par cette distinction (relationnel vs intrinsèque). J'aime l'idée de Bradley selon laquelle toutes les propriétés sont relationnelles. Le fait, pour moi, d'avoir quelque chose, est bien une relation entre moi et cette chose (parfois, on dit même qu'on "a une relation" comme si la relation devenait l'objet lui-même: c'est du pur Bradley). Ce que l'évolution change, c'est que les propriétés/espèces qu'elles définissent ne sont plus fixes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas définir des espèces, de même qu'on pourrait dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'essences (de re) qu'on ne peut pas définir, pour les besoins de la conversation ou de la recherche, des propriétés essentielles (au sens de qui est accepté comme faisant partie de la définition de la chose, donc de dicto). Autrement dit, le fait qu'un terme n'ait pas une intension ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui en donner une, qu'elle ait ou non un corrélat non-linguistique (un universel ou une propriété catégorique). C'est aussi ainsi d'ailleurs que je répondrais au nihilisme edgy de nothing has meaning et au petersonisme religieux (i.e. la question n'est pas de savoir si les choses ont une signification, un sens, ou pas, parce que la signification n'est pas ce genre de choses que les choses ont ou pas.) C'est ma lecture de Quine. Ensuite, sur la question plus précise des espèces en biologie, un point de vue réaliste sur les changements scientifiques argumenterait que ce n'est pas parce qu'un concept n'est pas exactement correct qu'il est une fiction, et même un concept qui n'est exactement correct de rien ne cesse pas pour autant de dénoter quelque chose. Un exemple simple de Putnam de pourquoi ça ne marche pas de penser le contraire: comme rien dans la théorie de l'atome de Bohr en 1911 ne faisait référence, on ne peut pas dire que les élaborations suivantes sont des progrès. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Je ne vois que la description et ça laisse beaucoup à l'imagination Ah oui? Tu penses que l'eau de la Terre jumelle est de l'eau? -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Cet argument m'énerve tellement que j'ai envie d'aller full hégélien dans l'autre sens: oui, c'est précisément parce que et dans la mesure où le progrès scientifique est déterminé socialement qu'il est parfaitement objectif! On ressaisit la vérité à partir d'un point de vue. Ou alors: la connaissance objective est la connaissance de l'objet, et l'objet est le produit de sa construction à partir du donné, et en le connaissant, l'homme ne fait que coïncider avec lui-même, en tant qu'il est le créateur de cet objet. Un objet n'est pas une chose! Un objet n'existe que dans sa relation à moi, dans laquelle il m'est donné! -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Oui non en fait ce n'est pas ce que je cherchais parce que je cherchais quand même un truc sérieux. En lisant la section "Objective reality" je me rends compte que cette personne n'a jamais lu un livre de Kant et que ça la rend complètement ridicule pour parler de quoi que ce soit sur ce sujet, l'argument étant: si c'est construit socialement ce n'est pas objectif. Des siècles de philosophie transcendantale pour en arriver là. Mamma mia. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Par exemple ceci est à peu près le genre de trucs que je cherchais http://web.mit.edu/~shaslang/www/papers/HaslangerOSC.pdf Pas le temps de lire ça maintenant, mais ça a l'air de redécouvrir l'eau chaude très haut dans les airs. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Le marxisme en philosophie c'est quand même une critique des qualités en métaphysique (l'analyse de la marchandise) et de la dialectique hégélienne (et une assez précise). Ce n'est pas vraiment whatever works. C'est peut-être pour ça que JBP dit des conneries. En revanche les gender studies ont (supposément) une culture solide en philo du langage et en philo analytique. So. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
A force de voir ce meme je me dis qu'il faudrait faire un livre sur la métaphysique ou l'ontologie des gender studies: quel est leur point de vue sur les espèces naturelles, en tant que c'est généralement admis 1) que l'homme est une espèce naturelle et 2) qu'il a donc des propriétés essentielles et superficielles, quelle est leur doctrine de l'essence, leur point de vue sur les dispositions par rapport aux propriétés catégoriques etc. Enfin ça a probablement déjà été fait sous une forme ou une autre. Et si je voulais le faire, il faudrait que je passe des mois à lire Butler ou Irigaray. Ce qui ne va pas arriver. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Les hélicoptères -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
C'est d'autant plus absurde que le manga "hypersexualise" les hommes aussi. Il n'y a rien de mal à avoir des caractéristiques sexuelles. La plupart des gens en ont. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
-

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
A moins qu'elle ait des avant-bras bossus -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
heu -
Ok donc c'est plutôt une histoire de: "c'est autour de 24 ans que les femmes sont les plus attirantes" que de: "les femmes de 24 ans environ sont quasiment toutes attirantes". Ce qui m'étonne beaucoup moins. Ça me fait penser que j'ai toujours The evolution of beauty de Prum. Très critique de Ridley.
-
Comment est-ce qu'il se fait que précisément à 24 ans quasiment toutes les femmes répondent aux critères que la littérature scientifique identifie comme trans-culturellement acceptés pour définir "mignon" et est-ce que ça veut dire "néoténique"? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui se passe avec leurs hormones autour de cet âge-là? Ou est-ce que ce chiffre renvoie seulement à des études d'opinion et pas à des traits physiques comme la symétrie faciale etc.? Et dans ce cas est-ce toujours aussi trans-culturel?
-
Comment ça?
-
Oui, et les européistes sont des clichés vivants. Que le libéralisme de l'UE soit à géométrie variable (à l'intérieur un peu, à l'extérieur pas du tout) et que l'UE dénonce la concurrence "déloyale" , je suis d'accord, mais les arguments anti-UE sont souvent du mysticisme sur le peuple, la souveraineté et l'Etat. Mein Gott, je suis tout aussi au courant que tout le monde des inconvénients de la bureaucratie, mais s'ils peuvent minimiser l'impact de la politique économique des Etats (dans un sens ou dans l'autre), vu la tête qu'elle a en Europe, je suis tout pour. Je ne suis pas contre l'UE. Je suis à la limite contre l'UE qui ne fait pas son travail (comme la CEDH pendant le covid par exemple). Ensuite l'UE comme bloc contre la Chine ou les USA, ça veut surtout dire que les entreprises européennes ont un marché immédiat de 850M de personnes et pas juste de quelques dizaines de millions. De ce point de vue l'UE est unexceptional.
-
J'adore quand on critique les points Godwin alors que dès que l'UE fait quelque chose on parle de goulags.
-
Union Européenne République Socialiste Complete indeed makes sense it
-
Clichés contre clichés
-
Tomorrow you will learn l'existence de Iron Sky
-

Quel pays choisir pour s'expatrier ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Barem dans Politique, droit et questions de société
J'aime beaucoup la formule "encourager la procréation". On dirait que Laprocréation est une petite personne peu sûre d'elle qui ne demande qu'à ce qu'on lui dise: You're gonna be all right kiddo hehe. -
-
Vraiment? C'est mon idée? J'avoue que j'ai souvent envie de rajouter quand je lis, mais je crois pas avoir dit ça. C'est tout au plus a common misconception about Freud. Mais sinon c'est un peu comme dire "j'aime bien cette idée de @Rincevent selon laquelle le produit de la masse monétaire et de la vitesse de la circulation est égal aux prix fois la quantité de biens et services". Par extension, ça s'applique assez bien à ces gens qui disent "comme le dirait saint Cyrille d'Alexandrie, le chocolat c'est bon et l'eau ça mouille".
-

Emmanuel Todd, brillant ou escroc ?
Vilfredo a répondu à un sujet de Pegase dans Philosophie, éthique et histoire
@poney a une opinion? -
Je suis en fait super surpris de voir que je travaille vraiment bien en écoutant ça.