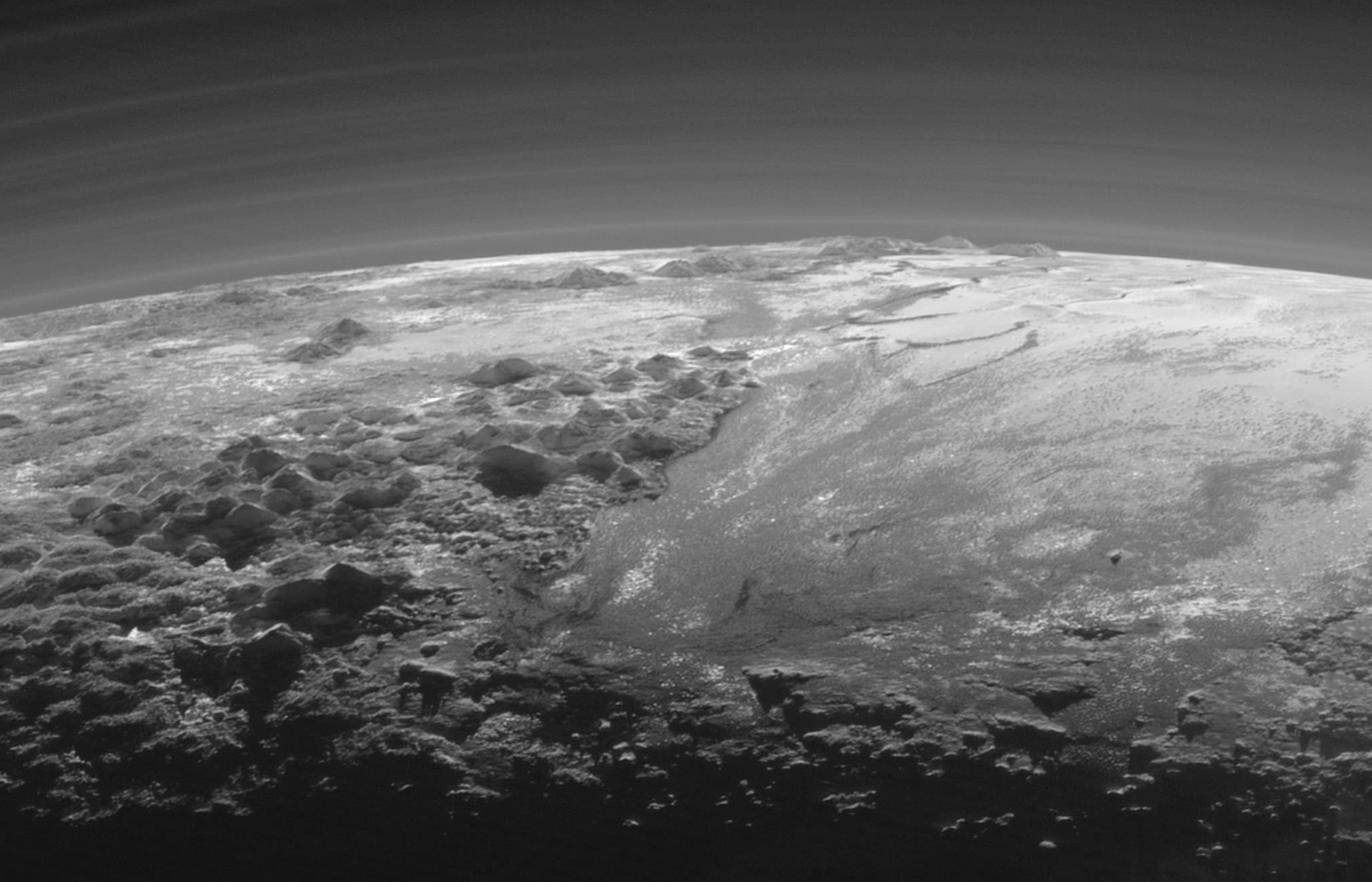-
Compteur de contenus
6 075 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
22
Tout ce qui a été posté par Anton_K
-

École & éducation : Le temps des secrets
Anton_K a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Je crois que Rincevent a raison de pointer le fait que tu confonds un peu enseignement supérieur et université. Je ne doute pas qu'une massification du supérieur soit nécessaire à la professionnalisation de la population. La question c'est pourquoi tant de jeunes se retrouvent dans des filières universitaires qui ne professionnalisent pas. A mon avis ça s'explique par la valorisation sociale de l'intellectualité académique : dans l'ednat, orienter un collégien/lycéen vers un cursus professionnalisant c'est nier la valeur de sa personne et le condamner à une vie d'exploitation, et ça s'explique aussi par la théorie du signalement ; l'efficacité des stratégies de signalement étant due au développement des métiers de bureaucrates, publics mais pas seulement, pendant une certaine phase de l'histoire économique. Personne n'a dit ça ici. Attention à ne pas confondre ce que poney dit ou ce que je dis sur ce qu'est l'université historiquement avec une thèse qui serait : "le supérieur ne doit être que l'université, et il ne serait pas bon que les filières professionalisations se développent". En ce qui me concerne je pense qu'il serait très bon qu'elles se développent, et je pense que ce qu'on voit actuellement en termes politiques et sociaux montre que ce développement est difficilement compatible avec la tradition universitaire, et qu'il faudrait donc probablement que ces institution soient séparées. D'où l'importance de notre accord pour différencier enseignement supérieur et université. Utilité sociale? C'est un critère qui a du sens si on se bat pour des financements publics peut être... Je préfère rester dans une approche subjectiviste de la valeur et te répondre que tant que ces institutions et leurs occupants trouvent un moyen honnête de se financer je ne vois pas pourquoi on discuterait de leur utilité sociale. C'est vrai. J'en suis pas sûr. Si on arrivait à revenir à une université du "luxe intellectuel", où n'iraient que ceux qui n'ont pas besoin de se professionnaliser, les autres trouvant ce qui les intéresse dans les filières professionnalisantes, je ne suis absolument pas certain que les sciences humaines deviendraient plus appliquées, et je dirais que cette université "à l'ancienne" est plus finançable que l'actuelle. Il se trouve qu'à une époque (déjà lointaine, j'avoue) j'ai fait de la "veille technologique" pour un cabinet de conseil en management RH (sur le sujet de la motivation), et j'ai donc épluché pas mal de littérature de psychologues et de sociologues appliqués. Ce que je peux te dire c'est que cette littérature était de très mauvaise qualité, tant sur le plan théorique (déjà quand on voit comment la littérature de seconde main comprend la littérature de première main on facepalm abondamment) que sur le plan de l'applicabilité. Mon impression est que la pratique effective du management RH et sa théorie psycho-sociologique sont toujours relativement indépendantes, même si les gens des deux côtés essaient de se donner de la légitimité en justifiant leur littérature par l'autre. Après, ce n'est que mon impression fondée sur une expérience limitée, donc... -

École & éducation : Le temps des secrets
Anton_K a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
C'est essentiellement ça le problème. La culture universitaire, que ce soit sur les thèmes abordés ou le rythme, est une culture qui n'est soutenable, dans sa version traditionnelle, que si l'on a certains moyens. Simplement comme tu le faisais à juste titre remarquer, la masse d'étudiants qu'on a accueilli à l'université a fait sienne et valorise cette culture étudiante, refusant la professionalisation, tout en n'en ayant pas les moyens. Alors évidemment, idéologiquement, ils peuvent bien refuser la profesionnalisation tout en ne se sentant pas obligés d'assurer leur subsistance, puisqu'ils pensent aussi que c'est à l'Etat de l'assurer... -

École & éducation : Le temps des secrets
Anton_K a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Il y a eu des transformations du système universitaire qui permettent la professionalisation (mais souvent dans des fillières bien distinctes des fillières académiques sinon ça donne les aberrations évoquées par poney). Il y a même des exceptions réussies comme Dauphine où des parcours professionalisant sérieux (bon... pour la plupart) permettent de financer une formation et des recherches universitaires sérieuses. Mais c'est loin de faire l'unanimité, et dans ce cas comme celui des IUT, ce n'est plus l'université, avec sa culture, son errance, ses chahuts. -

École & éducation : Le temps des secrets
Anton_K a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Ça n’invalide pas la thèse du signalement par ailleurs... le signalement est une stratégie d’accès à l’emploi que la plupart des gens jouent, y compris ceux qui comprennent qu’ils la jouent. Par contre une des limites de la théorie du signalement c’est qu’elle ne dit pas quelle est l’utilité ou la nécessité de la formation pour un poste ou une mission donnée. Exemple des stems : c’est clair que la plupart des gens qui font des études en stems n’en finissent pas dans la tech. Par contre pour apporter de la valeur dans un domaine tech, je suis pas sûr que tu puisses te passer de faire des études en stems. Plus la structure de l'économie permet l’existence de postes qui ne nécessitent « que » d'être consciencieux et conformiste, plus la stratégie de signalement est payante. Par contre plus les entreprises sont incitées à se replier sur le cœur technique de métier technologique (ou les activités à forte valeur ajoutée), moins elle l’est. Ça fait un peu saint simonien dit comme ça... -

École & éducation : Le temps des secrets
Anton_K a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Mon point était qu'à mon avis traditionnellement l’université n’a jamais été professionalisante (même en sciences !), et sa culture héritée (sur le plan de la discipline comme de la culture politique) n’est pas adaptée à la professionnalisation pour cette raison. Les question sont : pourquoi les jeunes s’y retrouvent-ils massivement ? Est-ce le résultat d’un choix politique ? A-t-on cru que l’université allait pouvoir professionnaliser ? Est-ce que ça a marché un temps ? Pourquoi ça ne marche plus ? -

École & éducation : Le temps des secrets
Anton_K a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
En fait ce que dit Ruffin n’est pas absurde si tu ramènes ça à la tradition universitaire. Dans un modèle où le lycée amènait à un niveau relativement plus élevé, et seulement peu de gens allaient à l’université pour y préparer essentiellement des thèses ou des licences d’enseigner, soit avec l’argent de leurs parents parce qu’ils étaient riches soit avec des bourses parce qu’ils étaient bons, ça se comprend. Mais c’est parce que la préparation à la vie professionnelle se faisait avant ou ailleurs. Les traditions d’errance et de chahut estudiantins ont tout de même une fonction difficile à définir et à justifier (vu qu’officiellement on est quand même là pour étudier), mais l’experience montre que c’était compatible avec la professionnalisation de ceux qui en avaient besoin (ils n’étaient pas à l’université), et l’étude de ceux qui pouvaient se la permettre. C’étaient traditionnellement des études qui ne nécessitaient pas l’imposition d’une discipline aussi stricte qu’au lycée car les étudiants disposaient des bases théoriques nécessaires. Aujourd’hui on a des étudiants qui ne sont pas préparés à la vie professionnelle à la sortie du lycée. On a décidé que le rôle de l’université était de les professionnaliser (ce n’est pas forcément une mauvaise idée étant donné l’orientation technoscientifique de la société). Par ailleurs, en sciences du moins, le développement des disciplines est tel que l’on n’arrive plus non plus assez près du niveau de l’état de l’art à la fin du lycée pour se lancer dans la recherche. La culture universitaire et ses chahuts ne sont pas adaptés à ce déclin du lycée et ce changement dans le besoin d’instruction. Par contre, et c’est peut-être pour ça en partie à que ces chahuts persistent : ils ne sont pas vains pour tout le monde. Pour certains ils contribuent à l’insertion professionnelle et ils constituent même une première expérience : les leaders syndicaux étudiants qui se destinent à une carrière politique, et ce, qu’ils obtiennent ou non gain de cause -ce n’est en général pas le cas. -
Un potentiel futur théoricien des modèles donc ? Tu sais que si tu es à Paris il y a des cours très bien à PVII et à probablement à l'ENS aussi sur le sujet ! Bienvenue !
-

École & éducation : Le temps des secrets
Anton_K a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
En tout cas les étudiants de Tolbiac manquent d'éducation stratégique. Alors qu'ils ont en grande partie déserté le site PMF pour aller se faire mousser dans les amphis augustes de la rue des Ecoles, plusieurs camions de CRS viennent de se garer par ici. edit : bon ben la police s'en va, elle n'a pas débloqué la fac. Il faut dire qu'énormément d'étudiants ont rappliqué de partout jusqu'à ce que les crs se retrouvent en nombre largement inférieurs. -
Go Victoria II.
-

Inflation des diplômes, échalotte et IYI
Anton_K a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Par exemple Cisco délivre des certifications qui, dans de nombreux domaines informatiques, et en particulier pour les ingénieurs réseaux, ont plus de valeur qu’un diplôme. -
Of his country ?
-
Le triomphe de la civilisation en somme.
-

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
Anton_K a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
Défilé des bloqueurs de Tolbiac en dessous de chez moi à l’instant. Vitrine du carrefour express cassée. « Paris, debout, soulève toi ». Fusée de détresse et autres slogans anticapitalistes. -

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
Anton_K a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
Oh si, si. Je crois même avoir aperçu le chien Guevara hier soir, promené en ronde sur les rochers artificiels de la cour de la fac, qui rappellent - ces jours-ci à peine plus que d’habitude - ceux qu’on trouve dans les enclos à singes des zoos. -

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
Anton_K a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
Je connais une association libérale étudiante qui a fait de ce genre d'expédition sa spécialité. -

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
Anton_K a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
J'habite rue de Tolbiac à cent mètres environ de la fac et bien que je passe au moins trois fois par semaine devant je n'avais pas fait attention au blocage avant hier soir. J'ai loulzé face à une affiche géante annonçant une conférence jointe Friot-Lordon. A mon avis le truc va vite se transformer en trou insalubre puisqu'il semble déjà abriter force punks et clochards, ce qui peut d'ailleurs causer son propre lot d'insécurité. Je n'ai pas entendu les échauffourées de cette nuit, pourtant je ne dormais pas. Preuve que mon double vitrage est bon ! -
D'ailleurs c'est pas la faute du réalisateur, et je ne pense pas que le film soit condescendant dans sa mise en scène. C'est vraiment comme si les critiques ne savaient que réitérer leurs préjugés, comme s'ils ne regardaient pas le film. D'ailleurs dans cette interview par exemple, on voit que le réalisateur veut expliquer que son film cherche à aller au delà du préjugé sur les armes et les trumpistes, mais qu'à la fois il ne peut pas ne pas donner plein de cautions quand il essaie de l'expliquer.
-
Je suis d'accord avec la prémisse, c'est avant tout un bidouillage à l'origine et une pratique empirique à l'heure actuelle, et je ne suis pas certain que ce qu'on cherche en général en matière "d'explication" des modèles entraînés soit bien défini. Maintenant, l'idée qu'on peut peut-être contraindre l'ensemble des fonctions apprenables par un réseau de neurone, même si je ne sais pas à quel point ça vaut une "explication", me semble intéressante en elle même, et on parle de travaux fondés sur des considération mathématiques en un sens assez classique du terme. Après, il y a aussi des approches non mathématiques qui peuvent relever de l'explication dans ce contexte, du type apprendre quelles sont les régions de l'images sont les plus déterminantes pour la classification, ce qui peut permettre de prévenir des erreurs de généralisation (cf. l'exemple du classifieur chien/loup dont on peut "voir" de cette manière qu'il ne regarde que la neige pour classifier... après comment approcher ça formellement, j'en sais rien, à ce stade ça relève d'une intelligence des données purement intuitive). En ce qui concerne le boosting je connaissais pas.
-
A mon avis l'emploi du terme "boîte noire" est malheureux parce qu'il est vrai que le problème n'est pas qu'on ne connaisse pas les algorithmes d'entraînement de réseaux de neurones, ou qu'ils soient difficile à expliquer parce que mathématiquement complexes. Le problème est que, bien que l'on sache que l'entraînement d'un réseau de neurone est un modèle d'approximation d'une fonction, on ne sait pas grand chose ni de la fonction approximée, ni de la fonction approximante représentée par le réseau entraîné. Ici, ne pas savoir c'est essentiellement qu'on n'a ni une idée symbolique de ces fonctions, bien sûr, ni de garantie sur l'erreur d'approximation. Pour sa défense, Villani recentre ensuite le débat sur la question de la garantie relative à l'erreur de prédiction, qui est plus terre à terre. Je trouve par ailleurs que le fait que les deux problèmes (représentabilité/prévisibilité) soient découplés dans le cas du réseau de neurone est assez intéressant du point de vue de la théorie de l'approximation. J'ai du mal à mettre le doigt dessus mais j'ai l'impression qu'en mathématiques on a quand même une vision de l'approximation qui s'attache soit à des aspects symboliques (on ajoute des termes) soit à des aspects graphiques (on linéarise). La manière dont on approche le problème de l'approximation avec les réseaux de neurones est assez déroutante parce qu'on perd très vite la connexion entre les deux (si je comprends bien ce que mes amis théoriciens des modèles me disent, dans le domaine des classifieurs on commence à approcher le problème en terme du cardinal de l'ensemble de points qu'une fonction apprenable par un réseau donné peut séparer). Et pourtant quand on a une architecture simpliste et peu de layers, on a l'impression de comprendre un peu ce qui se passe... Bref je me mouille pas trop parce que c'est pas exactement mon domaine de spécialité.
-
wow much concept.
-
J’ai vu deux films récemment : La mort de Staline d’Armando Iannucci Le film raconte ce que dit le titre et la suite de complots qui s’en suivit, jusqu’à l’élimination de Beria (avec quelques simplifications) et la prise pouvoir de Khrouchtchev. Acteurs et texte excellents, mise en scène d’un comique brutal vraiment très réussie, qui rappelle un peu Inglorious Basterds par moment, au sens où on rigole en suivant le crescendo de violence jusqu’au moment où on rigole plus du tout. La foule d’idiomes et de détails bien vus dans les dialogues est admirable (dialogues pourtant servis en anglais americano-britannique sans aucune volonté de cacher les accents marqués des uns et des autres, ce qui surprend mais on s’y fait bien). La folie paranoïaque des derniers temps du stalinisme, où tout est question de vie ou de mort, et donc où tout le monde abuse de tout le monde pour s'éviter le prie, prend la forme d’une tornade extrêmement comique où les gens se parlent avec des circonvolutions idéologiques délirantes pendant que la purge se passe en fond, c’est vraiment très réussi. Pour info, ce film n’a pas été distribué en Russie (et je crois même qu'il a été retiré des salles qui le montraient). Evidemment je le recommande. America de Claus Drexel. Documentaire sur le village de Seligman en Arizona et alentours, c'est-à-dire dans les parages du Grand Canyon et de la Monument Valley, le long de la route 66. Ça se passe quelques jours autour de l'élection de Trump et on demande aux habitants de raconter leurs vies, et ce qu'ils pensent de l'état du pays, de Trump et de la politique en général, et des flingues. Comme on est en Arizona dans un coin assez paumé où vivent encore des cow boys et où beaucoup de gens chassent, tout le monde est armé et certains ont beaucoup, beaucoup d'armes. Les deux seuls reproches que je ferais au film sont son titre : interroger douze personnes du fond de l'Arizona et appeler ça America est forcément une prise de position manifeste, mais elle ni fine ni claire. Ensuite, la superposition de discours de Trump avec certaines actions et réactions des personnages crée parfois des effets de mise en scène qui sont mal venus dans un documentaire à mon avis. Outre le fait que les paysages filmés sont magnifiques et que la culture matérielle américaine même des gens les plus humbles exerce toujours le même attrait, j’ai aimé le film exactement pour les raisons qui font totalement glitcher le public français (il suffit de lire les critiques qui parlent d’un documentaire « génant » sur « des ploucs »). On voit des gens simples mais intelligents, qui parlent de leur vie souvent très difficile avec franchise, et ont du style. Ils ont des armes et ils savent expliquer pourquoi, et il est difficile de défendre qu’ils auraient tort. Ils votent pour Trump, et il est difficile de ne pas comprendre pourquoi. Ils sont ouverts d’esprit et, s’ils sont taquins, disent finalement rarement des choses très outrageuses. Après comme je disais, ce sont dix témoignages probablement choisis dans un petit patelin, donc difficile de généraliser. Bref, je recommande.
-
Mmmouais....
-

Images pas cool, justice sociale & steaks saignants
Anton_K a répondu à un sujet de Lancelot dans La Taverne
Pas sûr que ça se passe comme ça. Typiquement dans le féminisme intersectionnel le soupçon que les féminismes des vagues précédentes (je suis pas sûr d’où on en est) sont des idéologies de femme blanche bourgeoise donc potentiellement des idéologies d’oppression de la femme noire prolétaire est formulé et probablement déjà opératoire dans les franges les plus extrémistes. Et à mon avis les femmes blanches s’y plieront car elles n’ont rien d’acceptable à y répondre. Qui vivra verra. -

Images pas cool, justice sociale & steaks saignants
Anton_K a répondu à un sujet de Lancelot dans La Taverne
Assez intéressant. Finalement l’intersectionnalité est une stratégie de pouvoir exemplaire. Tu rentres dans une association qui défend une autre cause que la tienne, tu proposes un programme intersectionnel, tu démontres que ta cause est prioritaire, tu fais pression sur tous ceux qui ne veulent pas s’y subordonner jusqu’à ce qu’ils se cassent, et tu conserves l’infrastructure et les financements. Rien de nouveau me direz vous, ça fait de l’ntersectionnalité une bonne vieille stratégie de phagocytage des familles, mais celle là comprend sa propre justification idéologique. -
Une fois j'avais commencé Sous l'Oeil des Barbares, j'ai trouvé ça vraiment très niais, voire un peu bête. Qu'est-ce que tu conseillerais qui mette toutes les chances de son côté ?