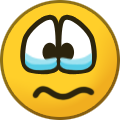-
Compteur de contenus
6 232 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
35
Tout ce qui a été posté par Mégille
-
Ah, toi aussi tu exclus les français de l'humanité ?
-
Ce sont des prétextes... croire que les femmes voteraient moins bien que les hommes revient à du sexisme.
-

Images fun et leurs interminables commentaires
Mégille a répondu à un sujet de Librekom dans La Taverne
Ouai, sauf qu'ils oublient que si on reste fidèle à l'économie marxiste, les services sont du travail "improductif" qui ne produit pas de plus-value. Et le secteur tertiaire représentant aujourd'hui quelque chose comme 80% de la population, le dessin n'est plus vrai pour grand monde. -

Écologie, développement Duracell & topinambours
Mégille a répondu à un sujet de ModernGuy dans Politique, droit et questions de société
Ouai, z'avez sans doute raison... je reviens dans trois semaines avec un projet de Matrix pour les poules.- 5 524 réponses
-
- 1
-

-
- écologie
- environnement
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-

Écologie, développement Duracell & topinambours
Mégille a répondu à un sujet de ModernGuy dans Politique, droit et questions de société
Schopenhauerien, va ! Alors, je ne connais pas très bien le sujet, mais je serais surpris que ce soit si difficile techniquement. Je veux dire, on a déjà identifié le gène mutant des rat-taupes nus qui les prive de douleur. Ce sont des mammifères, comme nos vaches, nos cochons et nos lapins. On est capable de rendre des lapins phosphorescents depuis des années grâce à un gène de méduse. Donc... L'environnement des bêtes d'élevage est déjà hyper contrôlé et aseptisé. Je doute qu'on ait beaucoup besoin de leur instinct de survie, et je ne serais pas surpris qu'au point où on en est, ça représente un obstacle plus qu'autre chose. La viande de synthèse est aussi un truc assez prometteur. Mais ça me semble plus difficile d'accès pour l'instant. Et probablement plus cher, même si le prix est de plus en plus abordable. Et je ne suis pas convaincu du goût non plus, je demande à voir. 50 ans après la généralisation des usines à cochons-taupes nu, ça deviendra peut-être intéressant. Oui, mais pas besoin de l'endormir, de lui chanter une berceuse ou quoi que ce soit. Elle ne se débattra pas, et il y aura moins d'objecteurs de conscience.- 5 524 réponses
-
- écologie
- environnement
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-

Écologie, développement Duracell & topinambours
Mégille a répondu à un sujet de ModernGuy dans Politique, droit et questions de société
Effectivement ! Mais si on leur parle de la difficulté de nourrir 7 milliards d'humains avec leurs méthodes, j'ai bien peur qu'ils nous suggèrent des solutions encore moins enthousiasmantes...- 5 524 réponses
-
- écologie
- environnement
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-

Écologie, développement Duracell & topinambours
Mégille a répondu à un sujet de ModernGuy dans Politique, droit et questions de société
Ca garde l'avantage de provoquer une dissonance cognitive chez ses adeptes. En ce qui me concerne, je ne suis ni utilitariste, ni anti-spéciste, donc je ne fais pas de l'absence de douleur une condition sine qua non de la consommation de viande. Par contre, je juge tout à fait superflu que mon steak ait été une machine à souffrir avant d'arriver dans mon assiette. S'il était possible s'en passer, ce ne serait pas plus mal. Il est même possible que ça coûte moins cher (étant donné les réglementations actuelles). Pas besoin d’anesthésier ou d’assommer la bête, par exemple. La principale raison de consommer de la viande non-mutante sera le bio-conservatisme de l'écologie, ironiquement. Pour survivre dans la nature. Et encore, pas pour toutes les espèces, le rat-taupe nu s'en passe très bien. Je propose de foutre de l'adn de rat-taupe nu dans toutes les bestioles qu'on bouffe, juste pour voir. Ces bestioles se sont adaptées à un environnement très proche d'un celui d'un élevage intensif ou d'un abattoir (forte promiscuité, pas de chauffage, pas de lumière, peu d'oxygène, etc). Ce serait bête de ne pas en profiter en cueillant quelques uns de leurs gènes. Et que ça rende les bêtes moins adaptées à vivre dans la nature serait un argument de plus contre les écolos : l'une des plus grandes peurs concernant les ogm est le risque de dissémination dans la nature (ça n'a pas lieu, et si ça avait lieu, on n'est pas sûr que ce serait un problème, mais reste que ça fait peur à du monde). Si la bête est complètement incapable de vivre hors d'un hangar, la question ne se pose plus. Si on réussit à faire des vaches naturellement shootées à l'endorphine en permanence, ce serait encore mieux. Singer se retrouverait à inciter à consommer le plus de viande possible, car ça inciterait à élever d'autant plus de vaches, et augmenter le bonheur animal total. Bam, monstre utilitariste laitier, à porté de manipulation génétique. Ca s'approche aussi de l'expérience de pensée de la "machine à expérience" de Nozick, mais je ne pense pas que ce puisse être utilisé comme un argument contre. A moins de considérer que les vaches ont un intérêt supérieur pour la quête de la vérité philosophique, mais peu de gens affirment ça.- 5 524 réponses
-
- écologie
- environnement
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-

Faut-il mettre le glyphosate au frigo ?
Mégille a répondu à un sujet de Tramp dans Science et technologie
Ah, autant pour moi ! Bon, sinon, je continue de tourner autour du sujet... je me demandais si le CIRC n'était pas corrompu ou idéologisé. Je suis en train de soupçonner qu'ils puissent être honnêtes, mais juste 1) très prudents et surtout 2) mal compris. Dans la même catégorie d'évaluation du danger que le glyphosate chez eux (catégorie 2A, "cancérigène probable) on retrouve effectivement la viande rouge. Et au dessus, dans la "catégorie 1" des cancérigènes avérés, pires que le glyphosate et le steak, on retrouve, en vrac, plutonium, amiante, tabac, alcool, "viande transformée" (charcuterie), rayons du soleil. La différence entre le danger et le risque apparaît tout de suite beaucoup plus clairement. Je crois qu'il est temps de faire une nouvelle pétition pour interdire les fenêtres et les lucarnes ! Et le tabac, l'alcool et le saucisson, évidemment.- 666 réponses
-
- pesticides
- biologie
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_législatives_françaises_de_mai_1815 La plus belle élection à avoir eu lieu en France. 1815, les 100 jours de Napoléon. Les libéraux remportent plus de 80% des scrutins, et l'empereur demande à Constant d'écrire une constitution. Foutus perfidalbionnais, cette fois, c'était la bonne !
-

Écologie, développement Duracell & topinambours
Mégille a répondu à un sujet de ModernGuy dans Politique, droit et questions de société
J'avais déjà commenté cette vidéo ailleurs. C'est assez n'importe quoi, ne serait-ce qu'au niveau de la forme (esprit de synthèse, les gars, s'il vous plaît...) et de la cohérence : le type avec la voix douce qui se la joue paysan est une sorte de primitiviste qui refuse les contraintes morales que s'imposent les végétariens et végans au nom de contraintes techniques encore plus grandes : pour survivre à long terme, il va falloir tous redevenir pecno, retourner à la tractation animal, etc, et dans cette misère utopique, on aura pas vraiment d'autres choix que de manger de la viande. Il ne s'agit pas d'être plus permissif que les végans bios habituels, il s'agit de s'interdire tellement de choses que eux s'autorisent que se passer de la viande n'est même plus une option envisageable. C'est un écolo de droite, en fait. Un survivaliste qui préfère la bêche au fusil, et donc sans doute un tout petit peu plus optimiste que ceux qui s'attendent à redevenir chasseur-cueilleur, mais guère. Il préfère le néolithique au paléolithique, ça fait de lui un survivaliste progressiste, j'imagine. Et l'autre monsieur muscle testostéroné casseur de pastèque au qi à 2 chiffres, croyant abonder dans son sens, viens en conclure que du coup c'est bon, on peut continuer à acheter notre steak haché au super marché et faire ce qu'on veut. Et puis, il laisse de coté l'argument moral. Quand bien même les vers de terre sont essentiels à l'écosystème, je ne vois aucune mal-honnêteté dans l'attitude de certains végétariens modérés à accorder plus d'attention aux mammifères et aux vertébrés supérieurs qu'a des animaux ayant à peine un système nerveux centralisés, et que l'on peut soupçonner de ne même pas ressentir la douleur. Il ne réfute pas les arguments moraux en faveur du respect des bêtes, il se contente de dire qu'on est tellement dans la merde qu'on ne peut pas se permettre d'être gentil. Maintenant, à propos de la destruction des sols. C'est un vrai problème. J'ai tendance à croire que la solution est l'agriculture de conservation (pas de travail mécanique du sol, rotation des cultures, couvert permanent). C'est d'ailleurs ce que font les agriculteurs lorsqu'on les laisse face à leur responsabilité (le propriétaire d'un sol n'a pas intérêt à le détruire...), comme ça a lieu en Nouvelle Zélande. Le carnage actuel est institutionnellement dû à notre modèle politique agricole qui, partout hors NZ, est extrêmement interventionniste et protectionniste, en France encore plus qu'ailleurs. Mais il faut surtout comprendre que cette question est tout à fait transversale à la question bio vs non-bio, et à la question extensif vs intensif. Le bio est une idéologie pseudo-scientifique qui discrimine de façon tout à fait arbitraire le "naturel" du "artificiel", et qui vise surtout à réduire les intrants (engrais, pesticides, etc), quitte à avoir d'autant plus recours 1) au labour et à la monoculture, les véritables ennemis 2) à des intrants "naturels" beaucoup plus nocif, pour l'humain ou l'environnement (cuivre, huile de neem, etc). L'agriculture intensive consiste à utiliser moins d'espace et plus de produits, l'extensive, l'inverse. On fait beaucoup de reproches à l'intensive, mais il faut aussi voir qu'elle laisse plus de place à la nature, et qu'un retour à l'agriculture extensive (ou une généralisation du bio, toujours moins rentable) impliquerait une sacrée déforestation. Si les terres agricoles étaient gérés de façon responsable par des propriétaires qui n'ont pas intérêt à leurs destructions, cet arbitrage espace/intensité serait fait grâce au marché, en attendant, on se contente de faire des calculs socialistes. Et c'est encore différent de la question du local. Choisir ce qui est cultivé le plus proche n'est pas forcément meilleur pour l'environnement. Un trajet plus court, en camion par exemple, va peut être émettre beaucoup plus de pollution par kg transporté qu'un trajet plus long mais plus massif et plus dense en énergie, par exemple en bateau. Il y a aussi des "économies d'échelle" du coté des coûts environnementaux. Et si c'est moins cher ailleurs, c'est parfois parce que ça a aussi un coût environnemental plus bas ailleurs. Par exemple, cultiver des fraises sous serre en France demande plus d'énergie (et d'émission de GES, etc) que de les cultiver en plein air en Espagne, peut-être même si on prend en compte le transport. Bien sûr, des OGM appropriés permettraient de rendre obsolète un paquet de ces questions. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on attends pour faire des animaux ogm qui ne ressentent pas la douleur. C'est très loin d'être inaccessible techniquement, ça évacue les arguments utilitaristes à la Singer, et ça contribuerait peut-être à rendre la viande plus tendre, car moins stressée, et l'élevage plus facile.- 5 524 réponses
-
- 2
-

-
- écologie
- environnement
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-

Faut-il mettre le glyphosate au frigo ?
Mégille a répondu à un sujet de Tramp dans Science et technologie
Je ne sais pas si ça a déjà été posté ici : https://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2945 En gros, le CIRC, la seule agence qui évalue le glyphosate comme un "cancérigène probable", non seulement n'évalue que le danger et pas le risque, mais même à ce niveau, le fait de manière très contestable. Pour établir la génotoxicité (sa possibilité d’engendrer des mutations) du glyphosate : ils utilisent des études faites sur des animaux non-mammifères, et en les exposants à des produits qui ne contiennent pas que du glyphosate. Pour établir sa cancérogénécité sur l'animal : ils utilisent des études très vieilles, dont les résultats n'ont pas pu être reproduit, et pour lesquels les groupes test n'avaient que quelques pourcentages de cancer de plus que les témoins. Pour établir sa cancérogénécité sur l'humain : les études de cohorte ne donnant rien, ils s'appuient uniquement sur des études cas-témoins, c'est à dire, sur des témoignages de gens que l'on interroge sur leurs alimentations plusieurs décennies en arrière, pour vérifier si les cancéreux ont généralement ingéré plus de glypho que les non-cancéreux. Ce qui est bien entendu très biaisé, non seulement du fait des limites de la mémoire humaine, mais aussi parce que les personnes atteintes d'un cancer ont tendance à exagérer leur exposition. Bref, c'est une belle fumisterie, cette affaire.- 666 réponses
-
- 1
-

-
- pesticides
- biologie
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-

Les Républicains
Mégille a répondu à un sujet de PABerryer dans Politique, droit et questions de société
Ah, possible. -
Oui, mais la rencontre de la diversité nous ramène à notre propre imperfection, et nous rappelle que nous ne sommes pas des sages avec une connaissance parfaite de la vérité, justement, ce que l'on oublie trop facilement. Il me semble aussi que la diversité et l'indépendance des opinions est l'une des conditions de la "wisdom of the crowds", pour éviter de tomber dans le "groupthink".
-

Les Républicains
Mégille a répondu à un sujet de PABerryer dans Politique, droit et questions de société
C'est peut-être aussi pour anticiper la réforme du parlement. Si chaque groupe a une voix, alors, autant avoir, formellement, le plus de groupes possibles. Ca ne va pas forcément donner une division pour les électeurs. D'ailleurs, à l'AN, il me semble que les LR ont déjà un petit schisme, avec quelques uns ("les constructifs") qui sont dans le groupe de l'udi. -

Dieu, Grâce et existence
Mégille a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Tu n'aimes pas la kabbale, @Rincevent ? -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Mégille a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Intéressant effectivement (j'ai lu le thread, pas l'article) A propos du fait que ce ne soient pas de "pure relativiste" ou des "post-modernistes traditionnels" : les post-mo classiques aussi admettent des structures d'oppressions fondamentales, qu'ils traitent comme des réalités objectives. Biopouvoir chez Foucault, phallologocentrisme chez Derrida, etc. Il n'y a pas beaucoup de vrais relativistes qui s'assument, en général, montrer que l'autre est un relativiste total revient à un échec et mat. Donc ce sont bel et bien de bons post-modernes. Ca a simplement mis un petit bout de temps (une génération ou deux...) pour que ça cesse d'être une idée farfelue de quelques intellos de Paris ou de Francfort pour devenir un mouvement de masse. -

Écologie, développement Duracell & topinambours
Mégille a répondu à un sujet de ModernGuy dans Politique, droit et questions de société
Comme cause de la reforestation de l'Europe : l'exode rurale, mais aussi l'agriculture intensive, puisque pour produire une même quantité, on utilise moins de terre, et on en laisse donc plus à la forêt. Les machines contribue aussi à ce que moins de moins d'oeuvre soit employé, et donc que les territoires ruraux soient de moins en moins occupés par l'humain (ce qui va de pair avec la migration vers les villes). Mais ça, dire que l'agriculture intensive peut avoir un impact positif sur l'environnement, c'est l'hérésie suprême. (et surtout, ne leur dite pas leur dite pas que l'agriculture bio est elle aussi souvent intensive)- 5 524 réponses
-
- 2
-

-

-
- écologie
- environnement
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations
Mégille a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne
Gardez vos Bordeaux, vive la Mondeuse. Savoie libre ! -
Les deux crimes impardonnables du peuple belge : le génocide du Congo, et les moules-frites. Ils sont au courant que les moules n'ont pas de système nerveux central, ou pas ? (contrairement à un foetus...)
-
Nan mais les montées de lait sont des constructions sociales, t'façon. Et les seins aussi. La preuve : les petites filles n'ont pas plus de sein que les petits garçons, c'est bien la preuve que c'est acquis par l'éducation. Saloperie de chimpanzés qui nous ont conditionnés au patriarcat, aussi...
-

Écologie, développement Duracell & topinambours
Mégille a répondu à un sujet de ModernGuy dans Politique, droit et questions de société
Je croyais que c'était notoire. Les écolos l'ignorent peut-être, mais je ne pense pas qu'ils prétendent le contraire. Par contre, c'est bien un problème : parce que les forêts sont très peu entretenues, et parce que ce sont de "mauvais arbres", hêtres, sapins, etc (qui poussent vite et qui ont donc le bois souple et léger) beaucoup moins bons pour la construction que des chênes (que l'on coupe trop vite). Bien sûr, les verts ne risquent pas de signaler des problèmes aussi anthropocentrés. Et le manque de vue à long terme dont la pénurie de chêne est un symptôme est sans doute une conséquence de la gestion publique des forêts. Les écolos manifestent souvent plus de peurs pour les forêts équatoriales. C'est injustifié quand c'est au nom de la lutte contre le RCA, puisque la végétation mondiale augmente grâce au co2 (le global greening, donc pas de risque de pénurie d'oxygène), et puisque remplacer des surfaces de forêts denses par des champs augmente l'albédo de la Terre, et donc contribue à la refroidir. Reste le souci de la biodiversité, j'imagine. Et le risque d'érosion, et deux trois trucs qui vont avec.- 5 524 réponses
-
- 5
-

-
- écologie
- environnement
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-
J'aimerais le savoir ! J'imagine qu'il faut du réseau... et du talent ! J'espère que tu as jouis, au moins ?
-

Police, dérive, excès de zèle & toute-puissance étatique
Mégille a répondu à un sujet de Hayek's plosive dans Politique, droit et questions de société
Incroyable, ces mecs se croient vraiment tout permis. Ils sont pas sensé connaître par coeur la constitution de leur pays, ou quelque chose comme ça ? Ou peut-être n'était-il juste pas au courant qu'aujourd'hui, les noirs ont le droit de faire des études, et que eux aussi peuvent connaître leurs droits. -
C'est une drôle d'idée, qui ne semble pas avantager LREM. Les gagnants de cette réforme seraient les tendances divisées en plusieurs groupes, donc la gauche. A supposer bien sûr que le temps de parole donné à une tendance ait un réel impact sur l'action politique. Aussi, je ne sais pas ce que ça veut dire pour les indépendants. Vont-ils être complètement privé de tribune ? Je pense qu'il y a là derrière une intention comparable à la volonté de Macron, déjà affiché, d'introduire une "dose de proportionnelle" (sur le modèle allemand, j'imagine) à l'AN, alors même qu'un tel fonctionnement, en 2017, aurait eu pour conséquence de donner beaucoup moins de députés à Macron, et beaucoup plus à Lepen. Ce que j'en comprends : il est conscient qu'une surreprésentation excessive de ses partisans dans les institutions menace sa légitimité (il suffit de voir les critiques des mélanchonistes), et il veut donc laisser une place juste assez visible à ses contradicteurs pour ne pas avoir l'air d'un autocrate. Toute la subtilité de la manœuvre étant de ne pas le faire jusqu'au point de se retrouver contraint de négocier avec qui que ce soit. La philosophie derrière, je crois, est celle d'Habermas, et sa conception "délibérative" de la démocratie (Macron et Habermas se sont d'ailleurs tous les deux envoyés des petits mots d'amour à plusieurs reprises). Pour H, la démocratie n'est pas essentiellement un mode de prise de décision qui fonctionnerait par agrégation des volontés individuelles ou par arbitrage entre des groupes d'intérêts antagonistes. La démocratie est plutôt d'abord un processus de délibération par lequel le peuple définit lui même ce qui est bien, ce qui est d'intérêt public. Il ne s'agit donc pas d'une façon de prendre de "bonne" décision, il s'agit de choisir ce en quoi consiste le bon. Cette conception permet de comprendre l'idée derrière le "grand débat", parodie de délibération par laquelle EM a tenté de venir à bout des GJ, en opposant sa conception de la démocratie à la leur. On retrouve aussi cet habermassisme dans son contrôle de plus en plus intense des médias. Pour H, la démocratie suppose une place publique et une certaine forme de liberté d'expression, mais celle-ci est justifiée uniquement par sa nécessité pour forger un intérêt collectif, et pas par une question de droit individuel pré-politique. Par conséquent, le modérateur du débat (l'état bienveillant) a tout à fait la légitimité d'intervenir pour donner plus ou moins la parole à certaines idées en fonction qu'il les juge plus ou moins utiles au débat publique. Pire que ça : c'est même un devoir, et ne pas le faire reviendrait à ne pas garantir une véritable liberté d'expression telle qu'il l'entend. De façon plus centrale, je crois que cette théorie de la démocratie comme forme de légitimité politique plutôt que comme mode de gouvernement est ce qui lui permet de rester technocrate dans son action, et de laisser s'épanouir sa véritable nature de saint-simonien. Il a peut-être eu un tournant au début de son mandat. Lors de la campagne, il se revendiquait de Ricoeur, qui a des idées assez différentes de celle de Habermas je crois, mais je ne le connais pas très bien. Ca va aussi de pair avec son abandon avec son identité de "libéral de gauche" à l'américaine façon Rawls. C'est dans ce contexte aussi qu'il faut comprendre sa germanophilie affichée (qui est un éloignement de son modèle premier qui est anglo-saxon).
-
Il les faits sur commande.