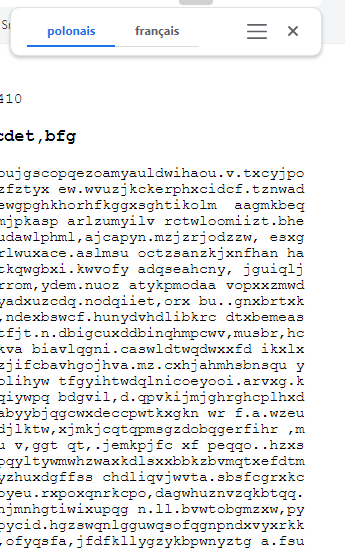-
Compteur de contenus
6 232 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
35
Tout ce qui a été posté par Mégille
-

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Mégille a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Moi je l'aime bien, le calendrier révolutionnaire. Il aurait été étrange de réformer les mesures de distance, de volume, de masse... et pas celles de temps. Pour le temps comme pour les autres mesures, il s'agissait de remplacer un système vaguement en base 12 mais avec des tas d'exception, pour un système en base 10, beaucoup plus prévisible. Superposer le cycle des semaines avec le cycle des mois et des années aurait effectivement été très pratique au quotidien. Et les noms des mois révolutionnaires sont assez beaux, et d'une belle régularité. Je ne sais pas ce qui est le plus surprenant : que l'on a gardé, et que le reste du monde a adopté, nos mètres, grammes et litres, ou bien, que l'on a abandonné les mesures de temps qui allaient avec. Pour les fêtes religieuses, le calendrier liturgique catholique aurait très bien pu être conservé à coté par les concernés, comme le sont les calendriers musulmans ou chinois. Evidemment, le coté "contrôle planifié" est un peu dérangeant (quoi qu'encore une fois, on le pardonne pour les autres mesures...). Mais le calendrier grégorien est lui aussi le fruit d'une série de réformes politiques. Et autant les réformes de Grégoire XIII et de Jules César étaient assez mineures (quoi qu'entre temps, deux mois on changé de nom, et que le début de l'année et du décompte des années ont changés, et qu'avant César, il y avait encore parfois un treizième mois intercalaire) autant auparavant la réforme de Numa avait tout simplement ajouté deux mois à un calendrier de 10 mois et d'une période vague en hiver. Toutes ces réformes étaient décidés par une autorité centrale et dans un but de rationalisation scientifique. -
Je connais un "Albert" qui n'est pas content de voir son nom ainsi usurpé.
-

Abstémie : les cent jours de Sodome et Gomorrhe
Mégille a répondu à un sujet de NicolasB dans La Taverne
J'imagine que ça peut être 1) ce qui te donne un sentiment d'appartenance à une communauté, à plus que toi seul, 2) les rituels et les codes moraux que tu es enclin à respecter même sans y réfléchir, et 3) les croyances fondamentales que tu es le moins disposé à remettre en question. -

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
Bon, et bien, Israel n'a pas l'air de vouloir régler ça à l'amiable. https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2024-04-19/middle-east-latest -
C'est toujours moins chelou que les noahides : ces types qui ne se disent pas juifs, mais qui reconnaissent le judaïsme comme la bonne religion et respectent des lois religieuses fixées pour eux par les rabbins.
-
Bonjour, je t'invite à te choisir une image de profil et à te présenter ici -> https://forum.liberaux.org/index.php?/forum/191-forum-des-nouveaux/
-
Attention, Pigou, Mr externalité, était un néo-classique de la bande à Marshall, et pas du tout copain avec Keynes, donc pas de l'école de la synthèse ! Et hors de l'aspect historique, son approche me semble bien néo-classique et pas keynésienne, puisqu'elle consiste à analyser les problèmes que d'autres voudraient présenter comme irréductiblement collectifs en des termes individualistes et micro-économiques, et que la solution implique une planification minimale de l'état (fixation d'un seul prix qui n'est pas fixé par le marché) et de surtout faire confiance au marché. Maintenant, est-ce que le coût en inflation de la création monétaire peut être assimilé à une externalité... peut-être, mais le dire aux interventionnistes ne les convaincra probablement pas, puisque 1) ils considèreront la "relance" comme une externalité positive supérieure, et que 2) les coûts bel et bien internes que sont les taxes et les impôts ne les gênent déjà pas vraiment.
-
Le phénomène est à mettre en parallèle avec la croissance de la bureaucratie privée et publique, qui est de plus en plus la classe dominante (au lieu des propriétaires et des élus). A la fois parce qu'elle émet des normes qui contraignent les autres à se diplômer, et parce que le diplôme est une condition pour la rejoindre. Que le bureaucrate n'ait pas nécessairement un niveau de richesse très élevé pour autant ne fait que nous montrer que la richesse tend à laisser la place à d'autres marqueurs de statut social. Fait intéressant, la Chine fait face à cette même dynamique depuis l'antiquité, et c'est de cette classe de savants inutiles qu'a émané le confucianisme, et c'est elle qui l'a entretenu, et a été entretenu par elle. Amusant de voire que notre classe de bureaucrate à nous produit une idéologie en tout point opposée à celle-là.
-

Images fun et leurs interminables commentaires
Mégille a répondu à un sujet de Librekom dans La Taverne
Je découvre avec enthousiasme https://libraryofbabel.info/ Et quelle chance ! A en croire mon traducteur, je serai tombé sur une suite de lettre normale dans une langue européenne ! -

Légalisation des drogues
Mégille a répondu à un sujet de Blueglasnost dans Politique, droit et questions de société
Les grand-mères. Il y en a sans doute une qui influence quelqu'un quelque part. -

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
Je ne me souviens pas non plus avoir vu quelque part les conditions exigées par le Hamas pour le faire. J'imagine qu'ils ont tout de même trouvé un truc un peu plus réaliste que l'abolition d'Israel, sinon, autant les tuer tout de suite. -

Les forces armées, en France et dans le monde
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Actualités
Le problème est qu'ils ne sont pas allé assez loin. Le Woke foetus-eater euthanasist 1984 ça aurait été badass. Quant à la droite, pour des raisons de laïcité, elle aurait dû proposer un amendement pour en faire le Simone Unveiled. -
C'est la façon la plus facile de le comprendre aujourd'hui... et oui, une simulation, ou une série de simulations les unes dans les autres, ressemblent un peu à l'idée de perte de degrés de perfection et de réalité dans une suite d'émanations. Mais c'est un anachronisme, qui repose sur des concepts ou des analogies que n'avaient pas les anciens gnostiques. Il y a même une opposition forte entre les deux conceptions : l'hypothèse de la simulation repose généralement sur le fonctionnalisme en théorie de l'esprit, l'idée que l'esprit puisse se réduire à une certaine activité de la matière. Là où les anciens gnostiques croyaient plutôt en une autonomie de l'esprit. Quand à la moins grande réalité du monde matériel, elle consistait surtout en ce qu'il soit soumis au changement, et contingent, là où le plérôme était pensée comme hors du temps. Rien à voire donc avec un autre monde suffisamment semblable au nôtre pour qu'on y trouve aussi des ingénieurs et des machines. Mais oui, évidemment, le gourou qui s'emparera de la simulation aurait tort de ne pas puiser dans le gnosticisme.
-

Je cherche le nom d'un truc (livre, film, ...)
Mégille a répondu à un sujet de Gio dans Lectures et culture
Et même des logiques postmodernes ! La logique classique, c'est Aristote. La logique contemporaine standard, ça va être le calcul des propositions, la logique de premier ordre, et la théorie des ensembles, principalement. La logique d'Aristote est un cas particulier de la logique de premier ordre. -
Il y a un paquet de religions centrées sur les extra-terrestres, des mormons aux raéliens en passant par les scientologues et d'autres, mais encore aucune sur la théorie de l'univers comme simulation informatique. Etrange, parce qu'il y a vraiment de quoi faire.
-
Bienvenue ! Vivre entouré d'autres libéraux plutôt que de socialistes ? Pas question, je tiens à rester la personne la moins stupide du coin. ps Si jamais tu as des questions sur le fonctionnement du forum, ou besoin de médiation avec la modération, tu peux t'adresser à moi.
-

L'ineffable Bruno Le Maire
Mégille a répondu à un sujet de Tramp dans Politique, droit et questions de société
Hm, ça doit être la fameuse différance de Derrida. -

La prison : fondements, fins & moyens
Mégille a répondu à un sujet de Anton_K dans Philosophie, éthique et histoire
Tu veux dire, n'est pas une fonction linéaire d'une seule variable, ie, du système pénal ? Est-ce que ça s'observe tout aussi facilement au sein d'un même groupe ethnique ? Autrement, le risque de biais est très fort. De manière générale, je sceptique à propos de tout ça. Ne serait-ce que parce qu'on voit la criminalité pas mal évoluer au sein d'un même pays, pour des raisons qui me semblent difficilement attribuables aux prédispositions innées des populations. Au hasard : Faut-il considérer que la forte réduction des homicides (division par deux ou trois !) dans ces pays là, depuis les années 90 (ou depuis 95 pour les allemands) est due à une beaucoup moins grande agressivité innée des nouveaux venus dans ces pays depuis ? Mais je n'ai peut-être pas compris quelque chose ? -
Un réchauffement climatique, et plein de gens qui meurent dans le sud de la France ! Encore une preuve de l'urgence de la situation.
-

École & éducation : Le temps des secrets
Mégille a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Dans ces cas là je suis à peu près sûr que les doubles consonnes étaient prononcées il y a deux ou trois cents ans. -
TIL qu'il y avait en fait un sacré paquet de prophètes (et une prophétesse !) en Arabie du temps de Muhammad. Maslama, Tulayha, Sajah, Dhu al-Khimar, Saf ibn Sayyad, Laqit ibn Malik... Ils sont généralement présentés comme des usurpateurs qui tentent leur chance après la mort de Muhammad. Mais au moins l'un d'entre eux, Maslama, se disait déjà prophète avant ça (et peut-être même avant Muhammad), et deux autres, Sajah et Dhu al-Khimar, semblent avoir déjà été des figures religieuses. Je suis un peu surpris et déçu que "le Coran des historiens" de Dye et Amir-Moezi ne parlent pas plus de ceux là. En tout cas, même en suivant l'histoire orthodoxe, l'islam se répand, dans ses premières années après la mort de son prophète, en absorbant d'autres communautés religieuses contemporaines rivales. Je me demande quel rôle elles ont jouées dans les conflits internes du début de l'islam. Fait notable : Ali s'est probablement allié à l'une de ces communautés puisqu'après la mort de Fatima, il se serait marié avec Kawla al-Hanafiyya, une membre du clan Hanafi, qui suivait le prophète Maslama. Autre considération au passage : la désignation de Muhammad simplement par un pronom (sauf seulement trois ou quatre fois, je crois) dans le Coran fait que si par mégarde un texte religieux d'une de ces autres communautés y avait été inséré (puisque le Coran a été compilé à l'écrit après leur absorption), si l'un de ces "il" et de ces "je" était en fait Maslama ou un autre, on n'aurait aucune façon de le savoir.
-

Terrorisme et sécurité
Mégille a répondu à un sujet de Raum Gytrash dans Politique, droit et questions de société
Fun fact : le Khorasan (région d'Asie centrale à laquelle s'identifie "l'Etat Islamique au Khorasan") est la région historique d'où ont démarrés les troisième et quatrième "Fitna" (guerre civile musulmane). La troisième a provoqué la chute de l'empire arabe Omeyyade et l'instauration du califat Abbaside. La quatrième est celle qui a vu le renversement du calife al Amin par son frère al Mamun, qui était gouverneur du Khorasan et dont le rôle historique ne doit pas être négligé, puisque c'est indirectement lui qui a provoqué la naissance du sunnisme et du chiisme à la fois. Le sunnisme, conservatisme décentralisé, étant une réaction à sa politique centralisatrice et rationaliste (ce sont les partisans de Ibn Hanbal, son principal opposant, qui sont les premiers à s'être fait appeler ahl as sunnah). Le chiisme, ou au moins ses formes majoritaires, étant lui issu, à mon avis, d'une tentative d'al Mamun de contrebalancer le pouvoir des élites de Bagdad qui lui étaient hostiles en se créant un contre-réseau d'influence, en tentant d'associer les alides (en l'occurrence, al Rida puis al Jawad) à son pouvoir et à sa succession. C'est seulement lorsque cette lignée d'héritiers adoptifs d'al Mamun s'est éteinte publiquement que son nés, probablement à partir des restes du même réseau, le chiisme duodécimain, qui s'est inventé un héritier caché et invisible, et le chiisme ismaélien, qui s'est inventé une lignée parallèle et rivale d'héritiers légitimes mais cachés de la dynastie alide. tl;dr : le Khorasan c'est rigolo, il y a déjà eu des choses intéressantes qui ont commencés là bas.- 2 005 réponses
-
- 5
-

-
- terrorisme
- sécurité
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-

Images fun et leurs interminables commentaires
Mégille a répondu à un sujet de Librekom dans La Taverne
Je ne sais plus ce qu'ils veulent dire par là, mais en tout cas, chez Sombart (le nazi qui invente le concept), l'école de Francfort, et les trostkystes, c'était l'inverse. -

Images fun et leurs interminables commentaires
Mégille a répondu à un sujet de Librekom dans La Taverne
Reconnais qu'elle serait encore mieux vêtue seulement d'idées et d'interprétations. -

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
Il faut tout donner aux kurdes. Il doit bien y avoir un ayyoubide dans le lot.