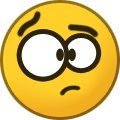-
Compteur de contenus
6 232 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
35
Tout ce qui a été posté par Mégille
-
Je viens de finir le premier volume du Coran des historiens. Les contributions de Dye et Amir-Moezzi, à la fin, sont de loin les plus intéressantes. Mais je me pose toujours plusieurs questions. Je suis surpris que la contribution de Shoemaker sur les vies de Mahomet n'ait pas évoqué la proximité entre celles-ci et la vie de Moïse. L'hypothèse du calque de la Sira sur l'Exode n'est elle plus d'actualité ? Je me demande aussi à partir de quelle période les sunnites se sont mis à inclure Ali parmi les "bien guidés", parce que je vois mal les Omeyyades, surtout les premiers d'entre eux, garder une image positive de celui-là. Est-ce une tentative de compromis avec les alides de la part de savants plus tardif ? Je m'interroge beaucoup aussi sur le personnage de Aisha, clairement l'un des plus intéressants des débuts de l'histoire de l'islam. Dans quelle mesure était-elle une agente et une politicienne de l'islam post-Muhammad (notamment dans la mise à l'écart de Ali, et dans la prise de pouvoir de son père Abu Bakr), dans quelle mesure était-elle plutôt un pion dans la stratégie des puissants de son clan ? J'aurais aimé que son cas soit un peu plus creusé ! D'ailleurs, à propos du récit traditionnel de son viol par Muhammad, il me semble probable que ce soit une invention tardive. Puisqu'il ne faisait pas du tout débat parmi les musulmans, il ne s'agit pas de l'un de ces témoignages gênants que personne n'aurait eu intérêt à inventer plus tard (au contraire du récit de son accusation d'adultère), par contre, antidater la date de son mariage et de la consommation de celui-ci avec Muhammad s'inscrit tout à fait dans les intérêts de Abu Bakr et de ses alliés, pour se faire passer pour un allié (plutôt qu'un ennemi) de longue date du régime de Médine. Je suis en même temps en train de lire le De Iside et Osiride de Plutarque, et j'y apprends qu'une légende égyptienne faisait descendre les juifs de Seth. Ce qui fait me demander s'il n'y a pas un lien entre ce récit et celui de la Genèse (Seth, troisième fils d'Adam, ancêtre des humains suivant et a fortiori des hébreux), soit que la légende égyptienne soit issue d'une confusion entre leur Seth et celui des juifs à cause de leur homonymie, soit que le Seth biblique soit une récupération et une réappropriation du Seth égyptien, innocenté en faisant porter la responsabilité du premier meurtre non plus sur lui mais sur un autre frère (après tout, il y a pas mal de ressemblances entre le mythe de Osiris et celui de Baal, dont le nom semble apparenté à celui d'Abel). J'imagine que quelqu'un d'autre a déjà dû écrire sur tout ça, j'aimerais bien savoir qui.
-
Est-ce que quelqu'un sait si l'actualité d'Argentine est commentée aux USA ? (plus ou moins qu'en France ?) J'espère que le LP saura capitaliser dessus. D'ailleurs, je viens de jeter un coup d'oeil aux candidats de la primaire, et ils ne font pas rêver... j'espère que d'autres se présenteront.
-
Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là pour affirmer que Poutine et Trump sont alliés/ont des moyens de pression l'un sur l'autre (ou au moins, Poutine sur Trump). Sous Trump, avec un allié au pouvoir, tenter de prendre brutalement Kiev n'était peut-être tout simplement pas nécessaire. Alors que sous un type avec des intérêts obscurs en Ukraine, continuer à grignoter l'Urkaine par l'est n'était peut-être plus aussi facilement espérable. Ce qui ne rentre absolument pas dans ce scénario, par contre, est que c'est Trump qui a mis un stop à Nord stream 2, et Biden qui l'a redémarré. Je ne m'explique pas ça. Soit il y a quelque chose d'autre qui m'échappe, soit le paragraphe précédent est tout faux. Mais même dans ce dernier cas, les fréquentes manifestations de sympathie de Trump envers Poutine, et les probables affaires en Ukraine de la maison Biden, restent des énigmes à élucider au regard de leurs politiques en apparence contraire à leurs intérêts.
-

Allez Javier Milei, à la tronçonneuse ! Argentine socialiste, bientôt libertarienne ?
Mégille a répondu à un sujet de José dans Europe et international
Bonjour Eram ! Je t'invite à te choisir une image de profil, et à te présenter en créant un nouveau fil de discussion dans ce sous-forum : https://forum.liberaux.org/index.php?/forum/191-forum-des-nouveaux/ -
Le procès sur les documents classifiés toujours à mar-e-lago après le mandat de Trump est encore en cours... Je ne savais pas que l'infos sur les espionnes était fake. Au temps pour moi. Mais tout de même, les russes, cubains, nord-coréens, chinois et iraniens auraient eu tort de ne pas y envoyer leurs unités d'élite du corps spécial des James-Bond-girls.
-

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que ça n'en est pas un... Et d'ailleurs, pour faire un peu le complotiste version gauchiste, j'ai bien l'impression que les opérations actuelles d'Israël visent précisément à réduire la population gazaoui (en ciblant les femmes et en détruisant les infrastructures vitales), et que laisser passer l'attaque, attendue, du hamas, avait précisément pour but de se donner un prétexte pour le faire. Parce que les juifs du monde arabes ont fuit en Israël, pas parce qu'ils ont été exterminés... Quelle définition de "palestinien" te donnes tu ? Légale/administrative ? et dans ce cas, laquelle ? Personne née dans les territoires palestiniens ? Personne avec la quasi-nationalité palestinienne, en y incluant les réfugiés palestiniens qui ne sont pas nés en Palestine et n'y ont jamais mis les pieds ? Ou bien, ethnique ? Et dans ce cas, selon des critères objectifs (dialectal, quitte à "déborder" significativement) ou subjectifs (auto-identification) ? Parce que, dans ce dernier cas, il me semble que beaucoup d'arabes israéliens se considèrent bel et bien comme des palestiniens, malgré le statut légal différent. A propos des druzes : étant pour beaucoup sur des territoires occupés appartenant théoriquement à la Syrie, leur statut est un peu particulier... Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont (ceux d'Israël et du Golan en tout cas) en cours de re-définition ethno-religieuse. Dans les interviews de druzes que j'ai pu entendre, ils insistent beaucoup sur l'indépendance de leur religion par rapport à l'islam, et insistent sur le rôle de Jethro (plutôt que de Ali, comme les autres chiites) comme fondateur de leur religion. Or, dans l'ismaélisme (dont ils sont issus, voire dont ils font partie), Jethro est le prophète secret (ils le sont tous) caché derrière Moïse (comme comme Ali, caché derrière Muhammad). Donc lorsqu'ils se revendiquent de Jethro plus spécifiquement que de Ali, sans rien changer à leur doctrine, ils se réclament être une version ésotérique du judaïsme plutôt que de l'islam... (ce qui, en soi, leur est assez indifférent) Je crois que c'est un choix et une stratégie consciente, et pas simplement un avatar de cette tendance (fréquente) à se revendiquer d'un ancêtre le plus ancien possible, car dans ce cas, ils se revendiqueraient en priorité plutôt de Seth, le prophète pour eux caché derrière Adam. J'aimerai beaucoup écouter des témoignages de druzes hors d'Israël ou des territoires contrôlés par Israël, pour voir s'ils affichent accorder autant d'importance à Jethro. Je m'attends à ce que ça ne soit pas le cas. -
C'est tout de même fou, qu'en une vingtaine d'année, l'électorat américain soit passé d'être scandalisé par une fellation, à se préparer à re-voter pour un type qui partouze avec des espionnes ennemies au milieu de documents top-secrets et qui a commis une tentative (ridicule, mais une tentative quand même) de putsh. J'ai du mal à ne pas m'en étonner à chaque fois que j'y repense.
-
Ca ressemble à un gros échec du pape, surtout vu ses objectifs et sa stratégies affichées. Où est-ce que ça coince pour lui ? Pas assez conservateur ? Rivalité avec l'Argentine ? Augmentation de l'influence étasunienne au détriment de l'influence européenne ? Ou simplement, plus grande efficacité des évangéliques dans leurs missions ?
-
"Touristes, n'allez suuuuuuurtout pas à cet endroit. Ci-joint, des photos magnifiques et la géolocalisation exacte de l'endroit."
-

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
Israël est à peu près aussi démocratique que ne l'étaient la France ou l'Angleterre avant les années 60. Démocratie libérale, avec ses défaillances ordinaires, sur son territoire officiel/en métropole, administration de facto ségrégationniste et quasi-totalitaire dans les colonies. La Cisjordanie reçoit un traitement intermédiaire entre le protectorat et la colonie de peuplement, et Gaza reçoit le traitement d'un territoire rebelle. -
Le boulangisme est-il en faveur de la panification économique ?
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Oui, tout à fait, c'est ce que je lui ai expliqué pour l'inviter à s'y mettre. -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Peut-être en partie... mais c'est aussi un effet de l'orthodoxie économique qui cherche à se couper des autres sciences humaines/sociales pour affirmer sa légitimité et ne pas se mêler au reste du bourbier (alors que le croisement avec l'économie serait indispensable pour que les autres sciences humaines progressent en scientificité), et de la séparation rigide des disciplines et des spécialisations. Dans le cas de mon amie, elle a une formation de philosophe et de juriste, et est prise d'un relativement sain sentiment d'illégitimité dès qu'elle s'aventure en territoire inconnu. Jouer les autodidactes demande toujours une petite dose de dunning-krugerite pour se lancer (ce que j'assume parfaitement dans mon cas). -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
J'ai une amie libérale classique/de gauche (tendance JS Mill + Rawls), très intelligente mais qui préfère rester du coté de la philo sans trop toucher à l'économie, qui organise un colloque dans sa fac... et qui a eu le malheur d'inviter, à la suggestion d'un collègue, un économiste de l'école autrichienne sans très bien savoir de quoi il s'agissait. La pauvre, quand je lui ai expliqué qu'il s'agissait de la tendance "Milei" de la force, j'ai eu l'impression de lui avoir révélé qu'elle avait signé un pacte avec le diable ! -
Ah oui ? Quel sketch ?
-

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Mégille a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Un peu plus, oui, ça l'est toujours. Beaucoup plus, je ne pense pas. Républicanisme, libéralisme et socialisme se sont toujours pour ainsi dire toujours érigés comme le parti du progrès et de l'égalité contre le conservatisme. Ou en tout cas, tant qu'ils étaient de gauche/étaient la gauche. Ca, c'est seulement tant que l'écologisme préfère sa posture morale et ses sacrifices rituels à l'efficacité. Les écolos finiront bien par se rendre compte que rendre les quelques riches moins riches est moins efficace que de rendre les nombreux pauvres moins nombreux. C'est déjà le sens dans lequel va l'écologisme au niveau international, d'ailleurs. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Mégille a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Oui, et l'islamisme dans le paysage politique global s'est d'abord déployé comme un allié objectif des USA contre les alliés de l'URSS, et donc comme allié de la "droite" mondiale, avant de changer de bord pour différentes raisons. Ca n'empêche pas que ça reste un courant intrinsèquement conservateur, quelque soit le coté duquel il cherche des alliés ou des avocats. Idem pour l'écologisme. Les seules valeurs qui peuvent servir de fil directeur à la gauche à travers la succession des idéologies qu'elle a traversée (jusqu'à l'arrivée de l'écologisme) sont le progrès et l'égalité (quoi que sous des formes très différentes). L'écologisme est d'abord et intrinsèquement une critique du progrès. Et en tant que critique de la croissance démographique (puisque tous les autres sujets des écolos sont principalement des conséquences de celui-là), c'est à dire, en tant que néo-malthusianisme, l'écologisme mène nécessairement à l'une des formes les plus radicales d'anti-égalitarisme. Le "sens" en question n'est qu'une rationalité tactique : actuellement, l'alliance sinistre milite peut-être légèrement plus pour une limitation des libertés (et encore, ça se discute), mais le plus souvent, la seule chose qui manque à la droite pour cesser d'être nos alliés objectifs, c'est le pouvoir. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Mégille a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Coté islamo-droitisme, il y a aussi la tradition ésotérique de Guénon et de Evola. Ca n'a jamais été bien gros, mais ça a eu quelques représentants, notamment à la fac de philo de Lyon 3, qui sont discrets sur leurs opinions, mais influents dans leurs petites sphères (et dans leur grande loge). Dugin, dont on parlait pas mal il y a un an ou deux, vient de là aussi. Et surtout, Hitler lui-même était plutôt assez islamophile. Mais malgré tout ça, c'est un courant qui n'a jamais trop accroché auprès du public. L'échiquier politique obéit à une raison stratégique, voire même seulement tactique, avant tout. L'alliance de l'écologisme au progressisme, plutôt qu'au conservatisme, est tout aussi absurde. (et idem concernant l'alliance du libéralisme/libertarianisme au conservatisme...) -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
En 2014, ça avait été quelque chose. -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
La fête des lumières de Lyon était assez décevante, cette année. Au moins deux des animations majeures générées en partie par IA. Que des choses très banales ailleurs. Oh, ils ont projetés la première formulation de l'impératif catégorique sur la cathédrale, ça, c'était marrant. Mais ils ont quand même raté une occasion de citer "Qu'est-ce que les Lumières ?" pour la fête des lumières, quitte à citer Kant... Heureusement que j'ai fêté ça de façon plus traditionnelle ensuite. Je veux dire avec des bougies. (je veux par avec un plan "torture à la cire chaude" à trois) -

Qu'est-ce que la nature ?
Mégille a répondu à un sujet de Domi dans Philosophie, éthique et histoire
Oui, évidemment, reste que quoi qu'en pensent les philosophes, le droit d'une société suffisamment grande va tendre vers la nomocratie, sauf coup de force étatique. Le droit romain est plutôt nomocratique, et le droit commun des cités grecques tendaient sûrement par là aussi (et je pense probable que la théorie politique des sophistes soit aussi allé par là). Je vois la théorie de la justice naturelle de Platon comme une réaction contre ça, justement. La véritable norme, c'est ce qu'il faut pour aller vers le Bien. C'est pour cette raison qu'une punition qui ne vise pas le bien y compris du punis ne peut pas vraiment être qualifiée de juste (Rep I), et que le maintient d'un droit écrit susceptible de borner le gouvernement n'est qu'un attachement fétichiste à des politiques obsolètes (Politique). -

Qu'est-ce que la nature ?
Mégille a répondu à un sujet de Domi dans Philosophie, éthique et histoire
Je n'ai pas lu Léo Strauss (le devrais-je ?), donc une partie de la conversation m'échappe. Je vois deux ou trois choses à dire sur le reste, ici et là, par contre. Ton interprétation de Platon me donne du fil à retorde, @Vilfredo. Je n'ai pas encore pris le temps de me replonger suffisamment dans le texte pour vérifier ce qu'il en est. A (mi-)chaud, j'ai l'impression que tu en mets beaucoup trop du coté de ce qui relève du mensonge ou de l'invention. Le mensonge politique de Platon, comme ses mythes en général, a pour objet de donner une opinion approximativement conforme à la réalité, à laquelle il manque la justesse et la fermeté d'une véritable connaissance, mais qui est tout de même suffisante pour agir de la bonne façon. Le mythe des autochtones est faux, évidemment, mais il me semble que les divisions de l'humanité sont elles réelles, et ce n'est que parce qu'elles le sont que le mythe peut être bon et utile. Si la tripartition de l'humanité était une fiction, il me semble que toute la discussion dans le livre VI sur l'importance toute particulière de bien éduqué (et le risque qu'il y a à ne pas le faire) ceux qui ont un naturel de philosophe n'aurait pas beaucoup de sens. Dans la même veine, après avoir tiré la totalité du mythe et de son contenu dans le logos, pour en faire de la grammaire et de la convention... tu me sembles négliger que pour Platon, le langage est une imitation de la réalité. Une imitation seulement, et pas un véritable double comme selon son Cratyle, mais une imitation tout de même, qui a quelque chose à voir avec son modèle, qui est une imitation en tant que et parce que c'est le cas, et qui en est une plus ou moins bonne, d'imitation, en fonction de sa fidélité au modèle, qui sert donc de norme "naturelle" (con-conventionnelle) au langage. Autre petite chose : attention, que chacun accomplisse la tâche qui lui est propre ne signifie pas que l'on ne doit pas s'occuper de ce que font les uns les autres (Platon met bien en garde contre cette interprétation de cette maxime dans le Charmide), et en se qui concerne la vertu de modération par exemple, elle consiste non pas à ce que la concupiscence/les producteurs s'occupe elle-même/eux-mêmes de ses affaires, mais à ce que la raison/les gardiens la dirige correctement à l'aide de l'irascibilité/des auxiliaires. Sur Platon et le droit naturel en général : il y a bien une justice naturelle (non-conventionnelle) chez Platon, découlant de la nature de l'homme, de la cité, et du besoin de se diviser les tâches, mais elle est assez loin du droit naturel de Locke ou de Rothbard. Non seulement parce qu'elle n'est pas un droit individuel, mais surtout parce qu'elle est intrinsèquement "téléocratique" et non "nomocratique". Elle ne consiste pas à déterminer ce qui peut ou non être fait légitimement, et pas qui, mais directement à aller vers le Bien, individuellement et collectivement à la fois. D'ailleurs, il y a tout une discussion dans Le Politique sur le fait que le gouvernement doit toujours pouvoir changer la loi à sa discrétion, en fonction de ce qui lui semble nécessaire pour produire de bons résultats, et il y compare la volonté de faire obéir le gouvernement à une loi préétablie à une sorte d'attachement fétichiste à une prescription médicale ancienne, même après que le médecin ait changé d'avis en étant mieux informé. A propos des stoïciens : oh, ils avaient bien une politique, et elle a eu un sacrée impact sur l'histoire aussi bien intellectuelle que politique. Si on la néglige (et s'il ne nous en reste pas grand chose, en fait), c'est parce que les stoïciens impériaux étaient un peu gênés à son sujet... A mon avis, en gros, parce que la doctrine politique stoïcienne était extrêmement progressiste (il s'agissait, en gros, d'une sorte d'anarcho-communisme directement issue du cynisme, au moins chez Zénon), alors que les stoïciens romains étaient plutôt conservateurs, et allait piocher des éléments d'éthique stoïcienne spécifiquement pour défendre quelque chose comme la morale traditionnelle romaine contre l'épicurisme. Malgré tout, même si les libéraux ne sont, contrairement à Zénon, pas tout à fait en faveur de l'abolition de la famille, de la propriété privée, des vêtements, et de toutes les institutions, il me semble que c'est bien de ce coté là qu'on trouve les premières racines d'une idée semblable au droit naturel moderne. Le cosmopolitisme cynico-stoïcien, pour commencer, est sans doute ce qui servait de cadre conceptuel aux justifications aussi bien des divers impérialismes hellénistiques puis romains, ainsi à la théorie du droit naturel des juristes romains. Contre Platon et Aristote qui voient la justice naturelle comme intrinsèque, et donc limitée, aux divers cités (que cette justice naturelle soit absolue et la même pour tous chez Platon, ou bien qu'elle soit relative à deux ou trois paramètres chez Aristote), les cyniques et les stoïciens estiment que les limites de la cité appartiennent elles-mêmes aux conventions, et que la justice naturelle ne peut donc être que la justice du monde entier en tant que cité. La justification des impérialismes me semble venir de ce coté là, @Vilfredo : aucun barbare n'est radicalement hors du domaine d'action légitime de l'empire (ou alors, seulement du fait de reliquat de l'ancien droit républicain). L'empereur, en tant qu'empereur, qu'il s'agisse d'Alexandre ou de Constantin, est un candidat à la présidence de la cité-monde. Mais à la fois, ce cosmopolitisme est aussi à l'origine de l'idée qu'il puisse y avoir un même droit qui vaille partout et tout le temps à la fois, indépendamment, et donc potentiellement même contre, les lois d'une cité donnée. Il y aurait aussi beaucoup à dire du concept d'oikeiosis. -

École & éducation : Le temps des secrets
Mégille a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Dans l'ensemble c'est plutôt chouette, oui (malgré quelques bizarreries, je n'ai pas très bien compris cette histoire de prof-IA pour les math et le français). Mais ça reste un plan top-down qui laisse intacte, et suppose la coopération de la bureaucratie intermédiaire qui est en bonne partie la cause des problèmes. Et puis, j'attends de voir les mesures pour remédier au mauvais niveaux des profs (formation et rémunération). Cette génération là, au moins, est clairement identifiable. On part d'un phénomène démographique précis (bien qu'un peu flou sur la fin... encore que, j'ai envie de dire que n'est plus boomer celui qui est enfant de boomer), à peu près de la durée effective d'une génération, et qui a eu des manifestations politiques et culturelles visibles (mouvements de jeunesse de la fin des années 60). Rien de tel avec les nouvelles "générations". Et puis, dans quelques années, quand on commencera à parler de "génération beta", les nouveaux parents en fin de trentaine auront trois "générations" d'écart avec leurs enfants. wtf -

École & éducation : Le temps des secrets
Mégille a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Le découpage des générations Y/Z/alpha est absurde. Sans même parler de leur essentialisation (qui cache souvent une confusion entre la génération et l'âge dans ce qui fait la généralisation), on se retrouve avec des "générations" de plus en plus courtes (moins de 20 ans !) alors que l'on fait des enfants de plus en plus tard. Conséquence, sans doute, de l'esprit journalistique qui est impatient de parler de nouveaux phénomènes. -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Ca par contre, c'est hilarant à faire. Surtout au bar, tard, en ajoutant un "jolie bite". Attention par contre à ne le faire qu'à des personnes moins musclées que soi.