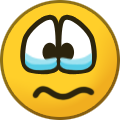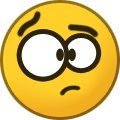-
Compteur de contenus
6 232 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
35
Tout ce qui a été posté par Mégille
-

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
Au passage, on lit ici et là qu'il s'agirait d'un hôpital chrétien, et donc a priori pas affilié au Hamas. -

Belgique, garnaalkroketten, stoemp & mitraillette
Mégille a répondu à un sujet de poney dans Europe et international
Le crime est contagieux socialement. Idem, les fusillades de masse aux USA viennent rarement seules, chaque tueur est souvent suivi par une petite série d'émules. Les images fortes ont souvent cet effet. Peut-être même que c'était le but délibéré de l'attaque du Hamas. -

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
J'ai surtout l'impression qu'il va me vendre une machine à café. -

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
Il y a un petit moment que l'Islam est son deuxième sujet préféré, et sans doute sa deuxième cible préférée après les écolos... -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Tu veux dire, celui qui aurait lieu après l'hyperinflation du dollar et l'effondrement de l'économie de marché, comme ce qui a généralement lieu lors des effondrements civilisationnels ? -
Bienvenue ! tu frappes à la bonne porte, les forums à l'ancienne, et celui-ci en particulier, sont, je trouve, beaucoup plus adapté à des conversations construites et intéressantes que beaucoup d'autres réseaux. N'hésite pas à t'adresser à moi si jamais tu as des questions sur le fonctionnement du forum, ou besoin de médiation face à la modération !
-

Polyamour, PUA ou comment lever de la belette woke
Mégille a répondu à un sujet de Rincevent dans La Taverne
Qui a dit que ça ne marche pas ? La question était "pourquoi ça ressemble à toutes les histoires qui disent que ça ne marchent pas". Collectionner les faits divers, qui passent par une série de filtres (on aime bien les histoires de gens pas comme il faut, qui finissent effectivement soit punis soit eux-mêmes monstrueux), ce n'est pas tout à fait suffisant pour établir une loi anthropologique. Et après, s'il suffit d'une personne de 24 ans qui traverse une petite difficulté dans sa vie de trouple (mais sans pour autant avoir à changer de modèle relationnel) pour dire que le polyamour est un échec, alors, tenez vous bien, parce que la monogamie pourrait prendre cher aussi... -

Images pas cool, justice sociale & steaks saignants
Mégille a répondu à un sujet de Lancelot dans La Taverne
Ont-ils prévu d'arrêter de payer les haredim pour baiser ? Si non, alors, ils prévoient toujours d'utiliser le radicalisme religieux pour la guerre des ventres. Il y a trois scénarios possibles. A l'Américaine : après un long quasi-génocide, les indigènes se retrouvent enfermés dans des réserves, et l'occasionnel rappel qu'ils étaient autrefois les propriétaires des lieux ne sert plus à rien d'autre qu'à se donner bonne conscience, sans menacer l'état. Victoire israélienne. A l'Algérienne : suite à un déchainement de violence et à une perte de soutient international, les colons, mêmes installés depuis de nombreuses générations, et malgré leur supériorité économique, sont expulsés. Victoire palestinienne. A la Sud-Africaine : les uns acceptent les "nouveaux venus", les autres arrêtent d'être nazis... Ces trois scénarios ont déjà eu lieu quelque part, et les trois doivent être jugés au moins "possibles" en ce qui concerne l'Israël-Palestine (quelque soit celui qui nous semble le plus probable). Israéliens et palestiniens se battent pour une résolution soit à l'Américaine, soit à l'Algérienne, et les deux ont très bien compris que la principale variable qui déterminera l'issue est la démographie. D'où le conservatisme religieux, stratégiquement efficace pour ça. Lutter pour une troisième solution implique donc à la fois de lutter contre cette machine là, des deux cotés à la fois. Et les Queers for Palestine sont plutôt du bon coté dans l'histoire. -

Images pas cool, justice sociale & steaks saignants
Mégille a répondu à un sujet de Lancelot dans La Taverne
On peut tout à fait condamner le Hamas et l'islamisme sans pour autant approuver tout ce que fait Israël. En se moquant des quelques rares troisièmes partis, on contribue à s'enfermer dans ce sale dilemme. -

Polyamour, PUA ou comment lever de la belette woke
Mégille a répondu à un sujet de Rincevent dans La Taverne
Les milieux poly sont, je crois, généralement plus safe en matière d'IST que le milieu des plans tinder par lequel passent même la plupart des monos. Les IST sont un sujet qui est ouvertement, et souvent discuté, et à peu près tout le monde prend des mesures de sécurité à la hauteur des risques encourus, et en averti les autres (dépistages fréquents, prep, etc...). A cause de l'impact idéologique de la mono-normativité. 1/ le polyamour, c'est entretenir plusieurs relations amoureuses construites en même temps, de façon ouverte et cadré. C'est assez loin de la promiscuité généralisée, qui est loin d'être spécifiquement lié au polyamour. 2/ Je suis plutôt content d'aller vers une société où les femmes n'en sont pas réduite à utiliser leur sexualité comme unique moyen pour "négocier" ce dont elles ont besoin. -

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron
Mégille a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société
Il est (pour l'instant) le successeur idéal pour Macron. Image de marque de parti du jeune dynamique maintenue, moins droitard que Darmanin, probablement moins con que Le Maire, et il attirera forcément quelques attaques homophobes et antisémites qui seront facilement médiatisables à son avantage. Dommage, parce que Philippe est sans doute légèrement mieux (j'ai encore un tout petit espoir qu'il reste quelques goutes de libéralisme dans celui-là). Mais de toute façon, il risque d'être beaucoup trop Kiki pour gagner. -
J'ai prévu de compter sur l'ordre spontané.
-

Images pas cool, justice sociale & steaks saignants
Mégille a répondu à un sujet de Lancelot dans La Taverne
Ceci dit, malgré le coté un peu ridicule de la situation, et les airs d'idiots utiles de Queers for Palestine, ils tapent assez juste. Le conservatisme religieux et familial est au centre de la guerre des ventres entre les deux camps. Proposer une alternative libérale (au sens très large de : pas conservateur religieux fanatique, et en incluant les woke inch'allah) est à peu près la seule façon d'espérer une résolution qui ne soit pas un drame humain. Et il y a quelque chose de noble à se battre pour une cause dont on sait que les représentants ne nous le rendraient pas. -

Attaque du Hamas & répercussions
Mégille a répondu à un sujet de Freezbee dans Europe et international
Lors des élections législatives palestiniennes de 2006 (les dernières à avoir eu lieu), le Hamas a été largement majoritaire un peu partout. La prise de pouvoir du Hamas à Gaza (et la séparation en deux de la Palestine) est la conséquence de ça, et aussi, du maintient au pouvoir du Fatah à Ramallah, sans considération démocratique (il n'y a plus eut d'élection palestinienne depuis, que je sache), et avec la bénédiction, ou au moins la clémence, d'Israel et de l'occident (on comprend pourquoi). Il y a un bout de temps que le Fatah, et avec lui la "solution à deux états", ne représente plus personne, et n'est plus rien d'autre qu'un interlocuteur fantôme pour qui veut prétendre parler à la Palestine, qui permet à la fois à Israel de maintenir l'ambiguïté dans ses relations palestiniennes, et donc le statu quo (et donc, en fait, faire avancer son projet de conquête à long terme), et à la fois à la gauche internationale de se mentir à elle-même en croyant avoir des amis là bas. Il faut aussi se souvenir que l'avant-garde révolutionnaire quasi-léniniste qu'était le Fatah à ses origines n'a jamais représenté grand monde, ni fait beaucoup de bien à qui que ce soit. C'est la première Intifada (avec laquelle il n'avait rien à voir, voire à laquelle il était plutôt hostile avant de se l'approprier) qui avait permis une brève amélioration de la situation des Palestinien, jusqu'à la seconde... Le Hamas au contraire est un pur produit des Intifadas et de la vindicte populaire. On comprend donc, malheureusement, le plus grand soutient populaire des palestiniens au Hamas. Toujours pour le contexte, on peut rappeler que le Hamas (comme les Talibans, mais contrairement à l'EI et à Boko Haram) est bien intégré au réseau des Frères Musulmans, et donc, tout en étant islamiste (avec l'Islam pour programme politique) et très radical, n'est pas pour autant Salafiste (hostile aux institutions musulmanes établies). On ne peut donc pas s'attendre à une condamnation massive de tout ça par les principales autorités intellectuelles et morales musulmanes du monde. Outre la future escalade en Israël-Palestine qui risque d'être un carnage pour tout le monde, ce qui m'effraie le plus est le risque de contamination de la violence y compris chez nous... L'autre point important à remarquer, je crois (bien plus que le futur des briques dont honnêtement, osef), est la nouvelle confirmation de l'obsolescence de la dualité chiite vs sunnite comme grille de lecture principale des tensions internes au monde musulman. Enfin, j'ai hâte de voir les réaction du Maroc, des EAU, et de l'AS. -
Habile, mais sans aller jusqu'au coastline paradoxe, j'ai bien peur qu'à l'échelle nanométrique, le grain de peau de mes amis fait qu'ils ont eux aussi une plus grande surface. Ah, tu comptais venir à ma liquid love ? Bon, j'ai pris 10L, j'espère que ça suffira.
-
Hypothétiquement, si vous souhaitiez recouvrir d'huile une dizaine de personnes... Combien de litres prévoiriez vous ?
-
Mais y avait-il des punaises de lit ?
-

Lisnard 2022 : le libéral de la Croisette
Mégille a répondu à un sujet de NicolasB dans Politique, droit et questions de société
Les concepts universels et cosmiques que vous cherchez pour décrire le cycle des prez sont "bouba" et "kiki". -

The Baby Bust
Mégille a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Mes partenaires soit n'en veulent pas, soit n'ont pas d'assez bons gènes (pas hpi, ou bien prédisposition à une maladie). Et de toute façon, aucune n'est soit suffisamment riche pour que je puisse éduquer l'enfant seul, soit suffisamment libérale pour que je veuille éduquer un enfant avec. -

Revenu universel, libéral-compatible ?
Mégille a répondu à un sujet de Nigel dans Philosophie, éthique et histoire
Le RU n'a pas forcément vocation à rendre obsolète l'épargne, les assurances, l'aide des proches et des associations, qui viennent s'y ajouter. Au moins le RSA, le chômage, les allocations familiales et la retraite publique. +1 J'aime bien cette idée. On pourrait aussi imaginer que l'état se contente de fixer la somme totale distribuée, et qu'elle est divisée par le nombre de demandeur chaque année. Ca me semble encore mieux pour dissuader, ça fait appel à un sentiment meilleurs et plus proche de l'enjeux ici. Bien entendu, dans tous les cas l'argent est pris aux autres, mais ce serait d'autant plus visible de cette façon. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Mégille a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Pourquoi ne pas dire deux sexes ? C'est plus une question de rôle social, et d'intériorisation dudit rôle. Il y a quelque chose comme un choix stratégique là derrière, chez Butler en tout cas. L'idée est qu'on est pas capable de faire oublier à tout le monde un truc aussi gros que les significations qu'on a attribuées aux sexes (ou aux groupes sanguins dans ton image), alors, on secoue les normes et les représentations dans tous les sens afin qu'elles finissent par ne plus rien vouloir dire. Bien sûr que si, les trans n'ont pas été inventés au cours des 10 dernières années. Simplement, on en parlait beaucoup moins, et il était plus difficile pour eux de se réunir, de communiquer, et de s'affirmer publiquement. Peut-être qu'un effet de mode vient s'ajouter à ça par dessus aujourd'hui, mais peut-être que c'est juste un grand coming out. Il y avait officiellement beaucoup moins de gauchers lorsque les gauchers devaient cacher leur particularité. Ce n'est pas pour autant qu'écrire de la main gauche est une mode. "Intersexe" ne signifie pas "hermaphrodite fonctionnel" (ce qui n'existe pas chez l'humain), mais plutôt une ambiguïté au niveau des autres caractéristiques associées au sexe. (Ce qui est assez flou, en fait, mais puisqu'on fait entrer, de façon tout aussi flou, ces autres caractéristiques dans notre perception du sexe, ce n'est pas tout à fait illégitime) -
tu veux dire : stop à la mot-valiseflation ?
-

Le gouvernement Borne to be alive dépassera-t-il les limites ?
Mégille a répondu à un sujet de Pelerin Dumont dans Politique, droit et questions de société
C'est parce que LR est simplement en " |opposition ". -

Revenu universel, libéral-compatible ?
Mégille a répondu à un sujet de Nigel dans Philosophie, éthique et histoire
Historiquement (mais ça répond d'autant moins à la question de Bisounours), on peut aussi compter Paine, auquel les minarchistes doivent leur "l'état est un mal nécessaire", qui était en faveur d'une allocation universelle. -
Punaise + merde, pour le moment où le farceur se met le doit à la bouche. Le risque de septicémie rend ça pas très sympa, mais puisque le point de comparaison est un headshot...