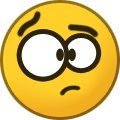-
Compteur de contenus
21 685 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
87
Tout ce qui a été posté par Bézoukhov
-
Roooh. C'est très nouveau tout ça. Le truc avec la politique étrangère française depuis une trentaine d'années, c'est qu'elle a arrêté d'être réfléchie comme "nous cherchons à défendre les intérêts de la France dans tel domaine / à tel endroit", mais comme "cherchons un truc conceptuel qui permettra de créer des nouveaux postes de hauts fonctionnaires dans une institution nationale ou internationale".
-

[Sérieux] Grand remplacement et petite frite
Bézoukhov a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
Je ne comprends pas ce que tu cherches à dire. Tu sautes directement à une suggestion de conclusion politique. Alors que la première étape, c'est déjà de décrire ce qui se passe. Ce qui s'observe dans des statistiques diverses et variées, mises bout à bout, donne l'image d'une "archipellisation" de la société française. Cette archipellisation n'est pas exclusivement la conséquence des phénomènes migratoires qui battent l'Europe depuis 50/70 ans ; elle est, aussi, la conséquence de ce que Renaud Camus appelle le "Petit Remplacement", pour rester dans le thème. Mais une partie notable des îlots est aujourd'hui une conséquence de l'immigration. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Bézoukhov a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Ah, oui je viens de découvrir le débat sur les Female Space Marines. Pas merci -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Bézoukhov a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Nan, mais ça je sais. Les seuls wokes que j'ai croisé en chair et en os viennent des milieux nerds proches du JdR. Enfin, ils doivent tous être dépressifs dix ans plus tard au vu de leurs postes facebook. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Bézoukhov a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Y a des gens qui ont joué au delà de la 3.5 ? -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Bézoukhov a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Haha ce commentaire You know what else is a problem? The concept of classes. It's inherently, unavoidably classist. Why CAN'T my wizard be a fighter if he wants to? Why do I need to "change my class" just for that? Let's get rid of them. Then there's attributes. This whole idea that one person might be inherently better than someone else. Utterly ableist, get rid of those too. Same for skills. Just because you practiced something doesn't mean you're necessarily better than someone less experienced. Maybe they bring a unique perspective to the problem and that can't be reflected in some educationalist "skill" system. Have you thought of that, that you might be denying my characters live experiences with this? Too problematic, axe it. Levels too. Oh my god, I can't even with levels. Just because some colonizer MURDERED the orcs trying to ethnically diversify the village and I didn't doesn't mean they should get an extra attack per turn (don't even get me STARTED on turns, what an outdated white patriarchal concept, that someone gets to GO FIRST). Ug, and magic. Like, one type is inherently tied to toxic religious conformity and the other to some kind of nebulous Fascistic concept of mystical eugenics. Throw that out. Also dice are sexist. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Bézoukhov a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Les demi-elfes et demi-orcs sont supprimés de D&D à la demande des sensitivities readers parce que c'est raciste : https://boundingintocomics.com/2023/04/04/dungeons-dragons-to-remove-half-species-from-players-handbook-claims-entire-the-entire-idea-is-inherently-racist/ (alors que j'aurais cru, que pour les demi-elfes, c'était parce que c'était homophobe, mais bon) -

Rassemblement national, el-italiano93 l'avenir ?
Bézoukhov a répondu à un sujet de Adrian dans Politique, droit et questions de société
The point.- 3 229 réponses
-
- front national
- extreme droite
-
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
-

Rassemblement national, el-italiano93 l'avenir ?
Bézoukhov a répondu à un sujet de Adrian dans Politique, droit et questions de société
La règle c'est que c'est jamais ce qu'on a prévu qui arrive.- 3 229 réponses
-
- 3
-

-
- front national
- extreme droite
-
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
-

Incompétence de la RATP pour gérer un métro sans conducteur
Bézoukhov a répondu à un sujet de ali m'gregor dans Actualités
C'est a quel moment que la haute fonction publique a oublié de financer l'exploitation des lignes du Grand Paris ? -
C'est moi où les ruptures d'essence qu'il y a actuellement ne font même plus la une et sont perçues comme normales ?
-

Bureaucratie, management public, qualité des services publics
Bézoukhov a répondu à un sujet de Largo Winch dans Economie
J'ai l'impression que tu as édité en même temps que j'ecrivais, donc je n'ai pas vu tout ton message :). La question que je pose en sous-jacent est : qu'est-ce-qui ne fonctionne pas dans le droit de regard aujourd'hui ? -

Bureaucratie, management public, qualité des services publics
Bézoukhov a répondu à un sujet de Largo Winch dans Economie
Le propos est surtout que le blocage intervient surtout au moment où il faut communiquer. Et que ce n'est pas un blocage légal, mais un blocage social qu'on a du mal à définir. Tu confonds scandale et mensonge. -
Tiens. Vous saviez que si je dis, un jardin horticole d'un yard, les trois mots ont la même racine en indo-européen ? Maintenant, faut que j'essaie de trouver la plus longue expression avec un sens qui n'utilise que des mots différents ayant une même racine étymologique.
-

Bureaucratie, management public, qualité des services publics
Bézoukhov a répondu à un sujet de Largo Winch dans Economie
Il existe. Le problème c'est que le mensonge assumé n'entraîne plus aucune sanction (je vous épargnerai les exemples). Ca ne sert à rien de pouvoir surveiller le pouvoir et le mettre devant ses manquements et contradictions si toutes vos remarques tombent, au mieux, dans l'oreille d'un sourd, et, au pire, vous valent d'être mis au ban de la société comme raciste / climatosceptique / antivax / complotiste ou que sais-je. -

[Sérieux] Grand remplacement et petite frite
Bézoukhov a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
Dilution dans le sens "création d'un mélange homogène" (qui n'est pas forcément de l'assimilation). Disons que pour reprendre le vocabulaire du XXème siècle, la dilution va de l'assimilation au melting pot. Et quand on se rend compte que le melting pot a raté, on invente le concept de salad bowl. Ca doit faire dix ans que Tribalat écrit. Fourquet (sur une problématique un peu plus large, certes) depuis au moins cinq ans. Les chiffres sont disponibles pour qui veut les lire. -

[Sérieux] Grand remplacement et petite frite
Bézoukhov a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
Le but c'est de comprendre ce que veut dire "dilution" quand les statistiques disent l'inverse, sans sauter aux conclusions politiques immédiatement. -

[Sérieux] Grand remplacement et petite frite
Bézoukhov a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
Y a combien de roms immigrés en France ? C'est l'épaisseur du trait. Les clubs de bridge de retraités britanniques dans le Sud-Ouest sont une vraie menace. L'avantage, c'est que c'est une menace qui ne durera pas longtemps. -

[Sérieux] Grand remplacement et petite frite
Bézoukhov a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
Oui. Même la gauche est obligée de l'avouer aujourd'hui. C'est pour ça que Mélenchon est passé à la "créolisation", c'est-à-dire à : Et ça, je ne vois toujours pas par quels chiffres c'est justifié à part des arguments d'autorité de Le Bras. La vérité, c'est que les immigrations européennes sont aujourd'hui presque indiscernables de la population générale (exception à l'immigration portugaise), qu'on a peu de recul sur l'Afrique Subsaharienne qui est récente, et que les immigrations maghrébines maintiennent une forte pratique religieuse (vu passer dans les chiffres de l'INSEE) et endogamie (pas regardé dans le détail si ils l'ont fait dans cette étude, mais je vois pas pourquoi ils trouveraient quelque chose de différent). Très très simplement, quand vous avez des populations qui choisissent des prénoms au sein d'espaces radicalement différents pour leurs enfants, et qui ont des pratiques funéraires différentes, j'ai du mal à comprendre comment on peut parler de "dilution". -

[Sérieux] Grand remplacement et petite frite
Bézoukhov a répondu à un sujet de Lancelot dans Philosophie, éthique et histoire
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Moui. Hervé le Bras a toujours un peu de mal à différencier entre l'analyse scientifique et l'analyse politique. -

Le gouvernement Borne to be alive dépassera-t-il les limites ?
Bézoukhov a répondu à un sujet de Pelerin Dumont dans Politique, droit et questions de société
Moi, j'arrive toujours pas à critiquer Marlène Schiappa. C'est vraiment la meilleure de LREM. -

Police, dérive, excès de zèle & toute-puissance étatique
Bézoukhov a répondu à un sujet de Hayek's plosive dans Politique, droit et questions de société
La Révolution. Mais sans risque personnel. -

Police, dérive, excès de zèle & toute-puissance étatique
Bézoukhov a répondu à un sujet de Hayek's plosive dans Politique, droit et questions de société
Lol. Glandu et Glandette n'ont aucune légitimité pour mener une enquête à charge, encore moins en menant l'interrogatoire de l'opérateur du SAMU, qui aurait sûrement mieux à faire qu'être l'objet de la compol de LFI. We are not in Hollywood. Vraiment, ces deux guignols mériteraient 10k€ d'amende et 6 mois de sursis pour leur expliquer ce que c'est d'emmerder le SAMU pour rien. Mais on ne le fera pas parce qu'ils font partie des personnes autorisées. Et il y a bien manipulation vu que tu écris toi même t'être fait manipuler. Je doute que ces professionnels de l'agitprop découvrent aujourd'hui les rôles et responsabilités des pouvoirs publics lors d'une émeute. Ils le font croire afin de ne pas poser la question à la seule personne qui décide. -

Police, dérive, excès de zèle & toute-puissance étatique
Bézoukhov a répondu à un sujet de Hayek's plosive dans Politique, droit et questions de société
Autant pour moi, il l'a bien dit. Et ferait mieux de faire plus attention à sa communication sur le sujet. Après ça ne change pas le fond de ce que je dis. La LDH se déshonore à ce genre de manipulations.