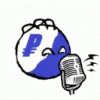-
Compteur de contenus
6 230 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
35
Tout ce qui a été posté par Mégille
-

Anarcho-capitalisme VS Libéralisme / Minarchisme
Mégille a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Hobbes venait de voir pas mal de bordel an Angleterre, donc on peut lui pardonner... mais il me semble que même sans léviathans, des individus libres peuvent avoir intérêt à respecter les autres. Tu butes un type pour lui prendre son poisson, tu auras tout son poisson immédiatement, mais tu n'en auras peut-être plus jamais, à moins de toi même te mettre à pêcher au lieu de faire autre chose. Tu lui échange des fourrures contre son poisson, et tu peux t'assurer d'un apport beaucoup plus régulier en poisson (en sachant que notre pêcheur est probablement dans la même situation d' "intérêt au respect", puisqu'il consent à l'échange plutôt que de tenter de te tuer). De plus, tu envoies un "signal de vertu" qui te permettra de plus facilement interagir avec d'autres individus. Dans ce processus, personne n'a eu besoin de renoncer à sa liberté. Pour Hobbes, les hommes ont intérêt à la paix, mais à la condition que tout le monde renonce à l’agression. J'ai tendance à croire que de la même façon qu'un pays a intérêt au libéralisme même quand tous ses voisins font du protectionnisme, un individu libre peut avoir pour lui-même intérêt à respecter les autres. Et plus la division des tâches est importante, plus c'est vrai. Cependant, comme je le disais, on a deux problèmes : ça ne garantit que la paix en général, et de plus, les différents, même s'ils seront souvent réglé par arbitrage, le seront sans doute en faveur des individus ou des groupes les plus aptes à gagner un conflit violent. On peut espérer régler ça avec une justice régalienne, mais j'ai peur que ça laisse subsister à peu près les mêmes problèmes. J'en suis à espérer des juges libres et impartiaux, sans monopole de la force, mais c'est peut-être utopiste. Why not ! J'envisageais trois façons de désigner les juges : la démocratique (la tienne notamment), la corporatiste (diplôme/cooptation) et la libérale. Je suis pour la libérale, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que la coutume, qui fixe la forme des procès, fasse des concessions aux deux autres formes, ce qui n'est pas forcément un mal... la corporatiste à l'avantage de garantir la compétence, la démocratique de conférer une plus grande légitimité. Mais les deux ont le défaut de biaiser les jugement. Il me semble que le mieux reste un système mixte. Donc un jury populaire permettant de gracier en instance suprême... oui, ça me semble bien. Les formes exactes devront émerger d'elles mêmes et ne peuvent pas être planifiée, mais celle-ci serait un bon choix, de toute évidence. @Johnathan R. Razorback, je te réponds tout de suite. -

Anarcho-capitalisme VS Libéralisme / Minarchisme
Mégille a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire
Comme je le disais à dans l'autre fil, l'anarchie libérale ne serait pas forcément une violence généralisée, puisque la plupart du temps, les gens auront sans doute (tous, individuellement) intérêt à régler leurs problèmes de façon douce. Une lutte meurtrière est un jeu à somme négative, et l'augmentation de la puissance des armes d'une part, et du besoin de stabilité engendré par le capitalisme libre d'autre part, tout ça fait qu'un recours à la violence représente un coût ou un risque très élevé, que les agents rationnels éviteront presque systématiquement. Cependant, deux problèmes subsistent : - Il s'agit d'une simple généralité. Même si on peut être rationnellement poussé à croire que les conflits se régleront la plupart du temps par des arbitrages, il semble inévitable qu'occasionnellement, lors d'un différent, un parti estime (avec raison ou non) préférable de le régler par la violence plutôt qu'en se soumettant à un arbitrage. Ce sera donc au mieux une société non-violente la plupart du temps. - l'égalité de droit ne sera probablement pas respectée. En effet, les individus et les organisations ayant le plus de chance de "gagner" un conflit violent à moindre coût pourront s'attendre à avoir des arbitrages biaisés en leur faveur (parce qu'autrement, ils peuvent -plus que les autres- se permettre de ne pas consentir à l'arbitrage). Mais avant de déduire de ces deux (graves, je trouve) problèmes qu'une société étatisée est préférable à une société non-étatisée, il faut montrer que ces problèmes ne se retrouvent pas (ou plus humblement, qu'ils se retrouvent moins souvent) lors de l'existence d'un monopole de la violence, ce qui n'est pas si facile que ça. Sinon, voilà ma vision idéale de la société : tout d'abord, des Etats les plus petits possibles, si possible restreint à la superficie d'une ville/d'une agglomération urbaine, éventuellement réunis en confédérations. Découlant nécessairement de ça : un très grand pluralisme politique, avec des cités socialistes, d'autres libérales, des démocraties et des aristocraties, des conservatrices et des progressistes, etc. Je ne pense pas que l'on puisse empêcher l'arrivé de leaders charismatiques, ou de certaines erreurs qui relèvent presque d'un atavisme hayekien innée. Donc autant se contenter de les circonscrire le plus étroitement possible. Quant aux bonnes cités, les libérales évidemment, il me semble que la meilleure forme qu'elles puissent adopter soit une critarchie, 2/3 anarchiste : Pas d'exécutif. Pas de législatif. Juste des juges. Les juges sont tous autonomes, ils jugent au nom du droit naturel, et selon la jurisprudence et la doctrine. A la façon de chercheurs dont les travaux sont toujours exposés aux critiques de leurs pairs, les juges veillent les uns sur les autres et s'assurent qu'aucune erreur n'est faite. Pour justifier leurs verdicts, ils s’appuieront sur les travaux des juristes, qui eux même non seulement compilent la jurisprudence mais aussi la commentent, en s'éclairant des travaux des philosophes. On a ainsi une justice "peer review", qui émet sur le plan prescriptif un discours analogue à celui descriptif des sciences, par opposition à la justice régalienne, qui est plutôt analogue à un dogme officiel rendu obligatoire par une autorité centrale. La sécurité relève du privé. Les hommes libres et les différentes agences de sécurités respectent tout de même le droit naturel (et, s'ils sont prudents, consultent donc leurs avocats avant d'agir dangereusement...). Ne pas le faire revient à s'exposer à une condamnation de la communauté des juges, et donc, à s'exposer à la menace de coercition de la part de tous les autres citoyens/organisations de citoyens en mesure de se défendre. Pour que tout cela tienne, il faut que l'on ait intérêt à "gagner" un procès. Il faut s'attendre à ce que des "sycophantes" s’immiscent dans la société et suscite une désapprobation de certains, mais leur rôle est fondamental. Les jugent doivent avoir intérêt à "coincer" leur confrère qui ne jugeraient pas conformément au droit. Il faut que le travail de juge soit rentable, autrement, pas d'autonomie. La victime doit réparer le tort commis à la victime ainsi qu'au juge, que le criminel a en quelque sorte contraint à travailler. Mais je doute que le simple principe de l'amende soit suffisant pour ça (ne serait-ce que pour les insolvables), et de plus, la prison est une dépense inutile. Il faut donc restaurer l'esclavage. Ou au moins, une servitude, comprise comme un usufruit sur la personne du coupable (qui garde la nu-propriété de lui-même), dont les termes et la durée seront déterminés par le procès. C'est à dire, en quelque sorte, de "travaux d'intérêt public privés", dont le droit de jouir pourrait être loué ou vendu. A propos de la nomination des juges, on peut imaginer un système démocratique (élection / tirage au sort), ou encore un système corporatiste (cooptation / diplômes délivrés par quelques grandes écoles de droit). On peut aussi envisager un système véritablement libéral, ou n'importe qui peut décider de faire office de juge. Bien sûr, la jurisprudence prescrira non seulement l'issu des procès, mais aussi leur forme. Il me semble évident, par exemple, que contrairement à un arbitrage qui peut être livré à la discrétion des partis, un jugement doit être rendu de façon public, exposé au regard et à la critique des autres juges et des savants. Dans l'autre fil, on parlait de la confiance nécessaire de la part des gens. Il s'agit juste d'un minimum de respect de la loi, sans laquelle un Etat, même très musclé, ne peut pas vivre. Je ne pense pas que la critarchie demande plus. A propos de la différence entre la critarchie et l'anarco-capitalisme : il n'y en a peut-être pas. La différence que je vois est le juge, qui n'est pas un simple arbitre, puisqu'il est contraint par le droit naturel (la légitimité de la jurisprudence découle logiquement de l'isonomie, qui relève du droit naturel) et qu'il a le pouvoir de décréter qu'un cas particulier d'usage de la coercition est légitime ou non. Cependant, il est tout à fait possible qu'une trop grande méfiance, un trop grand mépris pour la liberté des autres, etc, rende les juges obsolètes et fasse que ma belle utopie devienne une anarchie avec les deux tares que j'ai remarquée au début (violence occasionnelle et non-isonomie). De plus, inversement, il est vraisemblable qu'en anarcapie, les sociétés d'arbitrage aient intérêt à se donner les apparences d'une légitimité naturelle pour séduire les clients, faisant tendre l'anarcapie vers une copie de la critarchie. Donc critarchie et anarchisme sont peut-être concrètement équivalent... je n'en suis pas sûr. Mais abstraitement, l'idée de critarchie me semble différente de celle de "société de droit privée", et c'est de la première seulement que je me revendique. -

anarcapisme et développement
Mégille a répondu à un sujet de Mégille dans Politique, droit et questions de société
Grave ! Mais bon, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que vibranium ou pas, un truc comme Wakanda a plus de chance de voir le jour dans une cité libéral que dans un royaume autoritaire et isolationniste. Pour le reste, go sur l'autre fil, j'arrive. -

anarcapisme et développement
Mégille a répondu à un sujet de Mégille dans Politique, droit et questions de société
Nope, sinon, ce ne sont pas des juges. Ce sont les gens eux mêmes et des organisations libres qui font respecter eux même leur droit (ou de ceux qui sollicite leurs services de sécurité), dans le respect des jugements émis par les juges. Effectivement, si les gens n'ont plus aucune vertu, cesse d'avoir confiance les uns en les autres, et tous ensemble au droit naturel, c'est à dire, à une "bonne" manière de régler leur différent, ça ne tiendra pas*. Mais je pense que de toute façon, aucune forme d'organisation ne peut tenir sans un minimum de vertu et de bonté, l'étatisme pas plus que le reste. Donc mon choix numéro 1 reste la critarchie. Reste à voir si en deuxième place vient l'anarchisme ou le régalisme. Il me semble que qu'un anarchisme pur, qui n'aurait de justice qu'arbitrale, implique une violence occasionnelle (lorsque l'une des parties d'un conflit estime le coût de la violence inférieure à celui du consentement à l'arbitrage), et un droit inégal, en faveur des personnes physiques ou morales ayant le moins à perdre en cas de conflit violent. Ma question est : est-ce que c'est vraiment différent lorsqu'il y a un Etat ? * On peut aussi dire : si tout le monde se fiche de l'avis des juges, des juristes et des philosophes. Mais on peut aussi, à ce compte là, imaginer une société dystopiques où les gens se fichent de l'avis des hommes de science en général. Pourtant, la plupart du temps, on leur fait confiance, même lorsque ça ne sert à rien et que ça n'a pas d'implication technologique (par exemple, aux paléontologues... ). -

anarcapisme et développement
Mégille a répondu à un sujet de Mégille dans Politique, droit et questions de société
Oui, je ne me fais pas plus d'espoir pour le Sénégal que pour où que ce soit d'autre... mais bon, j'aime bien expliquer des trucs aux gens. Et puis, si je réussi tout de même à convertir D. au libéralisme, je lui briserais tout espoir de réussir sa carrière politique. Ce qui serait une bonne chose pour lui, puisque devenir un tyran, c'est mal. Ceci dit, les Etat d'Afrique sont plus fragile que les autres, et une dés-étatisations est peut-être plus facile là bas qu'ici. Croyez-vous que les Etats d'Afrique doivent leur existence (je veux dire, pas que historiquement, mais aussi leur maintient, leur existence continue) à nos gros léviathans qui tiennent à avoir des interlocuteurs de la même espèce pour que le monde entier leur soit vassalisé ? A ce compte là, ça ne servirait pas à grand chose d'espérer un Wakanda libre, effectivement. Alors, quand je dis "le moins d'état possible", je dis "le moins de coercition possible", donc si "pas d'Etat" équivaut à la coercition généralisé, ce n'est de toute évidence pas ce en faveur de quoi je suis. Mais ce "si" n'est pas si évident. Et puis, si on évite de trop réifier les institutions, on peut considérer qu'on vit déjà dans une guerre civile prolongée, et que les Etats ne sont rien d'autre que les gangs qui gagnent effectivement cette guerre et renouvellent constamment celle victoire militaire en prélevant un tribut. C'était clairement de cette façon que fonctionnait Sparte, avec les homoi qui tous les ans foutaient une grosse raclé aux hilotes pour leur rappeler qui sont les patrons. C'est moins visible ailleurs, mais c'est peut-être un modèle approprié pour penser le reste. J'aurais envie de me dire critarchiste, ou 2/3 anarchiste. On supprime l'exécutif, ne serait-ce que parce que tout ce qu'il fait, il le fait moins bien que ce qui aurait été fait librement autrement (même la sécurité, sans doute). On supprime le législatif, puisque c'est une usurpation du droit naturel qui ne sert qu'à légitimer les félonies de l'exécutif. Et on ne garde que des juges autonomes et autocéphales, qui jugent au nom du droit naturel, selon la jurisprudence et la doctrine (en interagissant avec les juristes et les philosophes), et en se surveillant les uns les autres. Je suis conscient que concrètement, c'est exactement la même chose que l'anarco-capitalisme. Si ce n'est, peut-être, que cette critarchie au sens fort serait un anarcapistan agrémenté d'une confiance générale en le droit naturel et donc d'une certaine vertu civique de la part de chaque personne. Je ne pense pas que ce soit pécher par utopisme, étant donné que 1)* que le niveau de confiance est généralement plus haut dans les pays libéraux, et qu'il est possible que laisser les gens face à leur responsabilité morale favorise la vertu** 2) que sans la confiance de ses citoyens, un Etat n'est rien de plus qu'une faction au sein d'un conflit généralisé (le critarchisme n'est donc pas plus exigent que le régalisme sous cet angle) 3) que sans ça, l'anarcapie serait sans doute effectivement une simple phase violente transitoire avant la formation d'un nouvel Etat par le plus puissant.*** *** sauf si l'on estime que le coût d'un conflit violent est dans la plupart des cas supérieur au coût de consentement à l'arbitrage, y compris pour le plus désavantagé par l'arbitrage. Dans ce cas, on aura une société la plupart du temps non violente, mais avec un droit inégal en faveur de ceux qui ont le plus de chance de gagner les conflits violents (pour compenser la plus grande incitation de ceux-ci à refuser les arbitrages). Ce serait moralement inférieur à ma critarchie idéale, mais pas forcément au régime étatisé, qui n'est lui aussi non violent que la plupart du temps, et qui implique lui aussi un droit inégale en faveur de celui qui a le plus de chance de gagner les conflit violent, à savoir l'Etat et ses représentant. ** oui, au fond de moi, je reste platonicien : je m'interroge sur le système qui rend les gens meilleurs, mais en ayant pris acte que nous sommes dans une société ouverte, et je pense la justice sur le modèle de la science, mais en ayant pris acte que celle-ci est plus fiable par une recherche décentralisée et revue par les pairs que par un dogme fixe. * oui, j'ai mis des numéros que pour te gêner quand tu vas toi même tenter de numéroter mes phrases ! Désolé pour le très gros HS ! je suis surpris qu'il n'y ait pas de fil "état minimal vs anarcap" ceci dit. Est-ce un sujet tabou, comme l'avortement ? -

anarcapisme et développement
Mégille a répondu à un sujet de Mégille dans Politique, droit et questions de société
(je précise que je réfléchis à ça entre autre parce que j'ai récemment discuté avec un ami sénégalais qui envisage de se lancer en politique là bas. Etant donné qu'il a été salement amoché idéologiquement par la fac de philo française, je lui ai vendu autant que possible -plutôt bien, je crois- l'importance de la défense des droits individuels et d'un état non interventionniste, mais je me suis par la suite aperçu que j'avais encore peu réfléchi au rôle de l'Etat pour les pays en développement dans une perspective libérale/libertarienne) Je te remercie ! J'avais déjà lu celui sur Singapour et celui sur la NZ, mais pas celui sur Cowperthwaite. Tout ça est suffisant pour montrer qu'un pays même peu développé à tout intérêt à être le plus libéral possible, mais je m'interroge si on peu aller jusqu'à leur recommander "débarrasser vous de l'Etat pendant qu'il en est encore temps !". De plus, Hong Kong s'est construit et vis toujours en ayant pas à se soucier de la défense, toujours assurée par un Etat de très grosse taille, et Singapour, tout libéral qu'elle soit, n'y va pas de main morte sur le régalien. +1 Vouloir le moins d'Etat possible implique de vouloir qu'il n'y ait pas d'Etat du tout si cela s'avère possible ! (l'anarcapisme est donc un cas particulier de minarchisme... /troll) -
Les pays d'Afrique ayant gardé une agriculture traditionnelle deviennent soudainement très riches pendant que les végans mangent leurs chats ?
-
Lorsqu'on se permet de rêver d'utopies anarcaps (personnellement, je ne peux pas m'en empêcher), soit on les situes dans le futur des pays développés actuels, soit on les faits sortir de nul part, dans la mer ou l'espace. A propos des pays moins développés, je m’aperçois que j'avais, sans y avoir vraiment réfléchi, une approche qui frôle le protectionnisme éducatif : il leur faut dans un premier temps un Etat régalien, le temps qu'ils atteignent le niveau technologique nécessaire pour rendre pertinente les revendications de libertés individuelles, et qu'en suite, et bien... ils se retrouvent à la même étape que nous. Mais je me rend bien compte que si je refuse le protectionnisme provisoire qui voudrait favoriser les industries naissantes, je devrais sans doute pour les mêmes raisons m'opposer à des "pouvoirs régaliens provisoires". De plus, même s'ils sont très corrompus, les appareils étatiques des pays les moins développés sont sans doute moins gros que les nôtres, et ils risques de se transformer en de gros Etats social-fascistes comme les nôtres si ils suivent le chemin habituel du développement. Du coup, faudrait-il encourager, par exemple, des occidentaux à aller vendre des services de mercenaires à des privés en Afrique, de façon à permettre l'apparition de société de droits privés là bas (potentiellement beaucoup plus vite que chez nous) ?
-
Bienvenue reixis !
-

La Corée du Nord entrera demain en guerre aujourd'hui !
Mégille a répondu à un sujet de Fenster dans Europe et international
Il me semble que la Corée a été divisée en 3 royaumes pendant un grosse partie de son Histoire, donc même pour des nationalistes romantiques rêveurs, la Corée unique n'est pas si évidente que ça. Sinon, il y a une autre solution "Corée unique" encore plus utopique : un Etat coréen au sud... et pas d'Etat du tout au nord Un somaliland d'extrême-orient. Je suis sûr que ça marcherait bien, en plus. -
Il me semble que la taxonomie classique, linéenne, à base d'espèce, famille, ordre, etc est un peu obsolète, même si elle reste très couramment utilisé (pour flatter nos tendances autistiques, peut-être ?). La cladistique (ou phylogénie) la remplace avantageusement au sein de la science biologique, et est beaucoup moins coûteuse en terme d'hypostases plus ou moins métaphysiques.
-
Ca meurt très très vite ! Probablement avant même la première semaine. C'est possible pour un être humain, d'être hermaphrodite avec les deux sexes féconds ? edit : j'avais pas vu le post de H16
-

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron
Mégille a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société
Si je dis que je suis un 93, ça arrange mon cas... ou pas ? (Sinon, pour excuser mon inculture au sujet de Chirac, non seulement j'étais un chiard, mais en plus je vivais au Canada pendant la quasi-totalité de sa présidence) -

Port d'armes en France
Mégille a répondu à un sujet de lord byron dans Politique, droit et questions de société
A propos du tueur de Las Vegas, au final, ce n'est pas un membre du personnel de l'hotel (plutôt que les flics) qui l'a abattu ? Du coup, on peut facilement défendre que le mec aurait fait plus de morts si les armes avaient étés interdites. Intéressant ça ! Tu as de la doc à ce sujet ? -

Ces phrases qui vous ont fait littéralement hérisser le poil 2
Mégille a répondu à un sujet de Mathieu_D dans La Taverne
C'est sur mais bon, "pour tout X, si Nietzsche avait connu X, il l'aurait assurément détesté" est pour ainsi dire un théorème ! Et malgré les différences entre nietzschéisme et nazisme, il y a aussi pas mal de points communs. Il aurait méprisé les blondinets qui marchaient au pas, mais les officiers, les cadres, aux bottes bien cirés qui tuaient sans pitié et lisaient Hölderlin et Goethe ? Il les auraient méprisés aussi, sans doute, mais avec moins de raisons. Ce culte de la grandeur, la sensibilité païenne, le rejet de toute forme de compassions, l'amour de la guerre, etc, il y a de la graine de nazi. Et on peut dire ce qu'on veut sur le fait qu'il n'aurait pas été antisémite, La généalogie de la morale ressemble pas mal à "les bons, beaux et nobles aryens ont été corrompus par ces sales juifs". La principale raison pour laquelle il ne détestait pas complètement les juifs, c'est parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, mais en même temps il détestait les chrétiens parce qu'ils étaient trop juifs. Et sa théorie du caractère inné se prête bien à une théorie des races. Et s'il n'a pas été une influence directe pour Hitler, il l'a été pour pas mal des cadres nazis, et pour Mussolini. Bon, sinon, cadeau : http://www.dead-philosophers.com/ -

Images pas cool, justice sociale & steaks saignants
Mégille a répondu à un sujet de Lancelot dans La Taverne
Ce n'est pas la première fois que j'entends/lis l'expression. Mais j'avais plutôt vu ça à droite (ex : de Lesquen et les trois "coteries" de la superclasse cosmopolite -gay, juif et franc-mac). Quoi qu'il en soit, la gauche européenne devrait vraiment arrêter d'importer n'importe quoi des us, le féminisme 3ieme vague, ça craignait déjà pas mal, mais le suprématisme blanc inversé qui leur sert d'anti-racisme... non seulement on a pas besoin de ça, mais surtout, qu'est ce que ça vient faire ici ? Ou est-le contexte ? -

Ces phrases qui vous ont fait littéralement hérisser le poil 2
Mégille a répondu à un sujet de Mathieu_D dans La Taverne
Je dirais même que Nietzsche, qui n'est ni plus proche, ni plus loin de Adolf que Karl ne l'était de Joseph, est lui aussi couvert d'éloges par ce qui nous sert d'intelligentsia. -
Ce serait pas pour traduire les inimitables "so... ?" de Peterson ?
-

Images pas cool, justice sociale & steaks saignants
Mégille a répondu à un sujet de Lancelot dans La Taverne
Extrême gauche... blanche ? Palestine ? Indigène ? Impérialisme gay ? Du coup c'est quoi, des jeunes islamistes que les sjw de Tolbiac ont invités parmi eux pour avoir l'air tolérants ? Ce n'est pas impossible. Dans ma fac de philo, la minorité de droitards est assez boycottée par la majorité communiste. Le seul réac qui est le bienvenue est un grand barbu qui ponctue ses phrases par "Hallaou akbar" (qu'est ce qu'on se marre, avec lui !). -
Et en Libye tu en trouves pour pas trop chère, il parait.
-

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron
Mégille a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société
Autant pour moi... je ne sais pas grand chose au sujet de sa présidence, pas ma génération. Et Pompidou, il était correct ou social-facho ? -

Sharables pour la page facebook de Contrepoints
Mégille a répondu à un sujet de Miss Liberty dans Action !
Entre ça et la légalisation des drogues, carrément. Si ça se trouve, il est parmi nous en scred. -
TIL la preuve qu'usul est un islamo-gauchiste : https://fr.wikipedia.org/wiki/Usulisme
-

Les droitards, quelle plaie
Mégille a répondu à un sujet de Nick de Cusa dans Politique, droit et questions de société
Il me semble qu'il qualifie quelque part (flemme de retrouver où) le metal de "musique nègre jouée par des blancs, ce qui est encore pire"- 3 507 réponses
-
- extrême droite
- droitards
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :