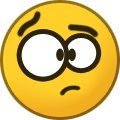-
Compteur de contenus
6 235 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
35
Tout ce qui a été posté par Mégille
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Oui, ce n'était pas une population si exotique que ça. Dans le gros du festival, en tout cas. Non, ça c'était génial. Le "love camp" était une sorte de festival dans le festival, réservé à l'élite woke, et c'est clairement là où j'ai passé la plupart des meilleurs moments. Si j'y retourne, ce sera presque seulement pour cet endroit là. Je veux dire, par exemple, on s'y faisait des câlins nus les yeux bandés en étant recouvert d'huile d'olive en écoutant de la musique planante. C'est carrément plus proche de l'idée platonicienne du fun que simplement se dandiner sur du boumboum. Ouai... et ça me tracasse pas mal d'ailleurs. J'aurais aimé qu'ils fassent aussi de la zone où il se passe des choses un endroit "clean". A la réflexion, je m'aperçois qu'au moins deux filles qui m'ont sauté dessus étaient probablement sous je ne sais pas quoi. Niais comme je suis et incapable de reconnaître les effets des drogues sur les autres, sur le coup, je m'étais contenté de me réjouir de leur enthousiasme. Même si je m'étais basiquement contenté presque passivement de les laisser faire ce qu'elles voulaient, je me sens plutôt mal à ce sujet, j'aurais sans doute dû les repousser. Par contre j'ai vite découvert que la mdma empêche ces messieurs de bander ? Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens ont besoin de tout ça. J'étais tellement mieux, seulement à l'eau et à l'huile. -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Surtout pour le premier jour, pour ainsi dire personne n'a joué le jeu du thème "body painting et calligraphie". Je m'étais recouvert le corps de prières païennes en grec, et j'avais peint la porte de la moria et un peu d'elfique sur un ami... Au mieux, les autres avaient quelques kanji ici ou là, et du maquillage fluo mis n'importe comment. Il y a tout de même eu quelques beaux costumes pour les deux autres jours, mais pas tant que ça. -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Yep, château perché. J'ai été assez déçu par les déguisements des gens, la plupart n'ont fait aucun effort. Mais je ne peux pas vraiment le leur reprocher, puisque je n'ai presque jamais porté les miens. Et pas beaucoup d'autres gens tout nu, contrairement à ce qu'on m'avait raconté. C'est pour ainsi dire moi qui ait lancé le mouvement. -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Je sors de mon premier festival de techno. Pas du tout quelque chose que j'aurais fait par moi même sans qu'on m'y tire. Drôle d'expérience. Musique inintéressante. Peut-être faut-il prendre de la drogue pour comprendre ? Encore une chance qu'il y avait des orgies. J'ai passé trois jours nu et huilé, ça c'était assez cool. Par contre, les festivaliers étaient faibles. J'ai eu l'impression qu'en ne buvant que de l'eau, j'avais plus d'énergie et moins d'inhibition que la plupart d'entre eux. Je m'attendais à mieux de leur part, surtout si ils trichent chimiquement. -

Devenir du Parti Républicain Américain
Mégille a répondu à un sujet de Lexington dans Europe et international
Pour en revenir au programme des rep du Texas : c'est habituel d'avoir des propositions aussi extrêmes chez eux, ou bien c'est une nouveauté ? C'est surprenant, vu que leur population urbaine est de plus en plus progressiste. Est-ce une sorte de réaction des cowboys pour faire fuir les immigrés californiens de chez eux ? -

L'ineffable Bruno Le Maire
Mégille a répondu à un sujet de Tramp dans Politique, droit et questions de société
chouette, un contrôle des prix avec encore plus de bureaucratie. Ca va bien se passer. -
Il y a beaucoup de chose dans le transhumanisme, la plupart assez inintéressantes philosophiquement. Mais la recherche d'immortalité fait aussi partie du programme. C'est de celle-ci seulement dont je parle, pas du reste. Si quelqu'un tient à avoir un bras robot qui peut aussi servir d'arrosoir, qu'est-ce que ça peut me faire... La différence, c'est que je prends au sérieux l'objet de la volonté. Et ce n'est pas qu'une question de linguistique, à un certain niveau, le langage doit bien finir par être à propos de quelque chose d'autre que lui-même. Peut-être que les différentes expressions culturelles de la volonté d'immortalité ne sont rien d'autre qu'une sorte d'allégorie d'un souhait qui est simplement celui de repousser la mort juste assez loin pour ne pas avoir à y penser, auquel cas tu aurais raison. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. La preuve en est que l'immortalité par procuration est traité comme un pis-aller, puisque dès qu'un alchimiste, un ingénieur, un milliardaire ou un empereur croit voir une possibilité sérieuse d'avoir une immortalité vécue en première personne, il va d'abord chercher à obtenir celle-là.
-

Le fil des séries (dont beaucoup trop se bousémotivent)
Mégille a répondu à un sujet de Brock dans Sports et loisirs
Je ne suis pas là dedans, mais j'ai plutôt bien apprécié, surtout pour l'esthétique. Dark Crystal et Severance aussi étaient/sont vraiment incroyables. Je suis déçu que Dark Crystal ne soit pas reconnu à sa juste valeur, d'ailleurs. His Dark Materials, Foundation, Carnival Row et quelques autres sont très bons aussi, même si je ne sais pas encore s'ils mériteront de passer à postérité. Les années 2010 ont aussi eu quelques très bons dessins animés, Bojack Horseman, Adventure Time, etc. Pour en revenir aux sorties actuelles, il me reste encore un épisode de Stranger Things, et jusqu'à présent je trouve la saison très bonne. Par contre, les derniers Umbrella Academy, mais quelle horreur. L'intrigue est extrêmement mal ficelée, tout est mal rythmé, et les relations émotionnelles des personnages (que ce soit la paternité surprise de 2 ou la romance de 1, etc) sont plate à mourir. C'est dommage, j'en gardais le souvenir d'une plutôt bonne série. -
C'est fou quand même, que pour produire de l'argent, il faut soit fusionner deux étoiles à neutron, soit une banque centrale.
-
Si c'est simplement un désir d'exister un plus longtemps, que ce soit par la technique, ou par procuration via une descendance ou un héritage, je n'ai rien y redire. (si ce n'est qu'il faut encore que ces années de vie -réelles ou par procuration- supplémentaires soient bien employées, et qu'elles n'ont pas forcément de valeur en elle-même. La patte d'éléphant de Tchernobyl est sans doute là pour plus longtemps que la Joconde, pourtant, il n'y a pas de quoi en être fier) Je constate simplement que si le sens de ce désir est de combler le vide de l'éternité sans nous, alors, tous les expédients sont inutiles, puisqu'une durée finie, aussi grande qu'elle soit, est toujours négligeable à coté de l'infinité de l'éternité. Et je ne dis pas ça comme un reproche à qui que ce soit d'autre que moi, ou comme une justification a posteriori de quoi que ce soit me concernant. Spontanément, j'ai autant envie que n'importe qui de laisser quelque chose derrière moi, et a priori pas moins de chance que n'importe qui d'autres de le faire un peu. Ce que je partage ici est le fruit d'un auto-examen. Et ce à quoi tout ça m'amène est moins un "tant pis pour l'éternité" qu'un "il faut chercher l'éternité ailleurs qu'ici bas", mais flemme de développer ça. Si ce n'est pour dire qu'ultimement, au regard de ça, la reproduction et les oeuvres sont des vanités comme les autres, qui n'ont été glorifiées que pour des raisons pragmatiques.
-

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
-
Simplement : il n'y avait, à l'origine, pour ce que j'en sais, que de l'hydrogène, et les éléments plus lourds sont apparus par fusion au sein d'étoiles. Notre naine jaune n'étant pas assez puissante pour fusionner plus que de l'hydrogène en hélium, tous les éléments avec un numéro atomique >2 sont apparus précédemment au sein d'une étoile beaucoup plus massive, se sont dispersés suite à son explosion, avant de finir attrapés dans la nébuleuse qui allait devenir notre soleil. Les étoiles naissent des cendres des précédentes, en ayant plus de "métaux" à chaque génération, et la notre en est à la troisième. Tu veux dire que de l'hélium est apparu dans l'univers sans passer par la case "étoile" ?
-
Il y en a un qui a pris Protagoras trop au pied de la lettre.
-
A l'exception de l'hydrogène, tous les atomes de notre corps ont déjà fait partie d'une étoile, voire même de deux ou trois étoiles, successivement.
-
A priori, selon le fonctionnement de l'énergie noire, c'est soit ça, soit le big crunsh. Et si, somehow, en dépit de tout ce que l'on comprends aujourd'hui de l'univers, il continue à être tel qu'il est, avec toujours de nouvelles étoiles naissant grâce à une nouvelle énergie sortant de nulle part, permettant à une humanité de survivre à l'effondrement de ses planètes hôtes les unes après les autres, on garderait une proba >0 qu'elle s'éteigne, et donc, une proba tendant vers 1 qu'elle s'éteigne sur une durée suffisamment longue. Je ne dis pas que ce qui est fini est sans valeur. Je dis que si on peut donner de la valeur, du sens, à un héritage (biologique, culturel, etc) fini même face à l'infinité potentielle de l'univers, alors, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire tout autant d'une simple vie, sans héritage. Si le but de l'héritage, sous toutes ses formes, est l'immortalité véritable (et il est tout à fait possible que ce soit bel et bien le désir que l'on cherche à combler par là, à en croire de nombreux écrivains en tout cas), alors il est tout aussi vain que les potions magiques des empereurs chinois ou que l'immortalité par transhumanisme des sorciers californiens. Au contraire, si cette immortalité n'est pas ce qui est désiré, et si donc on ne mesure pas la valeur ou le sens de quelque chose à sa durée (parce que dans ce cas, tout ce qui est finis serait effectivement négligeable), il faut envisager qu'une vie même courte et sans héritage puisse être tout aussi bonne et pleine de sens qu'une autre.
-
Je pensais à un oublie post disparition du leg. Un jour, ta lignée disparaîtra, la Joconde et la grande pyramide de Gizeh aussi, et l'espèce humaine, et la vie sur Terre, et le soleil... Ca fait sans doute très loin, mais pas infiniment loin.
-
Pourtant, ça aussi finira par disparaître. En tant que stratégie pour obtenir l'immortalité, ça ne marche donc pas plus. Tout au plus, la différence est qu'avec un peu de chance, on est déjà mort lorsque notre oeuvre/notre lignage sombre dans l'oubli. Ca permet de vivre dans l'illusion que ce sera bien éternel... mais c'est le corollaire du fait du fait que l'on est justement déjà mort lorsque ça arrive, ce à propos de quoi personne ne peut s'illusionner. Même si la procréation et l'immortalité par les œuvres jouissent traditionnellement d'une meilleure image (et sont, étonnement, rarement jugées orgueilleuses et folles) que les moyens scientifiques ou pseudo-scientifiques d'obtention de l'immortalité, ma vision n'est pas tout à fait neuve non plus. C'est déjà celle de Platon, pour qui la recherche de l'immortalité par la procréation (et l'amour monogame, d'ailleurs) est le pallier le plus bas de la contemplation du Beau. (et de la reconnaissance de la part de nous qui lui est semblable, en quoi consiste la véritable immortalité)
-
Le transhumanisme est une mauvaise réponse à la peur de la mort. Tant que la probabilité d'être accidentellement détruit est supérieure à 0, sur une durée infinie, la mort devient virtuellement certaine. On pourrait même ajouter que ça augmente l'incertitude concernant le moment de la mort, ce qui est peut-être pire. On peut envisager de répondre à ça en émettant l'hypothèse que les gens mettraient fin volontairement à leur vie au bout d'un certain temps, et le fassent en moyenne avant que le risque de mourir accidentellement ne devienne plus grand, mais ça reviendrait à admettre que la mort est souhaitable (puisqu'elle serait souhaitée) dans certains cas ou au bout d'un certain temps. Je dis tout ça en étant persuadé de pouvoir passer plusieurs millénaires sans m'ennuyer (et je plains ceux dont ce n'est pas le cas). J'aurais enfin le temps de lire tout ce que je veux lire, de méditer, d'avoir un nombre de partenaires sexuels réguliers égal à mon nombre de Dunbar, et peut-être même de jouer à des jeux vidéos. Mais une durée finie, au regard de l'infinité de l'immortalité qu'on désire, reste toujours négligeable (ou alors, tout aussi susceptible d'être "bonne" ou "pleine de sens" si elle est courte). Mais pour la même raison, l'immortalité que l'on est susceptible de chercher par l'accomplissement d'oeuvres (artistiques ou autre), ou par la reproduction, est tout aussi factice et vaine. Il me semble que si la mort est nécessaire, alors elle ne peut pas être dite mauvaise, puisque le bon et le mauvais, étant normatifs, ne s'appliquent qu'à ce qui dépend de nous et que l'on peut changer. (il me semble que ce qui n'est pas une possibilité réelle ne peut pas être une nécessité, même morale) Inversement, il me semble que si l'immortalité est espérable, on ne peut qu'espérer l'avoir déjà, puisque je ne vois pas comment un changement pourrait nous rendre, à un certain niveau, hors de tout changement. L'auteur fait un petit saut logique quand il saute de l'immortalité à une vie plus ou moins longue. Vouloir vivre un million d'années, ce n'est pas la même chose que vouloir vivre sempiternellement, et l'infini est tout aussi grand du point de vue du millionnaire (en années de vie) que du notre ou de celui du papillon. Et ceci étant dit, de deux vies finies quelconque, il me semble que la plus longue n'est pas toujours la meilleure. Ca me semble presque idiot de le préciser, mais je préfère de loin 30 ans de bonheur, de joie d'être bien entouré, de fierté de mes accomplissements, etc, à 100 de souffrance de maladie chronique, de solitude, de honte et de culpabilité.
-
C'est vraiment défensif tout ça (on s'attend à ce que les russes débordent de l'Ukraine ?)... ou on est actuellement en train de se préparer activement à passer à l'offensive ? A minima, on est en train de menacer de le faire comme moyen de dissuasion, non ? Parce que ça ressemble quand même pas mal à l'accumulation de troupes russes autour de l'Ukraine avant l'invasion.
-

École & éducation : Le temps des secrets
Mégille a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société
Et pourtant, quelques années plus tard, ça ne fait pas des lycéens bons en français... -

Allemagne, Übermensch und Kartoffel
Mégille a répondu à un sujet de Adrian dans Europe et international
Tu veux dire, la Mongolie avec une onzaine d'armées ? -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co
Mégille a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société
Jeanne d'Arc avait effectivement une expression de genre un peu inhabituelle. Ceci dit, parler de trans-identité serait clairement un anachronisme, voire un mégenrage, et de plus, vu ses fréquentations, je ne suis pas sûr que tenter de la revendiquer soi une bonne idée. Tiens d'ailleurs, c'est plus ou moins elle, l'instigatrice de l'idée de monarchie de droit divin en France, non ? -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Peut-être l'un des miens -

Allemagne, Übermensch und Kartoffel
Mégille a répondu à un sujet de Adrian dans Europe et international
Qui a envie de voir ? -

Je raconte my life 9 : hache de bûcheronnage et vaporetto
Mégille a répondu à un sujet de poney dans La Taverne
Yup. Mais ce n'était pas interne au lycée. (convocation nationale pour des corrections d'épreuve, dans l'éducation agricole, ce n'est pas numérisé, on fait ça sur place) La plupart bossaient dans le public, je crois.